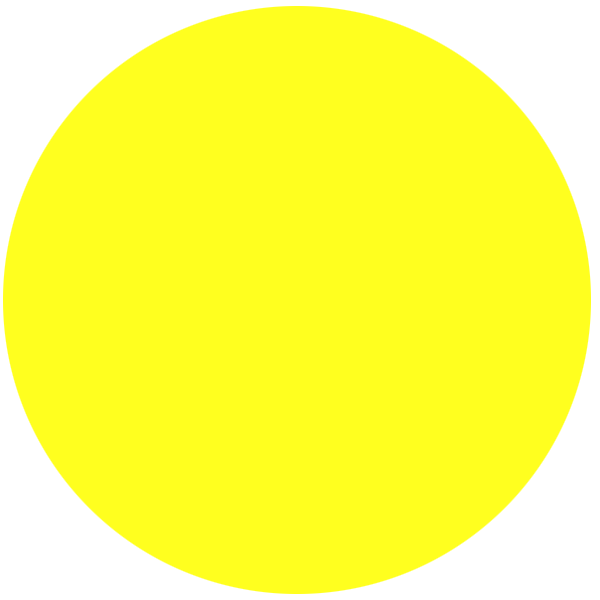

—
Résumé
La vocation de ce projet éditorial est de proposer une réflexion collective et multidimensionnelle sur les conditions et les modalités des écologies du numérique (matérielle, psychique, sociale et politique). Cette réflexion est menée de manière conjointe à travers des analyses de pratiques de conception, de production, de diffusion et d’usage propres au design au sens large (design objet, design graphique, design éditorial), et à travers des projets d’artistes et de designers confirmé·e·s, comme d’étudiant·e·s de 2e cycle à l’ÉSAD Orléans, qui interrogent les effets du système numérique sur les milieux naturels et artificiels tout en proposant de nouvelles pratiques de conception et de partage des savoirs. Dans cette introduction, il s’agit avant tout de poser les enjeux d’une pluralisation de l’écologie, puis des significations d’un horizon post-numérique, et enfin des raisons motivant une édition en web to print.
Text écrit en 2021 et actualisé en 2022 pour la publication des actes augmentés du colloque « Les écologies du numérique » organisé par l’ÉSAD Orléans (ÉCOLAB) en 2017 et 2018.
—
Mots clé
Écologie, Design, Numérique, Édition, Post-numérique, Savoir
—
Biographie
Ludovic DUHEM
Ludovic Duhem est philosophe et artiste. Il enseigne la philosophie dans des écoles supérieures d’art et de design en France et à l’étranger, ainsi qu’à l’université. Actuellement coordinateur de la recherche à l’ÉSAD Valenciennes, il était responsable de la recherche de l’ÉSAD Orléans de 2010 à 2019 et directeur de l’UR ÉCOLAB de 2016 à 2019. Ses recherches portent sur les relations entre esthétique, technique et politique en lien avec les enjeux écologiques. Site web : www.ludovicduhem.com.
—
Ce projet éditorial porte sur les conditions et les modalités d’une conception « écologique » du numérique à travers les pratiques contemporaines de design. Il repose plus précisément sur l’idée que l’écologie est irréductible à l’étude scientifique des écosystèmes et à l’engagement pour la protection de la nature, et qu’elle doit par conséquent se comprendre au sens large comme une approche relationnelle, dynamique, scalaire et complexe pouvant s’appliquer non seulement aux milieux naturels mais aussi aux milieux artificiels, et en particulier au milieu numérique devenu aujourd’hui le milieu associé de nos existences humaines, c’est-à-dire ce qui donne des conditions et des significations nouvelles à nos manières de sentir, de penser et d’agir.
À ce titre, l’élargissement de l’écologie appliquée au numérique n’est pas une naturalisation de la technique qui ferait des objets numériques des êtres autonomes vivant au sein d’écosystèmes isolés de la toxicité des conditions industrielles de leur production, de la dépense énergétique considérable de leur utilisation et des effets nocifs de leur destruction (ce que la cybernétique a pu longtemps laisser croire et que la logique d’effacement technocapitaliste poursuit aujourd’hui). Ce n’est pas non plus une manière de fonder la sortie de la crise écologique (si cette crise peut être clairement circonstanciée et n’être qu’un moment de notre histoire commune) sur le développement exclusif des technologies numériques. Cela signifierait avoir recours à un technicisme naïf reprenant le mythe moderne du progrès (irrésistible, infiniment désirable, intégralement rationnel et intrinsèquement bon) pour le transférer dans la « société de la connaissance » (grâce à la puissance de calcul, de simulation et de réticulation de la rationalité computationnelle) et de l’idéologie de l’ « innovation permanente » (dont le sens est économique plutôt que technique), tout en ignorant volontairement que ce transfert implique en même temps la transformation du savoir en marchandise, l’accroissement du travail gratuit, et le contrôle de la vie individuelle et collective (donc une prolétarisation généralisée par la perte de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-vivre et de savoir concevoir).
Au contraire, il est question d’opérer une véritable critique de l’hypermodernité numérique, celle du calcul automatique généralisé et de la transformation intégrale de toutes les dimensions de la réalité du niveau nanophysique au niveau cosmologique. Cette « critique » n’est pas une opposition à toute forme de « modernité » (exigence de rationalité, d’universalité et d’émancipation en font partie) ni au « numérique » comme tel (comme technique, industrie et média), mais une démarche de questionnement sur les conditions de sa constitution, de son évolution, de son fonctionnement et de ses effets. C’est aussi une recherche de dépassement des alternatives classiques entre humanisme et technicisme d’une part, humanisme et écologisme d’autre part, lesquelles limitent aussi bien la compréhension de la complexité de la crise écologique planétaire que la réussite des actions proposées pour la résoudre.
Selon une telle perspective critique, ce projet éditorial propose de pluraliser l’écologie en questionnant le numérique sur le plan de l’écologie matérielle (ressources, risques et alternatives), de l’écologie psychique (capture de l’esprit et design du savoir), de l’écologie sociale (transformation de l’identité, conditionnement des communautés, contrôles des échanges), de l’écologie politique (nouvelles formes d’exploitation et de lutte, de participation et d’organisation). Or, ces différents plans ne sont pas de simples catégories conceptuelles commodes pour traiter la question de l’écologie du numérique obtenues par son éclatement en aspects isolés, ce sont en réalité les dimensions du même problème, et plus encore les modes d’existence d’une même réalité qui se superposent, se heurtent, se plissent, se fracturent, au sein d’une situation tout à fait nouvelle. Plus précisément, en tant que le numérique tend désormais à transformer l’ensemble des relations entre la Terre et les êtres humains, mais aussi entre les humains et les artefacts, entre les humains et entre les artefacts eux-mêmes devenus autonomes et interconnectés ; il semble décisif de questionner non seulement l’impact écologique du numérique (ses effets physiques, biologiques, psychiques, sociaux, politiques) mais aussi l’impact du numérique sur l’écologie (comme science, discours, action, mobilisant les technologies numériques). À cet égard, une démarche critique doit nécessairement s’interroger sur les notions qu’elle convoque et sur les critères qu’elles mobilise, ce qui implique de questionner le « numérique » par rapport au « digital » et au « computationnel », l’extension de l’écologie (ainsi que les notions de milieu, d’écosystème et d’évolution) à la réalité artificielle, et la notion d’impact elle-même dans la mesure où elle est à la fois ce qui relève d’abord du choc, de la perturbation, de la destruction d’un donné supposé stable et normal, comme ce qui exprime ensuite un impératif de mesure, d’évaluation, d’enregistrement de ce qui est nécessairement identifiable et calculable, et comme ce qui suppose enfin un possible contrôle sur les facteurs déterminant l’impact et une adaptation à ses effets.
C’est selon une telle approche multidimensionnelle, systémique et réflexive que le design pourrait ainsi aider à comprendre ce qu’implique le numérique dans l’ensemble du processus de connaissance et de transformation de la réalité, et contribuer au dépassement des alternatives classiques mentionnées plus haut comme au dépassement de l’opposition en design entre écologisme militant (design radical) et mensonge publicitaire (« green washing ») qui polarise de manière stérile les positions au sein du domaine ainsi que les choix opérés dans de nombreux projets. À cet égard, le recours à l’ « écodesign » développé par l’industrie depuis les années 1990 s’avère insuffisant voire trompeur, avant tout parce qu’il participe d’une gestion de la crise écologique plutôt que d’une remise en question des principes du modèle dominant – celui du techno-capitalisme extractiviste, carbonné, anthropocentré, computationnel et réticulaire – qui maintiennent les conditions de cette crise (exploitation de la nature, standardisation, opposition entre producteur et consommateur, perte de savoir, court-termisme, etc.) en l’imposant comme un état de fait, un ordre du monde irréversible, voire dans le pire des cas comme ce qui est souhaitable par dessus tout.
Être écologique pour le design à l’époque du numérique intégral, signifie donc dépasser l’écodesign, non seulement pour interroger les conditions matérielles (métaux, pétrole, énergie électrique, systèmes de transport, bâtiments) et les effets écologiques de l’infrastructure numérique (câbles, satellites, antennes, data centers, relais, serveurs locaux), des appareils (ordinateurs, smartphones, smartwatches, objets connectés), de leurs usages (volontaires et automatisés), et pour trouver des solutions de réduction des conséquences nocives de leur existence pour les milieux naturels et les milieux humains (sur le plan psychique, social, économique et politique). Mais c’est aussi un impératif d’imagination et d’expérimentation de nouvelles formes de conception, de production, de partage et de critique du numérique. Le design est capable d’assumer un tel impératif en prenant ses responsabilités, y compris en interrogeant sa propre dépendance au numérique. C’est précisément ce que ce projet éditorial cherche à montrer dans la diversité des points de vue, des pratiques de recherche et d’expression.
Un enjeu majeur s’impose alors comme horizon de ce projet éditorial : celui de la conception d’un monde « post-numérique ». Faut-il vouloir, concevoir, produire, un monde « post-numérique » pour répondre aux enjeux écologiques? Le rôle du design est-il celui d’y contribuer comme il a pu contribuer au monde numérique actuel, c’est-à-dire aussi au modèle dominant de la modernité industrielle mondialisée devenu insoutenable? Venu du champ de l’art, le concept de « post-numérique » est récent et demeure aujourd’hui polémique tant il peut prendre des acceptions différentes et parfois contradictoires, surtout quand il s’applique au design.
Premièrement, on peut évidemment entendre cette dénomination au sens chronologique et considérer qu’il s’agit d’une période postérieure à la constitution des techniques de conception, de production et de diffusion issues de la cybernétique, de l’informatique et de la télématique (on pense alors aux années 1980 plutôt qu’aux années 1950, et plus encore aux années 1990 avec le développement de l’informatique personnelle et surtout celle d’Internet à travers le web). Mais si une telle chronologie semble a priori commode, elle est en fait très problématique, en ce sens qu’elle assigne au numérique une origine unique et fixe sans tenir compte des décalages, des superpositions, des anachronismes, qui s’opèrent toujours au moment de l’apparition d’un nouveau système technique et plus encore dans le rythme de son adoption par la société où le rôle du design est déterminant (pour le diffuser, le faire accepter, le rendre facile à utiliser, voire pour l’imposer dans la culture).
Deuxièmement, on peut exprimer par là une position historique plus marquée et affirmer que le « post-numérique » désigne un autre design que le design analogique nécessitant la reconnaissance d’une césure historique qui dépasse la simple adoption de nouveaux outils dont les effets sont alors non seulement techniques et esthétiques, mais surtout ontologiques au point que le design change de nature. Une telle signification a une certaine pertinence dans la mesure où elle pose à juste titre que l’apparition d’un nouveau système technique peut transformer une pratique comme le design au point de la modifier dans tout ce qui la définissait par rapport aux autres pratiques existantes et apparentées, comme d’autres systèmes techniques et symboliques ont pu le faire dans le passé (l’écriture et l’imprimerie par exemple). Il serait toutefois tout aussi légitime d’affirmer que le design « post-numérique » conserve et/ou transpose des caractéristiques qui existaient auparavant et dont la trace est encore visible dans le design numérique actuel (tels le « bureau », les « outils », la « page », le « menu », pour ne parler que des plus évidents et des plus connus).
Troisièmement, on peut considérer que le design « post-numérique » est un design qui cherche à questionner le numérique en tant qu’ensemble ayant transformé la société dont l’omniprésence risque de dissimuler les enjeux éthiques, sociaux, politiques, et de manière plus préoccupante encore, les enjeux écologiques. Cette façon critique de l’envisager implique par exemple de remettre en question la place des écrans (attention, apprentissage, dépendance), le primat du « high tech » (complexité, fragilité, temps long et coût élevé de la R&D, ignorance du fonctionnement par les utilisateurs, alternatives « low tech »), l’impératif de l’automatisation (autonomie, décision, erreur), la soumission aux mégadonnées (calcul, contrôle, délégation), mais aussi et surtout de rétablir, réinvestir et renouveler la relation au monde physique, à la matérialité, à la vie, au corps, à l’humain, au-delà du code, du calcul, du programme. Si tous ces aspects du problème posé par le numérique intégral sont effectivement importants et même décisifs, il ne faudrait pas sous-estimer la capacité des géants technologiques et économiques (GAFAM) à intégrer ces critiques comme des opportunités de redéploiement de leurs activités et de maximisation des profits, comme le corps-interface dans les activités vidéoludiques (par les capteurs de mouvement et l’appropriation corrélative des gestes par brevet) ou la bulle spéculative autour de la signature cryptée des NFT ont pu le montrer ces dernières années, ou comme on peut le constater plus profondément dans la transformation structurelle de la matière (nanoingénieurie) et de la vie (biotechnologies) dirigée par la technoscience (NBIC).
Quatrièmement, ce questionnement peut se faire plus critique encore et devenir radicalement politique en appelant « post-numérique », un design qui refuse de passer par le numérique, donc qui refuse de mobiliser des techniques, des machines, des ressources matérielles et des sources d’énergie, mais aussi des modes de représentation, des modes de socialisation et d’organisation collective, considérées comme étant propres au « numérique » et produisant une dégradation des milieux de vie et des humains qui leur donnent sens. Le recours au « pré-numérique » peut alors apparaître comme une solution de repli séduisante, mais comportant le risque d’un retour illusoire à une situation définitivement passée qui reste malgré tout déterminée, même indirectement, par le numérique. Une archéologie du numérique (par l’archéologie des médias par exemple) montrerait par ailleurs assez facilement : d’une part l’existence de liens quasi indéfectibles du numérique avec l’analogique (histoire de l’écriture, du code, du calcul, de la tabulation, de la transmission d’information, etc.) et en particulier avec des techniques vernaculaires artisanales (comme le tissage, la broderie, etc.), et d’autre part la nécessité pour toute invention d’intégrer les schèmes, les méthodes et les formes du passé pour se constituer et s’inscrire dans la culture. Ce à quoi il faudrait évidemment ajouter la dépendance directe du numérique au système analogique, ne serait-ce que celle qui l’unit au système de production d’énergie électrique (ce dernier étant cependant de plus en plus piloté par le numérique).
Sans prendre parti pour telle ou telle signification de l’expression « post-numérique » et de lui associer une idéologie, un courant intellectuel ou une esthétique, cet enjeu traverse, même implicitement, la plupart des contributions de ce projet éditorial. Et si elles n’investissent pas cette question de front, elles proposent en tout cas de réfléchir à une conception écologique pour « refaire un monde » soutenable et partageable selon des formes inédites de représentation, de production, d’édition et de narration qui intègrent le numérique comme questionnement sur les principes, les conditions et les effets de la pratique du design. Le paradoxe est alors que le « post-numérique » comme horizon possible des contributions n’en exclut pas pour autant l’intérêt du numérique, à condition de le considérer ni comme la cause unique de la crise écologique ni comme sa solution incontournable ni non plus comme un outil neutre et sans conséquences, mais comme un dispositif expérimental fait de tensions, de frictions, de traductions et de potentiels dont on ne peut pas ignorer la puissance constructrice et destructrice (c’est-à-dire « pharmacologique », à la fois « poison » et « remède » exigeant une thérapeutique).
Dans ce projet éditorial, il en va donc non seulement de ce que le numérique fait au design mais surtout de ce que le design peut faire du numérique et au numérique pour qu’il puisse être enfin moins destructeur pour la nature comme pour l’esprit, pour les artefacts comme pour les milieux sans lesquels il n’y pas de création ni de vie possibles. C’est précisément dans cet esprit que les contributions réunies ici entendent apporter des éléments pour comprendre les enjeux pour le design actuel d’une postérité numérique qui ne soit pas l’aggravation de la catastrophe, la poursuite aveugle de l’innovation permanente et l’adhésion béate à la « smartness » des AI, mais le soin à long terme de l’alliance vertueuse de la vie organique, de la vie technique et de la vie symbolique, celle qui fait du monde humain un monde partageable et habitable au moment où la biosphère tend à se confondre avec la technosphère et où l’humanité est tentée par un avenir post-politique et trans-humain délétère.
Ce projet éditorial témoigne des recherches de l’unité de recherche ECOLAB au sein de l’École Supérieure d’Art et de Design d’Orléans entre 2017 et 2019. Il constitue les actes augmentés de deux colloques dont le premier volet « Les écologies du numérique » (9 et 10 Novembre 2017) avait pour principale ambition de questionner les formes d’écologie que le design pouvait à la fois questionner, concevoir et transformer pour comprendre les enjeux actuels du numérique. Le second volet, intitulé « Les écologies du numérique #2 Vers un design post-numérique? » (13 et 14 Décembre 2018) proposait pour sa part d’interroger la possibilité et la pertinence d’un design « post-numérique » à travers deux thématiques : « matérialités post-numériques et savoirs vernaculaires » et « design éditorial et nouvelles formes de narration ».
Par le choix d’un contenu proposé intégralement en ligne sous la forme d’un site web to print, il fallait en quelque sorte prendre acte d’une nouvelle économie de l’édition, en particulier de l’édition d’ouvrages collectifs proposant un contenu théorique (à la fois peu écologiques même avec un papier certifié, des encres végétales et des circuits courts d’impression ; coûteux à produire, surtout aujourd’hui avec la crise durable du papier ; difficiles à diffuser à cause du prix de vente et du contenu très spécialisé), mais aussi et surtout d’une nouvelle écologie du savoir directement engendrée par les nouvelles formes d’écriture, de lecture et de diffusion que le numérique rend possible. Il serait donc erroné de voir là un aveu d’échec quant au combat pour la circulation des idées dans la société actuelle ou un geste purement pragmatique d’adaptation au marché de l’édition classique bouleversé par le numérique (notamment par l’autocomplétion de l’écriture, l’automatisation de la lecture, l’algorithmisation de la narration, et plus encore par l’automédiatisation et l’autoédition). Il s’agit donc d’un véritable parti pris pour les idées, pour la pensée, pour la publicité du savoir dans une époque où s’imposent la numérisation massive du savoir publié, l’industrie des plateformes de contenu, la logique de l’audience et d’exploitation de l’attention, l’appropriation économique des langues, l’automatisation de la pensée et de la conversation, auxquelles tentent de résister le hacking, la conception de logiciels libres, les plateformes collaboratives et les communautés d’amateurs.
Partant de cette idée et participant de cet engagement, les contributions présentes dans ce projet éditorial sont toutes animées par l’impératif d’établir un nouveau rapport au savoir, à ses conditions de production et à sa publicité, en étant à la juste mesure des transformations produites par la numérisation. Cela se traduit dans le choix de proposer un ensemble de contributions qui soient des réécritures des interventions aux deux colloques, au double sens d’une écriture seconde qui approfondit et prolonge ce qui a été dit, et d’une nouvelle écriture qui en diffère complètement par le nouveau contexte de diffusion. D’autres contributions inédites (Yves Citton, Fabrice Flipo, Jean-Jacques Gay, Roxane Jubert, Andrew Feenberg) viennent aussi s’ajouter à l’ensemble initial en apportant un complément nécessaire, en déplaçant un point apparemment assuré, en ouvrant une perspective inattendue, pour faire de cette publication un objet non linéaire dans sa structure et non univoque dans son propos.
Les présentations de projets de création jouent à cet égard un rôle décisif qui n’est pas du tout celui d’une illustration des textes théoriques : leur rôle est à la fois celui d’une articulation entre les textes par le hors texte (celui de l’image), à la manière d’une trame rythmique et d’une pensée qui s’écrit autrement dans un réel dialogue, et celui d’un contrepoint sensible et autonome qui déborde les textes en traçant des lignes marginales à partir de ce que les textes ne peuvent pas dire. Une sélection de projets de Master d’ancien·ne·s étudiant·e·s de l’ÉSAD Orléans vient enfin marquer la synergie entre recherche et pédagogie, entre enseignement et création, entre ce qui est transmis dans une école et ce qui ne peut pas l’être autrement que par l’expérimentation.
La construction d’un tel projet éditorial s’est donc faite sans hiérarchie entre les différentes contributions, dans l’esprit de la recherche produite dans les écoles d’art et de design qui se fait aussi bien par les chercheuses et chercheurs du monde académique, par les actrices et acteurs du monde de la création, que par les étudiantes et étudiants en 2e et 3e cycle. C’est ce qui fait de ce site web (réalisé via WordPress) un premier engagement dans une recherche contributive décloisonnant les types de savoirs, de disciplines, de supports, de pratiques, de statuts, en cohérence avec le potentiel du numérique et la nécessité écologique de transformer toutes nos habitudes de penser, de vivre et d’agir. C’est justement là le rôle des structures d’enseignement, en particulier celui des structures publiques d’enseignement supérieur « artistique », de cultiver le goût pour le savoir mais aussi le désir de s’émanciper des réalités instituées pour ouvrir d’autres voies à l’esprit du temps et à l’avenir du monde.
Nota bene : les textes présentés dans cette publication ont été écrits à des dates différentes en raison de leur rédaction initiale pour une communication lors du colloque « Les écologies du numérique » (en 2017 et en 2018), puis de leur actualisation en vue de la publication des actes (2019 et 2020), et d’autres textes ont été écrits postérieurement en raison d’invitations adressées à des chercheuses et chercheurs (en 2020) pour compléter les contributions et offrir ainsi des « actes augmentés ».