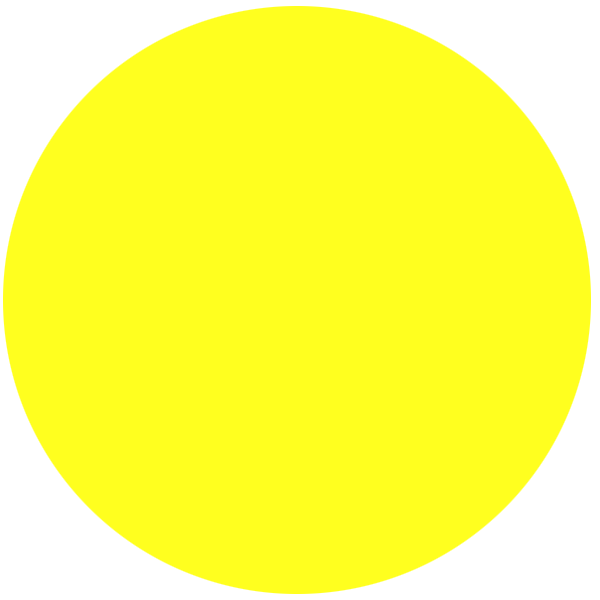

—
Résumé
Une activité de conception, de fabrication et de production « post-numérique » mobilise des modes nouveaux de représentation, de socialisation, d’organisation collective propres au numérique et rejoignent rapidement d’autres enjeux liés à l’environnement, à l’économie, à la politique, à l’organisation sociale. Les makers n’ont pas attendu les designers pour inventer de nouvelles façons de s’organiser hors des modèles économiques classiques. Ce texte s’appuie sur une étude du mouvement maker et des FabLabs : des ateliers équipés d’outils de conception et de fabrication numérique accessibles à tous, designers et amateurs.
Texte écrit en 2020 pour compléter les actes du colloque « Les écologies du numérique » organisé par l’Ésad Orléans (ÉCOLAB) en 2017 et 2018.
—
Mots clé
maker, FabLab, design ouvert, autonomie, démocratisation, partage, collaboration, open source
—
Biographie
Camille BOSQUÉ
Camille Bosqué est designer et docteure en esthétique et design, professeure agrégée en arts appliqués, enseignante à l’école Boulle à Paris. Ses recherches portent sur les pratiques liées à la diffusion des outils de conception et de fabrication numériques (comme l’impression 3D), au sein d’ateliers communs tels quel les FabLabs, hackerspaces ou makerspaces. Elle est notamment l’actrice de l’ouvrage Open Design. Fabrication numérique et mouvement maker, paru en août 2021 aux Éditions B42 dans la collection Esthétique des données.
Qu’elles soient en récession ou en pleine expansion, les sociétés actuelles cherchent de nouveaux modèles pour intégrer les changements apportés par le développement des technologies et des réseaux numériques. Ces changements pourraient reformuler le couple classique producteur/consommateur fondé sur des systèmes de distribution centralisés. Dans un contexte décrit comme étant post-industriel[1] ou hyperindustriel, la tâche est lourde et différentes solutions sont attendues, qui touchent à la protection des ressources naturelles et à la biodiversité, au recyclage, à la réparation et au réemploi, à la lutte contre le gaspillage et l’obsolescence programmée, etc. Dans cette perspective, une activité de conception, de fabrication et de production « post-numérique » mobilise des modes nouveaux de représentation, de socialisation, d’organisation collective propres au numérique et rejoignent rapidement d’autres enjeux liés à l’environnement, à l’économie, à la politique, à l’organisation sociale.
Les makers n’ont pas attendu les designers pour inventer de nouvelles façons de travailler, produire, transmettre ou consommer hors des modèles économiques classiques. Le texte qui suit s’appuie sur une étude du mouvement maker[2] et des FabLabs (aussi appelés tiers-lieux de fabrication ou makerspaces en général) : des ateliers équipés d’outils de conception et de fabrication numérique accessibles à tous, designers et amateurs. Le récit « officiel » de l’émergence du concept de FabLab[3] et les histoires singulières des premiers lieux du réseau font émerger des visions liées à des enjeux locaux qui, au-delà des outils et au-delà de l’atelier, touchent à des dimensions écologiques, sociales et politiques. Ces pratiques révèlent des scénarios opérationnels situés, localisés, singuliers, qui échappent aux catégorisations classiques[4].
La quête d’autonomie est un idéal politique qui anime de nombreux acteurs du mouvement maker et du logiciel libre et qui se construit par l’action, le faire, la « preuve de concept[5] », au-delà du récit et de la mise en scène. Cela passe par une prise de distance avec les institutions établies et par la mise en place de dynamiques de collaboration, d’apprentissages collectifs, hors des normes et dans l’expérimentation.
Le réseau des FabLabs s’est développé ces dernières années depuis le MIT à Boston, puis dans nombreuses régions du monde urbaines ou rurales, dans des cadres institutionnels ou au cœur de communautés informelles. Ce réseau compte en 2019 près de 1500 FabLabs dans le monde. Selon l’expression de Neil Gershenfeld, qui est, avec son équipe, à l’initiative de ce mouvement, les FabLabs ont été conçus pour conduire les populations du monde « à devenir les protagonistes de la technologie, plutôt que ses spectateurs[6] ». L’une des raisons pour laquelle le récit de la naissance des premiers FabLabs est peu précise tient au fait que leurs existences, pour certains, précèdent l’intervention du MIT. En dehors du récit personnel de Neil Gershenfeld[7] , peu de textes permettent de connaître la genèse des premiers FabLabs. Le FabLab du Vigyan Ashram (2002), le MIT-FabLab Norway[8] (2004) et le South End Technology Center de Boston (2005) sont ainsi des FabLabs « pionniers » qui se trouvent au cœur de territoires géographiquement, économiquement ou politiquement marginaux. Par leur délocalisation, tous incarnent un décalage entre un projet initial centré sur la technologie et des appropriations locales davantage tournées vers des fins d’intervention sociale, culturelle ou environnementales qui bousculent, dès les premières années du mouvement, le cadre initialement fixé par le réseau normé des FabLabs.
Tout commence au Center for Bits and Atoms, au MIT, à Boston, à l’aube des années 2000. En 1998, le professeur Neil Gershenfeld propose aux étudiants du Massachusetts Institute of Technology (MIT) un cours d’un semestre intitulé « How To Make (Almost) Anything », « Comment fabriquer (presque) n’importe quoi ». Les laboratoires du Center for Bits and Atoms sont alors généreusement équipés en machines numériques et en microcontrôleurs de dernière génération. Pour développer ses recherches sur la fabrication numérique personnelle, Neil Gershenfeld décide d’ouvrir le laboratoire à quelques étudiants en fin de cycle. De cette expérimentation pédagogique naissent des dizaines de projets farfelus et un peu gadgets, qui ont comme point commun d’être des produits destinés à un marché d’une seule personne (l’étudiant qui en est l’inventeur) et qui ne répondent à aucune commande ni même aucune niche. Ils sont issus d’un désir personnel et non professionnel. Cette aventure universitaire apparaît dans l’histoire du mouvement comme une première pierre fondatrice. Le deuxième moment est celui de la diffusion hors les murs des fruits de cette expérimentation pédagogique et des logiques d’émancipation par les technologies numériques.
« Nous voulions explorer les implications et les applications de la fabrication personnelle pour toutes ces parties de la planète qui n’ont pas accès au MIT[9] », explique Neil Gershenfeld pour justifier ensuite l’implantation des premiers « FabLabs » en dehors de l’université. Les premiers élans de ce mouvement sont en grande partie redevables à la National Science Foundation (NSF), qui accorde au Center for Bits and Atoms un soutien financier pour ses recherches. La contrepartie de ce financement implique une valorisation des avancées de leurs travaux sur des terrains plus ordinaires, pour équiper d’autres populations du monde avec les machines testées dans la prestigieuse université. Dès 2002, une première vague de FabLabs voit donc le jour en Inde, au Costa Rica, au nord de la Norvège, dans la ville de Boston et au Ghana, pour un budget de 20 000 dollars en moyenne par atelier. Ces premiers FabLabs ne sont pas alors destinés à être autonomes économiquement, mais entièrement soutenus par le MIT, qui envoie des équipes composées d’étudiants et de chercheurs américains sur le terrain. L’idée qui motive ces équipes est que la « fracture numérique » ne pourra pas se résoudre en expédiant des ordinateurs ou des machines, mais en aménageant directement les conditions de leur fabrication sur place en tenant compte des réalités et des besoins locaux. Le développement des premiers FabLabs s’est ainsi grandement appuyé sur des community leaders, des personnalités déjà impliquées dans le développement et l’animation de communautés locales dans différentes régions du monde. Ces piliers du mouvement ont peu à peu été associés à la démarche. C’est le cas notamment de Kalbag à Pabal en Inde, d’Haakon Karlsen à Lyngen en Norvège ou de Mel King au SETC de Boston.
Le FabLab du Vigyan Ashram (2002) est ainsi greffé à une école rurale, dans un environnement aride, pauvre et avec un accès à l’eau extrêmement réduit. L’école, devenue « FabLab » sur le tard, s’appuie sur les principes de l’apprentissage par la pratique : elle a été construite avec les étudiants, d’anciens enfants ayant abandonné les études dans le circuit classique. L’atelier est devenu peu à peu autonome grâce aux fonds complémentaires récoltés par de petites entreprises développées autour de l’école pour mesurer et localiser les points d’eau. Ils construisent et vendent également des tracteurs montés à partir de carcasses de Jeeps et ont développé des outils de mesure du réseau électrique local. L’instrumentation nécessaire à la gestion de l’eau, de l’électricité, du lait, du riz, des œufs et autres produits de première nécessité leur garantit à long terme une forme d’indépendance.
Le MIT-FabLab Norway (2004) est un autre exemple de FabLab pionnier dont le modèle de fonctionnement est le résultat d’une adaptation à un milieu et à un environnement singulier. Ce FabLab est installé au-dessus du cercle polaire arctique, au cœur d’un fjord, dans une région très peu peuplée. Cet espace, comme le FabLab indien, a été pour une très grande partie financé par le MIT. Les premiers projets qui y ont été développés sont alors pensés en concertation avec les bergers et fermiers locaux, pour résoudre des problèmes d’insémination et de fécondité dans les troupeaux et pour géolocaliser les bêtes lors des transhumances hivernales. Le projet Electronic Shepherd (berger électronique) est ainsi le résultat de l’exploration de différents capteurs, et l’aboutissement du prototypage de dispositifs électroniques parfaitement adaptés aux conditions locales. Autre élément marquant : ce FabLab norvégien, au-delà des activités liées à la fabrication numérique, se présente aujourd’hui comme un tiers-lieu, un community center qui accueille la population locale pour divers événements parfois bien éloignés des technologies numériques : mariages, banquets festifs, formations, réunions amicales…
Les premières ambitions de ces lieux pionniers sont bien caractérisées. Comme cela a été défini plus tôt, elles peuvent aller de la résolution de problèmes environnementaux fondamentaux jusqu’au rassemblement communautaire ou la formation au numérique. Le FabLab South End Technology Center (SETC) à Boston, par son histoire particulière, investit ainsi pleinement la question de la « démocratisation » et favorise des conduites techniques qui reposent sur la mise en commun de compétences, dans une dimension morale, éthique et politique forte. Le FabLab SETC est installé depuis les années 2000 au cœur d’un quartier de Boston essentiellement afro-américain et très populaire. L’engagement politique de Mel King (son fondateur) depuis les années 1970, est visible directement sur les murs du SETC : en lieu et place de la charte des FabLabs, la déclaration universelle des droits de l’homme est affichée en grand, accompagnée de divers posters sur l’égalité entre les races, la place de la femme dans la société, le respect des autres cultures ou religions et l’importance de la transmission entre les générations. Parmi les différents projets qui sont menés dans ce FabLab, le programme Learn to teach, Teach to learn (littéralement « apprendre à apprendre ») est en place depuis plusieurs années et rassemble des jeunes du quartier qui sont incités à valoriser leurs savoir-faire quels qu’ils soient pour proposer bénévolement des formations de tous types. Les projets proposés touchent autant à la musique qu’à l’informatique ou la poésie, en passant bien entendu par l’utilisation de l’imprimante 3D ou la machine à broder numérique.
La nécessité d’établir une charte globale est venue du développement rapide et spontané de nouveaux ateliers un peu partout dans le monde, avec ou sans aide du MIT. « FabLab » n’est pas une marque, mais un réseau d’ateliers qui partagent leurs projets et peuvent s’associer pour diffuser leurs réalisations en s’appuyant sur des équipements semblables : imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse numérique, découpeuse vinyle, etc. Cela facilite la réplication et la circulation de plans, fichiers, algorithmes et modes d’emploi. Tous les lieux n’ont pas strictement les mêmes machines, mais la charte établit que tous doivent pouvoir partager leurs projets.
En décembre 2015 se tient à Paris la Conférence Mondiale sur les Changements Climatiques, baptisée COP 21 (pour Conference of Parties). À cette occasion et en amont de ce rendez-vous international, une résidence internationale de makers est organisée au mois d’août 2015 au Château de Millemont, dans les Yvelines, à 54 kilomètres de Paris.
Au cœur d’un domaine de 600 hectares, une imposante bâtisse accueille pendant cinq semaines une centaine de makers, designers, ingénieurs et bricoleurs avec pour objectif la finalisation de douze projets liés à la transition écologique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette résidence est à l’initiative de deux associations, Ouishare, un think-tank qui développe des projets liés à l’économie collaborative, et OpenState, un collectif allemand de designers et de créateurs. Le nom de POC 21 est évidemment un pied de nez à la COP 21 et correspond à l’acronyme de « Proof of Concept », ou « preuve de faisabilité », une expression employée dans les milieux techniques et scientifiques pour qualifier l’étape qui suit l’élaboration d’un prototype. L’idée principale qui guide les acteurs de POC 21 est de prouver aux pouvoirs publics, lors d’une exposition installée à la suite de ce mois de prototypage, que des solutions concrètes peuvent « venir d’en bas ».
Douze équipes ont été sélectionnées sur les deux cents qui ont répondu à un appel à projets lancé durant l’hiver 2014. Les projets sont variés : tracteur à pédales, système de récupération d’énergie solaire en open source, dispositifs pour filtrer l’eau, éoliennes, solutions pour favoriser l’autonomie alimentaire… Tous les participants sont convaincus, selon la formule énoncée dans le teaser de l’événement, que « le futur dont nous avons besoin est entre nos mains ».
Cette expérience originale synthétise de nombreuses questions liées à un moment charnière dans lequel les futurs de la production, des institutions politiques, de notre système de consommation doivent être réinventés. Le mouvement culturel à l’origine du développement de lieux comme les FabLabs (et autres makerspaces) ou comme la résidence POC 21, visent à transformer, par l’action et par la pratique, les scénarios habituels de fabrication, de consommation, d’apprentissage, en s’appuyant sur un principe de libre accès aux outils et aux savoirs.
Le mouvement maker, dans une perspective « post-numérique », synthétise ainsi de nombreux enjeux, valeurs et promesses : autonomie, indépendance, autoproduction, production locale, décentralisation, démocratie réinventée, prise de conscience écologique, fin de l’obsolescence programmée, réemploi… Toutes ces annonces reposent sur l’idée déjà esquissée par André Gorz, théoricien de l’écologie politique et de l’écosocialisme, d’un collectif citoyen émancipé des grandes institutions politiques, donc en capacité de maîtriser des outils techniques pourtant complexes. Dans « La sortie du capitalisme a déjà commencé », il décrit déjà une société fondée sur des « ateliers communaux », dans laquelle les développements de la technique sont à la portée de citoyens pleinement impliqués dans la construction et la production de leurs environnements :
« Les outils high-tech existants ou en cours de développement, généralement comparables à des périphériques d’ordinateur, pointent vers un avenir où pratiquement tout le nécessaire et le désirable pourront être produits dans des ateliers coopératifs ou communaux ; où les activités de production pourront être combinées avec l’apprentissage et l’enseignement, avec l’expérimentation et la recherche, avec la création de nouveaux goûts, parfums et matériaux, avec l’invention de nouvelles formes et techniques d’agriculture, de construction, de médecine, etc. Les ateliers communaux d’autoproduction seront interconnectés à l’échelle du globe, pourront échanger ou mettre en commun leurs expériences, inventions, idées, découvertes. Le travail sera producteur de culture et l’autoproduction un mode d’épanouissement[10] ».
Différentes initiatives se sont développées depuis une dizaine d’années avec pour objectif de parvenir à une autonomie énergétique et alimentaire. Le projet Open Source Ecology[11] , qui précède de quelques années l’initiative de la communauté de POC 21, est un exemple éloquent de cet élan vers l’open hardware, qui recoupe aussi une quête d’autonomie et de décroissance.
Depuis 2009, l’Atelier Paysan[12] est un collectif à but non lucratif qui propose des cours et des plans pour permettre aux agriculteurs de construire eux-mêmes les outils dont ils ont besoin. Ce projet a une dimension politique, puisqu’il s’agit, pour les agriculteurs qui rejoignent le mouvement, de « ne plus dépendre des géants de l’industrie ». Une cinquantaine de plans sont disponibles en ligne sous des licences Creative Commons et une vingtaine de machines sont encore en cours d’élaboration.
Les expériences d’ateliers autonomes, qu’on les appelle FabLabs, hackerspaces, makerspaces, ateliers collectifs ou communaux, qu’ils soient implantés physiquement et durablement dans une ville ou éphémères comme POC 21, révèlent une quête, ou une conquête d’autonomie. Les points communs de ces espaces, malgré leur diversité, tiennent à une volonté partagée de reprendre en main une activité de production ou de fabrication en dehors de toute hiérarchisation des tâches, sans spécialisation de compétences, dans un espace de liberté propice à l’expérimentation. L’attention accordée à une forme singulière d’apprentissage par la pratique et les promesses incarnées par les logiques d’organisation non hiérarchisées ouvrent également la voie à une nouvelle conception de la production. Celle-ci se construit en opposition à une production et à une consommation de masse et définit une autre relation au collectif. Un discours de rupture avec le monde industriel contemporain émerge donc depuis plusieurs années.
Le chercheur en droit Yochai Benkler, au tournant des années 2000, a été l’un des premiers à affirmer que nos modes de production ne sont plus cantonnés à cette séparation traditionnelle entre les entreprises et le marché[13] . Au lieu de cela, il estime qu’une nouvelle manière de faire qu’il appelle « commons-based production », c’est-à-dire une production fondée sur des communs, pourrait prendre de plus en plus de place dans le paysage économique actuel. Cela implique une coordination qui ne dépendrait ni de la demande, ni de l’offre, mais qui reposerait sur des contributions volontaires à des ressources communes. Ce mode de production, selon Yochai Benkler, repose sur la baisse des coûts de transaction rendue possible par le développement d’Internet. En se penchant sur les fonctionnements des systèmes de production entre pairs – comme le logiciel libre, Wikipedia ou d’autres projets – il conclut qu’Internet a non seulement facilité les collaborations mais qu’il a permis une forme de distribution du travail qui repose sur plusieurs niveaux, depuis le cercle réduit des contributeurs hyper actifs à la masse plus large de ceux qui renseignent occasionnellement certaines informations, jusqu’aux utilisateurs quotidiens de ce type de projet. Dans la lignée des travaux du juriste Lawrence Lessig et en accord avec ses recherches, Yochai Benkler affirme donc que dans de telles circonstances, la propriété intellectuelle (qui est l’un des fondements du capitalisme) fait de plus en plus obstacle à la force productive. L’open source hardware qui se développe dans le sillage du logiciel libre se traduit, selon lui, par la collaboration de milliers de bénévoles pour produire des « communs » conçus par la force de productions entre pairs, latérales et complexes. Selon Yochai Benkler, la production de pair à pair repose sur quatre critères qui découlent de l’économie du Web : le partage des plans et instructions de fabrication, la baisse des coûts de fabrication grâce à la production directe à la demande, la reconnaissance du « talent créatif » propre à chacun et l’échange d’informations[14] .
L’exigence de « documentation » est inscrite dans l’ADN du mouvement des FabLabs. C’est un impératif qui favorise le partage de savoirs, de dessins ou de plans de fabrication. Chaque FabLab est chargé de manière informelle de tenir à disposition de tous un site ou un Wiki en ligne sur lequel les données, plans, explications et détails de chaque étape de projet sont recensés, quelle que soit la nature de ces réalisations. Cette règle implique de manière plus ou moins implicite que l’accès libre ou à un coût réduit à l’ensemble des ressources du FabLab se paie en contrepartie par un partage des projets qui y sont menés afin qu’ils puissent être reproduits ou « forkés », c’est-à-dire prolongés et modifiés par d’autres.
Dans un contexte de fermeture institutionnelle, les ateliers de fabrication collectifs et les pratiques d’un design « ouvert », mis en partage et potentiellement appropriable par tous ouvrent une espérance. L’énergie émancipatrice qui guide les designers, makers et ingénieux bricoleurs de la résidence POC 21 tient à une vision critique de la manière dont les questions environnementales sont prises en charge et administrées par l’État et les gouvernements. À l’heure où ce texte est écrit, des collectifs de makers se coordonnent à une grande échelle pour produire de manière locale et à la demande une grande quantité de masques de protection contre le Covid-19, pour équiper à la fois les particuliers, mais aussi les soignants et le personnel hospitalier, afin de contrer la pénurie nationale d’équipements techniques de ce type.
En remettant entre les mains des personnes concernées les questions qui les concernent collectivement, ce type de pratiques suppose un espace public vivant, à un niveau global et local, pour repenser des intérêts communs (liés à la gestion de l’énergie, des ressources naturelles, de l’alimentation, des façons de produire et de consommer).
Ce type d’organisation et de lieux supposent que les citoyens accèdent à la connaissance d’outils et de techniques essentielles, nécessaires à leur survie, pour ne plus dépendre exclusivement des grandes puissances industrielles ou institutionnelles qui ont fondé nos milieux de vie. Une culture commune s’affirme peu à peu dans les ateliers collectifs de fabrication numérique comme les FabLabs, qui touche à des pratiques de conception que l’on pourrait souvent qualifier de vernaculaires, car issues de savoirs communs, populaires, partagés, dans une visée souvent subversive ou en tout cas alternative : fabriquer soi-même son masque de protection, inventer des outils agricoles à fabriquer soi-même, concevoir un système local d’irrigation et de stockage de l’eau (comme au Vigyan Ashram) mettre en place un dispositif pour géolocaliser les troupeaux de bêtes (comme au MIT-FabLab Norway) réparer un objet cassé, inventer soi-même sa propre imprimante 3D à partir de plans diffusés en open source, toutes ces démarches hétéroclites témoignent d’ « une forme d’attention – et d’intention – à ce qui est déjà là[15] ». Dans un contexte écologique et économique de plus en plus fragile, les pratiques amateurs qui sont encouragées par la diffusion des outils de conception et de fabrication numériques doivent s’associer à une forme de frugalité, d’économies de moyens, de travail à partir de l’existant[16] au lieu de produire des nouveautés et gadgets inutiles.
Des solutions high tech complexes sont développées et se multiplient pour tenter parfois de répondre à ces enjeux, mais elles sont souvent avides de ressources rares et non renouvelables, non résilientes car peu résistantes aux perturbations susceptibles de se produire (rupture d’approvisionnement en matières premières, pannes, besoins de maintenance, etc.). La question de l’économie des ressources et les incertitudes qui pèsent sur le système industriel actuel poussent les sociétés contemporaines à se réinventer. La diffusion des outils numériques et les pratiques locales et collectives qu’elle encourage indirectement sont un terrain fertile pour donner place à une conception « ouverte » du design. L’open source et plus généralement les valeurs du libre sont des piliers importants du développement des pratiques de fabrication numérique liées au mouvement maker, puisqu’ils définissent de nouveaux espaces pour la propriété intellectuelle et la création. À l’heure actuelle, différents projets, collectifs de designers ou groupes de recherche expriment le besoin de requalifier leurs pratiques en plaçant leur démarche sous la bannière de l’open design, du méta-design, du design participatif, du co-design[17] , du design durable, du design éco-responsable, du design social, de l’éco-design, voire du design écosocial[18] , etc. Ces différentes appellations ne sont que des symptômes tâtonnants d’une extension possible des pratiques déjà protéiformes de ce qui est traditionnellement appelé « design ». Ces tentatives de description pourraient en inclure d’autres encore : design vernaculaire, design libre[19] , design décentralisé, design low tech, design des communs, design convivial, design de la sobriété, design frugal, design distribué, design non standard… La piste d’un design « post-numérique », qui guide cet ouvrage et ce texte, ouvre encore une perspective de rediscussion des champs et modalités d’action du design, alors pensé comme un scénario original de conception, de fabrication, de production et de diffusion ; comme un outil, un moyen qui redéfinit de nouveaux rôles et de nouvelles situations de collaboration.
La crise sanitaire du Covid-19, qui a frappé le monde au printemps 2020, semble avoir favorisé et encouragé des solutions économiques qui n’étaient pas ou peu valorisées jusque-là. Les pratiques liées à l’impression 3D, à l’open source, au DIY et à la relocalisation de la production ont ainsi connu une activité très importante pour faire face à la pandémie. Les communautés de hackers, de makers, petites entreprises, couturiers ou chercheurs indépendants ont rapidement déployé différentes plateformes pour partager des plans de masques, de visières ou de ventilateurs, mais aussi des outils de visualisation de données ou de modélisation moléculaire. La carte interactive Covid-Initiatives[20] répertorie ainsi les différents sites de production citoyenne auto-organisée. En deux semaines, 100 000 visières ont été produites par impression 3D ou découpe laser, ainsi que des protections faciales, des connecteurs pour les dispositifs de ventilation, des pousse-seringues, des systèmes anti-contamination pour ouvrir des portes ou désinfecter, etc.
À Pantin, le Club Sandwich Studio (un studio de design) lance ainsi en avril 2020 le M.U.R[21] , Minimal Universal Respirator, un dispositif de respiration artificielle d’urgence « peu onéreux et facilement reproductible », qui repose sur l’utilisation « de composants accessibles au plus grand nombre ». Différents tests ont été réalisés et le projet, décrit comme « une initiative humaniste et désintéressée », est entièrement documenté sur GitHub, sous licence libre. Ce contexte inédit d’urgence sanitaire immédiate bouscule également les logiques de brevets et de protection des innovations : Decathlon, pour suivre le mouvement et contribuer à l’élan de détournement de son modèle de masque de plongée Easybreath, a d’abord bloqué la vente pour le grand public pour donner la priorité au personnel soignant, mais aussi partagé les plans et les informations techniques.
Le vendredi 3 avril 2020, un parc de soixante imprimantes 3D est installé par l’AP-HP dans l’hôpital Cochin pour produire des pièces et modèles pour les masques et les respirateurs. Le réseau « Covid3D[22] » va également dans le sens de cette démarche, en recensant les professionnels au contact du public et les bénévoles pour la création et la distribution de matériel de protection. Cette solution de « relocalisation » complète de la fabrication de ces éléments techniques permet de ne pas dépendre de chaînes d’approvisionnement étrangères et de contourner la pénurie pour ces équipements. Ce type de production pose évidemment des questions de certification et de labelisation mais est riche d’enseignements.
Le chercheur, designer et pédagogue Victor Papanek, dans son ouvrage Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social[23] publié en 1974, fait la preuve d’une capacité d’anticipation étonnante quant aux missions du design dans un contexte environnemental, industriel, économique et social fragilisé. Dans la préface, il écrit :
« Au siècle de la production de masse, où tout doit être planifié et étudié, le design est devenu un outil à modeler des outils, qui permet à l’homme de transformer son environnement et, par extension, la société et sa propre personne. Cela exige de la part du designer un sens aigu des responsabilités morales et sociales, et une connaissance plus approfondie de l’homme ; le public, quant à lui, doit parvenir à une perception plus fine du processus de design[24] ».
Cet ouvrage, traduit dans une vingtaine de langues, met à jour une vision critique du métier des designers, qui se considèrent la plupart du temps « comme des maîtres stylistes [et] ne s’interrogent jamais sur l’aide qu’ils apportent à un système qui tend à exploiter et duper la population[25] ». À l’inverse, Victor Papanek défend la possibilité pour le design d’aborder des problèmes réels en acceptant de devenir un « outil entre les mains du peuple », avec pour mission d’« attirer l’attention des fabricants, des agents du gouvernement, etc., sur les besoins réels des gens[26] ». Il affirme, dans ce sens, que « les hommes sont tous des designers. La plupart de nos actes se rattachent au design, qui est la source de toute activité humaine[27] ». Dans les derniers moments de cet ouvrage, Victor Papanek propose ainsi de créer des centres d’expérimentation qui seraient des « organisation[s] à but non lucratif », qui réuniraient des équipes interdisciplinaires pour examiner des problèmes environnementaux, techniques et sociaux contemporains. Ces laboratoires seraient pensés autour de la notion de « partage communautaire[28] ». Ne peut-on pas penser que Victor Papanek esquisse ici les contours des ateliers collectifs en réseau que sont les FabLabs et autres tiers-lieux de fabrication ouverts à tous et « pour tout faire » ?
[1] La société dite « post-industrielle » se caractérise par la subordination des éléments matériels (matières premières et machines) à des éléments immatériels (connaissance et information) dans l’organisation sociétale. Le modèle « post-industriel » dépasse le paradigme de la société industrielle de façon radicale. Une société décrite comme « hyperindustrielle » suppose que l’industrie n’est pas en régression mais que seule sa localisation géographique évolue, dans les pays dits émergents. Cette réorganisation se réalise dans le cadre de la révolution numérique et s’appuie sur la convergence entre industrie et services.
[2] Camille BOSQUÉ, La fabrication numérique personnelle, pratiques et discours d’un design diffus. Enquête au cœur des FabLabs, hackerspaces et makerspaces, de 2012 à 2015, thèse en Esthétique et design, sous la direction de Nicolas Thély, soutenue en janvier 2016 à l’Université Rennes 2.
[3] Neil GERSHENFELD, Fab. The Coming Revolution on Your Desktop – From Personal Computers to Personal Fabrication, New York, Basic Books, 2005.
[4] Camille BOSQUÉ, « Des FabLabs dans les marges : détournements et appropriations », Journal des Anthropologues, n° 142-143, Marges et Numérique, 2015, pp. 49-76.
[5] Une preuve de concept (de l’anglais : proof of concept, POC) ou démonstration de faisabilité, est une réalisation expérimentale concrète et préliminaire, courte ou incomplète, illustrant une méthode ou une idée afin d’en démontrer la faisabilité. Située très en amont dans le processus de développement d’un produit nouveau, la preuve de concept est habituellement considérée comme une étape importante avant la réalisation d’un prototype pleinement fonctionnel.
[6] GERSHENFELD N. , Fab. The Coming Revolution on Your Desktop – From Personal Computers to Personal Fabrication, op. cit., p. 55.
[7] Ibid.
[8] Camille BOSQUÉ, Cindy KOHTALA, « The Story of MIT-Fablab Norway: Community Embedding of Peer Production », Journal of Peer Production, 2014.
[9] GERSHENFELD N., Fab. The Coming Revolution on Your Desktop – From Personal Computers to Personal Fabrication, op. cit., p. 12.
[10] André GORZ, Ecologica, Paris, Éditions Galilée, 2008, pp. 40-41.
[11] Le projet Open Source Ecology est en ligne ici : http://opensourceecology. org/about-overview (consulté le 29 février 2019).
[12] https://www.latelierpaysan.org/
[13] Yochai BENKLER, « Coase’s Penguin, or Linux and the Nature of the Firm », Yale Law Journal, Vol. 112, n°3, 2002, p. 404.
[14] Ibid.
[15] Édith HALLAUER, « Vers un designer permanent », in L. DUHEM et K. RABIN (dir.), Design écosocial : convivialités, pratiques situées et nouveaux communs, Faucogney-et-la-Mer, Éditions It:, 2018, p. 95.
[16] Precious Plastic, par exemple, est une communauté qui travaille depuis 2013 à la conception et à la diffusion de machines en open source capables de « transformer les déchets en plastique en ressource ». Ce projet, fondé par Dave Hakkens, a pour objectif de permettre à chacun de recycler lui-même, localement, son plastique. Les différentes machines qu’il a conçues permettent de déchiqueter, fondre, mouler, extruder du fil, pour concevoir de nouveaux objets.
[17] Ezio MANZINI, Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation, MIT Press, 2015.
[18] Ludovic DUHEM, Kenneth RABIN(dir.), Design écosocial : convivialités, pratiques situées et nouveaux communs, Faucogney-et-la-Mer, Éditions It:, 2018.
[19] Le designer Christophe André milite depuis 2008 au sein du collectif Entropie pour un « design libre » et tend à « démocratiser la technique en levant l’abstraction sur les objets qui nous entourent » : https://www.asso-entropie.fr/fr/design-libre/manifeste-du-design-libre/
[20] Lien vers la cartographie : https://covid-initiatives.org/la-demarche
[21] Lien vers le projet : https://www.mur-project.org/
[22] https://www.covid3d.fr/
[23] Victor PAPANEK, Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social, Paris, Éditions Mercure de France, 1974.
[24] PAPANEK V., Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social, op. cit., p. 24.
[25] Ibid., p. 136.
[26] Ibid., p. 133.
[27] Ibid., p. 31.
[28] Ibid., p. 359.