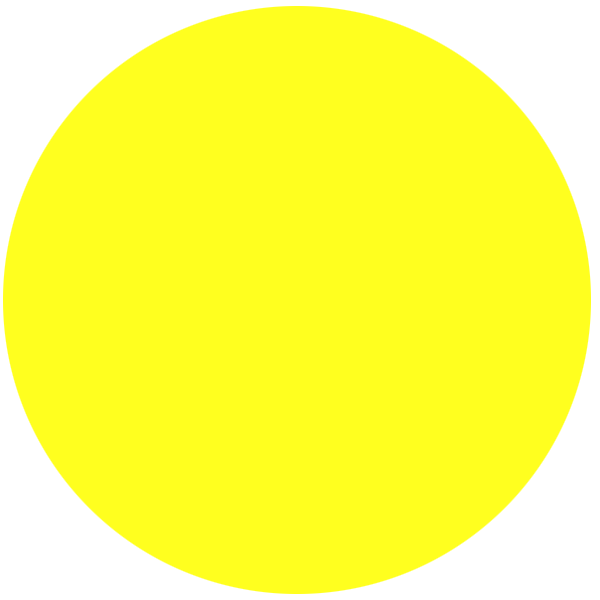

—
Résumé
Face aux enjeux planétaires de la crise écologique mondiale, le design a pris ses responsabilité depuis plusieurs décennies à travers la pensée et les projets de grandes figures historiques. Mais le graphisme quant à lui manque encore d’une dynamique et d’un support apte à fédérer des initiatives éparses pour former un mouvement et même une culture du sustainable graphic design. L’engagement du graphisme sur sujet a eu lieu dans les années 1990 et début 2000, aux États-Unis, elle peine à s’imposer en Europe et surtout en France. Le principal problème est la prise de conscience de l’impact écologique du design graphique dans ses réalisations et son évaluation précise dans sa forme imprimée comme dans sa forme en ligne. Nous disposons pourtant de toutes les données nécessaires pour changer les pratiques en développant une écoconception en design graphique. C’est d’ailleurs une véritable opportunité pour la création plutôt qu’ensemble de contraintes qui en restreignent les possibilités. Mais il faut plus qu’une transformation par réglages pour répondre aux défis actuels, il faut une transformation majeure.
Texte écrit en 2021 pour compléter les actes du colloque « Les écologies du numérique » organisé par l’Ésad Orléans (ÉCOLAB) en 2017 et 2018.
—
Mots clé
Design, graphisme, écologie, impact, livre, écran
—
Biographie
Roxane JUBERT
Roxane Jubert est enseignante-chercheuse, graphiste et typographe. Elle enseigne à l’ENSAD, et intervient ponctuellement à l’Université Paris-Sorbonne. Ses publications sont consacrées à l’histoire et à la culture du graphisme et de la typographie, dans une perspective trans historique et contemporaine, traversée par de grands axes tels que leur inscription dans les arts visuels, les avant-gardes, ou les enjeux relevant des défis écologiques. Son principal ouvrage est publié en 2009 aux éditions Flammarion sous le titre Graphisme Typographie Histoire (Typography and Graphic Design, From Antiquity to the Présent).
Elle a coécrit, avec des collègues de l’ENSAD, le Manifeste pour une pratique soutenable de la création (Manifesto for Sustainable Practices in Creative Activities), mis en ligne en 2021 : www.manifeste.ensad.fr.
Liste des publications : https://www.ensadlab.fr/wp-content/uploads/2015/09/Publications_Roxane_Jubert_07_17.pdf
Le contexte socio-écologique global actuel implore une transformation drastique des façons de penser, de vivre, de voir, de se comporter, de produire, de consommer et de partager. Au-delà d’un objectif, la soutenabilité procède d’un faisceau d’impératifs. Par-delà un (r)éveil des consciences, la situation en appelle à un ressaisissement et à un sursaut agissants. Certains secteurs de la création et du design ont pris les devants, parfois de longue date[1]. Que ce soit le designer Victor Papanek à travers la seconde moitié du vingtième siècle, ou l’architecte Philippe Madec[2] depuis plusieurs décennies, certains créateurs ont délibérément œuvré dans le sens de la durabilité et de la frugalité, montrant le chemin d’une approche véritablement critique, et sans craindre de remettre en question les cadres établis. « Une partie de notre travail doit être consacrée à protéger l’avenir[3] » : ainsi se termine l’appel d’un collectif soutenant les jeunes et la mobilisation mondiale pour le climat – un texte de septembre 2019, signé par des personnalités de nombreux pays (dont Valérie Cabanes, Noam Chomsky, Naomi Klein, Bruno Latour et Vandana Shiva). Un autre appel, publié en mai 2020 et signé de « 200 artistes et scientifiques », synthétise la situation : « le consumérisme nous a conduits à nier la vie en elle-même […]. La pollution, le réchauffement et la destruction des espaces naturels mènent le monde à un point de rupture. […] La transformation radicale qui s’impose – à tous les niveaux – […] n’aura pas lieu sans un engagement massif et déterminé[4] ».
Autant d’appels exhortant à rejoindre l’action. Aborder avec lucidité et responsabilité ces immenses enjeux de notre époque constitue une source extraordinaire de réflexion aussi bien que de stimulation et de motivation. Une telle orientation ne peut qu’apporter du sens à nos parcours, en ces temps de disruption où se font face surabondance matérielle et destructions planétaires, opulence et désastres. Dans ce contexte si gravement inégalitaire, l’essentiel de ce qui relève de la création, de la conception ou de la production de formes et d’objets (du timbre-poste à l’architecture, et bien sûr l’art), ainsi que de services, se trouve diversement concerné par la matérialité et les problématiques qui en découlent. Nombre de champs d’activité se sont préoccupés de cette dimension fondamentale, parfois depuis plusieurs décennies, dans la foulée du déploiement de la conscience écologique accrue dans les années 1970. L’architecture, l’urbanisme, le design d’objet, le textile ou encore le vêtement œuvrent en ce sens, à divers degrés. Le design graphique, englobé dans le grand ensemble de la communication visuelle, bénéficie tout à la fois d’initiatives éparses, de publications pour partie en langue anglaise, d’avancées et de mesures tangibles sur le plan de la production, ainsi que de questionnements de plus en plus nombreux et pressants formulés par les étudiants comme jamais auparavant[5]. Pour autant, cette discipline reste en attente d’une dynamique et d’un support aptes à fédérer ces énergies et à les étoffer jusqu’à constituer un mouvement et une culture du sustainable graphic design [graphisme soutenable, à défaut de terme ad hoc].
Pour le demi-siècle écoulé, Victor Papanek compte parmi les précurseurs qui ont vigoureusement réclamé un design tout à la fois écologique et social. En atteste le titre de son ouvrage Design for the Real World. Human Ecology and Social Change [Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social], originellement publié en suédois en 1970. Soulignant l’extrême importance de la prise en compte des équilibres écologiques, de la limitation des ressources, des matériaux (dont les métaux) et de l’extractivisme minier[6], il affirme que « nous commençons à comprendre que le principal défi pour notre société ne réside plus dans la production de biens[7] ». Selon lui, ces considérations devraient conduire « les designers [à] refuser toute participation à un projet qui soit destructeur biologiquement ou socialement (que cela [cet impact] soit direct ou pas n’a aucune importance)[8] ». Fort de ses convictions, Papanek délivre un message clair, exigeant, fondé et argumenté tout au long de l’ouvrage. Si le champ du graphisme ne semble pas avoir bénéficié d’auteur comparable, tout au moins pour l’époque ou pour ce que l’on en sait, il n’empêche qu’une telle optique (pour peu que l’on en partage la teneur, ne serait-ce que partiellement) peut aisément s’appliquer à la communication visuelle. Le défi n’a fait que croître depuis lors – aussi bien avec l’expansion de la surproduction et celle, corrélative, de la communication, qu’avec l’arrivée et le déploiement des technologies numériques.
De fait, ces préoccupations deviennent tangibles dans les écrits consacrés au graphic design à partir de la fin des années 1990, souvent par le truchement du terme « environnement ». Une version revue et augmentée du vibrant manifeste britannique First Things First (dédié au graphisme et à la communication visuelle, initialement publié en 1964) précise ainsi que « des crises environnementales, sociales et culturelles sans précédent requièrent toute notre attention » (republié en 1999, entre autres en couverture de la célèbre revue Emigre). Cela n’a pu échapper à une partie de la profession, d’autant que cette version augmentée a paru dans au moins sept revues (Allemagne, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne et Pays-Bas), et qu’elle se trouve alors signée d’une bonne trentaine de noms du graphisme occidental, dont beaucoup de personnalités (parmi lesquelles Irma Boom, Sheila Levrant de Bretteville, Gert Dumbar, Ken Garland, Milton Glaser, Steven Heller, Zuzana Licko, Ellen Lupton, Katherine McCoy, Rick Poynor, Erik Spiekermann ou encore Rudy VanderLans). Différentes publications étasuniennes montrent qu’il y a eu, à l’approche du millénaire, une percée de ces sujets (parfois seulement évoqués) concernant la communication graphique. Ainsi de l’article « Ecological Design: A New Critique » de Pauline Madge – publié en 1997 dans un numéro de la revue Design Issues intitulé « A Critical Condition: Design and Its Criticism » [Une situation critique : le design et sa critique] –, explicitant d’emblée la situation : « cela fait maintenant environ une décennie que la première vague du design vert [green design] est apparue comme un nouveau facteur important dans le design produit et le design graphique. […] il existe désormais un large consensus sur le fait que les problématiques environnementales ne peuvent plus être ignorées des designers et des critiques[9] ».
Le temps presse, comme l’illustre bien le logotype en forme de sablier cerclé, ultra-schématisé, du récent mouvement international Extinction Rebellion. Au vu de la situation planétaire et de l’étendue des connaissances relatives à l’écologie, à l’environnement, à l’anthropocène, à l’effondrement, au climat, à l’extractivisme, aux ressources ou encore à la biodiversité (journalisme d’investigation, recherche, rapports, etc. – grâce à un engagement partagé par de nombreux champs de compétences), il ne s’agit plus, en France, de savoir si la question écologique concerne ou non le graphisme, mais de comprendre, sinon rejoindre, la démarche de celles et ceux qui se demandent que faire (donc que ne pas faire, que ne plus faire, que pouvoir faire, que devoir faire, etc.), et qui y espèrent, y cherchent ou y apportent des réponses. Certaines personnes ou organismes œuvrent en ce sens pour ce qui relève de la communication visuelle et graphique : professionnels, étudiants, enseignants, chercheurs, organismes, collectifs, etc. Leurs contributions et actions sont d’autant plus méritantes qu’elles retiennent peu l’attention, quand bien même elles incarnent une approche essentielle. Un effort d’agrégation de ces volontés, ces idées, ces savoirs, ces expériences et ces pratiques reste une priorité forte, en vue de leur partage et de leur diffusion. Il y aurait lieu de faire un point sur la contribution française en ces matières, spécifiquement du point de vue du graphisme, afin d’en avoir une meilleure visibilité. Rappelons au passage que, jusqu’aux alentours de 2000, l’histoire du design graphique (et plus encore typographique) était peu explorée et représentée en France – un état de fait à prendre en compte pour ce qui est des grands équilibres et articulations entre, d’une part, la conscience des enjeux contemporains les plus aigus et la projection dans l’avenir, et d’autre part la vision transhistorique et la compréhension du temps long.
Si une minorité œuvre à un graphisme soutenable, une telle quête ne va pas de soi et, à vrai dire, suscite encore beaucoup d’incompréhension, tant cette vision se situe loin des normes (formes, matériels, codes, repères, etc.). La question écologique n’est en effet pas inscrite comme telle dans la culture (dont l’histoire) établie et partagée du design graphique occidental. La situation ne manquant pas de paradoxe, l’histoire du livre imprimé en Occident se trouve, dès ses débuts, traversée par la recherche d’économie d’espace – donc de matière, de matériel, de temps, d’énergie, etc. –, un objectif qui concernera fortement la presse papier, ce qui se répercute, entre autres, sur le dessin de caractère (par ailleurs, l’introduction du dessin de l’italique, au sortir de la période des incunables, fait déjà preuve d’une économie spatiale du fait de sa faible chasse). Tout cela rend ces problématiques plus intéressantes et plus importantes encore. Il y a assurément mille manières d’entrer dans ces sujets ou de les travailler. Elles peuvent aussi bien concerner les implications matérielles du graphisme que sa faculté inhérente à mettre en forme contenus et messages, qui lui confère un précieux potentiel d’expression. Se pose aussi, inévitablement, la question de l’inscription du graphisme dans un environnement souvent saturé de communication visuelle, imposant une sursollicitation abusive – ce qui renvoie directement à la matérialité.
La compréhension des déséquilibres et dérèglements actuels passe par un certain nombre de notions essentielles, telles que l’impact environnemental, le cycle de vie ou l’empreinte écologique. La matérialité des objets, y compris graphiques, mène à s’interroger sur leurs impacts et sur tout ce qui sous-tend leur production. Qui se penche sur ces questions mesure qu’il y a là une thématique majeure, bien que d’arrière-plan. Documentés, instructifs et incontournables, les travaux, investigations et émissions sur ces sujets ne manquent pas, allant jusqu’à employer les termes « face cachée » et « pollution cachée », parfois dès leurs titres[10], ou bien encore « coût caché environnemental et social[11] » – ce qui met en lumière une certaine opacité. Bien qu’étudiés depuis un certain temps, ces problèmes ne sortent que progressivement de l’ombre, mettant au jour de lointains processus d’extraction, de transformation, d’exploitation, de pollution, de déplacement, de dégradation, de délocalisation, etc.
Qu’il donne lieu à une production graphique matérialisée ou à un affichage passager sur écran (relevant d’une autre chaîne matérielle), le graphisme ne saurait être un segment indépendant dans le cycle de vie des objets, qui serait disjoint de l’avant et de l’après : il s’inscrit dans des processus, des systèmes, des chaînes matérielles, des ensembles et des milieux, ainsi que dans des champs perceptifs. Si le design présente une avance certaine dans la prise en compte de ces réalités, l’application de telles préoccupations au design graphique se montre plus affirmée au fil du temps, venant surtout de l’étranger. Dans son ouvrage Green Graphic Design (2008), Brian Dougherty soutient, en conclusion, que « les designers graphiques ont un rôle essentiel à jouer dans la transformation plus vaste vers des économies soutenables[12] ». Malgré la rareté de livres en langue française traitant des implications environnementales associées au graphisme, nous disposons d’un nombre croissant et consistant de publications intéressant fortement cette pratique, que ce soit de façon directe ou indirecte – depuis les rapports détaillés consacrés aux impacts de l’édition jusqu’aux études, de plus en plus nombreuses, fouillant ces questions sur l’immense terrain du numérique et des technologies de l’information et de la communication (les TIC), découvrant leur réalité parfois terrible[13].
Cet ensemble disponible d’informations, d’analyses, de recherches et d’investigations apporte à la communication visuelle un angle de vue irremplaçable, aussi bien sur des sujets en prise directe avec le graphisme que sur des aspects généraux concernant de nombreux secteurs d’activité. Ainsi pouvons-nous lire sous la plume de l’ingénieur Philippe Bihouix, dans un numéro de 2017 de la revue Esprit, qu’« il n’y a pas de solution technique permettant de maintenir – et encore moins de faire croître – la consommation globale d’énergie et de ressources. […] nous nous heurterons tôt ou tard aux limites planétaires, régulation climatique en tête. C’est donc – aussi – vers l’économie de matières qu’il faut orienter l’innovation. Avant tout par la sobriété […][14] ». L’une des difficultés de ces problèmes est qu’ils se prêtent mal à la demi-mesure ou aux approches superficielles : ils nécessitent des remises en question profondes et radicales. Toujours en 2017, le BASIC (Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne) produit une étude approfondie intitulée Un Livre français. Évolutions et impacts de l’édition en France, donc concernant aussi la production graphique. Ce document signale que « dans sa configuration actuelle, la filière du livre génère des impacts importants sur les plans socioéconomique et environnemental[15] », prenant en compte la part supportée par les pays étrangers. Il précise que l’« un des points marquants de l’étude est l’ignorance, de la part des professionnels comme des citoyens, des impacts liés à la consommation de livres, en partie en raison de l’absence de traçabilité de la matière première[16] ». Cela donne un aperçu de l’exigence et de la complexité de ces approches. La compréhension des mécanismes et processus à l’œuvre n’en apparaît que plus importante, y compris pour irriguer les contextes pédagogiques[17].
Pour le graphisme, prendre en compte les conséquences des grands flux matériels représente un chantier d’ampleur, qui nécessite un engagement particulier et une forte humilité. Plutôt qu’un simple choix, il s’agit de se résoudre à l’intérêt supérieur d’une nécessité. Accepter de nous astreindre en nous assignant des limites ne va pas de soi : cela suppose de nouveaux regards, concernant tout à la fois le présent, le futur et le passé. Jusqu’à l’arrivée de l’informatique dans la profession, à partir du milieu des années 1980, malgré les évolutions techniques, la création graphique comportait encore une très forte part manuelle et artisanale. Elle se constituait de la succession de nombreux savoir-faire, depuis les esquisses et tracés à main levée, ainsi que les facultés de conception qui y sont liées, jusqu’à la réalisation et la fabrication de maquettes – le tout nécessitant toutes sortes de matériels et de techniques des beaux-arts et des arts appliqués : instruments et outils d’écriture, de dessin, de calligraphie, de traçage et d’affûtage (dont tire-ligne, calames, stylos de précision de l’ordre du dixième de millimètre), papiers de toutes sortes et cartons, plioirs, calques et rhodoïds, tout ce qui relève de la couleur (supports, surfaces, encres, crayons, feutres, peinture, aquarelle et pigments), stylets, planches à découper, pinceaux et brosses, compas, règles, équerres, rapporteurs, perroquets, normographes, lettres-transfert, carte à gratter, aérographe, etc. – sans oublier la photographie argentique et son développement, le banc de reproduction, la table lumineuse, les grands cartons à dessin pour le format raisin, et bien d’autres matériels, outils ou micro-outils, objets, instruments, appareils et machines qui composaient le quotidien du graphiste. L’essentiel de tout cela a disparu, engloutissant au passage une partie des savoir-faire et des méthodes de conception qui y étaient associées – le tout largement remplacé par les écrans, les interfaces graphiques, les icônes, les logiciels, les claviers, la photographie numérique, les imprimantes, les supports de stockage, etc. La pratique a ainsi considérablement changé, tout en se poursuivant dans l’association des supports papier et numérique. Outre ces deux grands hémisphères, la communication graphique peut aussi – selon les projets, et toujours du point de vue de sa matérialité – se trouver concernée par d’autres types de supports (pour la signalétique [panneaux, marquages au sol et autres], les enseignes ou les emballages), ainsi que tout ce qui relève des différentes techniques d’impression et de leur choix.
Pour en revenir aux impacts de façon concrète, nous disposons de suffisamment de sources pour savoir de quoi il retourne. Le document Un Livre français. Évolutions et impacts de l’édition en France analyse les étapes de la filière du livre, depuis l’exploitation forestière jusqu’au pilonnage et au recyclage. Les différents « impacts associés » y sont répertoriés : « destruction d’emplois » (dans différentes filières), « précarisation des conditions de travail », surproduction (impliquant gaspillage, déchets et pilonnage), « exposition aux encres et aux résines […] potentiellement dangereuse pour la santé des travailleurs », « émissions polluantes et toxiques dans l’air et dans l’eau », « rejets de substances cancérigènes », « consommation d’eau et d’énergie », « pertes de terres agricoles », « risque d’insécurité alimentaire », « érosion des sols », « émissions de gaz à effet de serre », « production de déchets[18] », etc. (ce rapport indique aussi les efforts et améliorations déjà effectifs sur certains points).
Intéressons-nous maintenant à l’ouvrage pionnier Impacts écologiques des technologies de l’information et de la communication. Les Faces cachées de l’immatérialité – un livre collectif qui remonte déjà à 2012, coordonné par Françoise Berthoud, et issu pour l’essentiel des travaux de recherche du groupe ÉcoInfo du CNRS[19]. Le premier chapitre, consacré aux impacts, étudie en détail l’« épuisement des ressources naturelles » (métaux, minerais, énergies fossiles, forêts, eau), ensuite les « pollutions de l’air, […] des sols, […] des eaux », la « transformation des écosystèmes » (climat, océans, couche d’ozone, eutrophisation, désertification), puis les « impacts connus actuellement sur le monde du vivant » (forêt, biodiversité, santé humaine) – le tout alimenté de sous-rubriques faisant ressortir la (dé)mesure vertigineuse de cette rafale d’impacts. Force est de constater les nombreuses résonances entre ce chapitre et l’étude consacrée au livre mentionnée supra[20]. De telles connaissances et recherches, qui se sont largement développées dans les années 2010, ont de quoi nous interroger et nous alerter. Elles concernent de nombreux acteurs et secteurs d’activité, dont la communication visuelle fait clairement partie. De quoi se demander pourquoi le lien entre graphisme et écologie reste si peu traité, et comment il est possible qu’il reste inabordé en maints endroits de la culture et de l’apprentissage de ce champ professionnel. À sa décharge, le design graphique doit faire face à la pollution que représente la surcharge d’information (« brouillard de données », « infobesité », etc.) qui, hors des espaces préservés ou des niches, ne peut que le noyer dans la masse[21]. Notons aussi qu’il a tenu à se démarquer de longue date du matraquage publicitaire (en lien avec l’estompement de la grande tradition des affichistes et de ce que l’on appelait la réclame). S’il ne peut qu’être brièvement évoqué ici, l’état de saturation visuelle constitue une dimension importante du sujet (et mériterait une étude très fouillée, depuis les aspects matériels jusqu’aux conséquences d’une telle intrusion psychologique) : pour faire court, ne parle-t-on pas aussi de « pilonnage[22] » ainsi que du « nombre d’impacts » pour désigner la « pression publicitaire » qui s’exerce sur nous au quotidien, entravant si souvent le repos et le bien-être de l’espace mental ?
La création graphique peut considérer l’ensemble de cette situation comme une chance à saisir pour conjuguer ses importants acquis avec les vérités du monde contemporain. Un certain nombre de pistes, d’orientations, d’exemples ou de repères existent (à défaut de solutions toutes faites, et à accueillir, le cas échéant, avec discernement). Ainsi du réseau Biocoop, dont la campagne de communication multisupports de 2015 a été conçue dans une « démarche d’éco-responsabilité » et sur le principe d’une très forte « réduction de l’empreinte écologique » : « il a fallu oublier les processus de création et de production classiques […] faire appel à des techniques alternatives parfois oubliées. […] Les transports les moins polluants ont été utilisés […]. Un vélo a été transformé à la main pour générer de l’électricité […]. Les photos ont été réalisées avec un Sténopé de 40 par 50 cm construit à partir de vieilles caisses en bois [… et] ont été développées sur place avec des produits recyclés et réutilisables. Le film, lui, a été tourné avec 2 caméras manuelles […] des années 50 et 70 […]. Le montage a été produit directement sur pellicule, pour ne pas numériser de séquences inutiles. […] Les accroches et logos ont été directement calligraphiés à la peinture biologique sur du papier recyclé à l’encre végétale. Un site web ultra léger, sans image, a été entièrement réalisé en typographies, et codé sur un ordinateur recréé dans une cagette de marché avec d’anciens composants informatiques[23] ». Opérant des choix à contre-courant des tendances dominantes, le site consistait en une longue page à défilement vertical, et comportait des « images » en code ASCII, mais ni vidéos ni photographies pour des raisons de poids[24]. Cette même année 2015 voit paraître la réédition de l’ouvrage Éco-conception web, de Frédéric Bordage, estimant que « le poids moyen d’une page web a été multiplié par 115 en 20 ans, passant de 14 Ko en 1995 à plus de 1 600 Ko en 2015[25] ». L’expansion des données numériques fait écho au phénomène de saturation visuelle, dans le sens où il s’agit tout à la fois de surenchère quantitative, de surabondance matérielle, et de stimuli dont les excès posent problème. Pour ce qui est de cette question du débordement dans l’espace public urbain, mentionnons ici le projet Delete ! [effacer], imaginé par un collectif de créateurs autrichiens, ayant consisté à recouvrir d’aplats jaunes l’ensemble des signes commerciaux d’une rue de Vienne en 2005 – une intervention forte et « simple », chargée de signification, invitant à réfléchir sur notre expérience visuelle quotidienne, et qui a le mérite de ne pas en rajouter.
Tout devrait être fait pour aller dans le sens des véritables démarches d’écoconception, du fait qu’elles intègrent les impacts environnementaux. Face à la complexité des enjeux – et compte tenu des débats, des incertitudes et des inconnus –, il semble essentiel de s’intéresser aux réflexions et recherches qui plaident pour les basses technologies (low-tech)[26] et pour la « sobriété numérique[27] ». La récente étude Empreinte environnementale du numérique mondial plaide pour « une écoconception radicale des services numériques », considérant qu’« il est possible de diviser par un facteur 2 à 100 la quantité de ressources nécessaires[28] ». En restant dans l’idée d’une création plus écologique (sachant qu’une approche qui irait au-delà de faire mieux s’attacherait à l’autolimitation dans une reconfiguration de fond), outre l’option low-tech, un bon nombre de leviers se présentent à la conception graphique, pouvant relever du choix des matériaux, de leur surface, de la couleur, de l’encre, du travail sur les images, des équilibres entre papier et numérique, du grammage, des normes, labels ou certifications (ne bénéficiant pas tous de la même réputation), et de l’imprimeur. Il est significatif de constater à quel point reste répandue l’idée selon laquelle abandonner le papier au profit du numérique équivaudrait automatiquement à préserver l’environnement, comme si ce basculement relevait ipso facto d’un acte écologique, et comme si ce sujet n’avait pas une complexité inhérente. Face à la puissante hégémonie des technologies, aux objectifs « zéro papier » et autres, nous sommes dans une phase où le papier se trouve remis en avant en tant que matériau recyclable et issu de ressources renouvelables[29]. Parmi les pistes et projets déjà à l’œuvre se trouvent différents travaux et réflexions autour de la récupération des chutes, des marges, des supports, etc. – par exemple l’édition de Perruque, « une revue de 1 × 90 cm qui publie des spécimens typographiques non standards imprimés dans les marges d’impressions [offset] courantes ».
Pour l’heure, probablement moins considérée que les questions d’espace et de surface, la couleur a également son importance, et ce sur des plans très différents. Par exemple, pour des sites low-tech, le nombre de couleurs des images et leur traitement jouent sur leur poids. Pour ce qui est des encres, l’ouvrage Green Graphic Design fait état du lien entre certaines couleurs et leur teneur en « métaux potentiellement dangereux ». La couleur des fonds, bien que d’arrière-plan, joue aussi un grand rôle. Nous nous trouvons extrêmement souvent face à des fonds blancs, aussi bien face au papier que face aux écrans. Or le blanchiment du papier relève d’un traitement artificiel – la matière première n’étant pas blanche (l’étude Un Livre français recommande, pour des raisons d’impact, un recours plus important au « papier grisé [recyclé] »). Par ailleurs, l’usage du papier blanc pour l’édition s’est trouvé vivement critiqué par le grand typographe et auteur Jan Tschichold, qui le considérait inadapté et y voyait surtout un problème sanitaire majeur. Il se serait sans doute insurgé et alerté s’il avait su que nos yeux allaient être soumis à la lumière des écrans blancs sur de longues durées (ce dont beaucoup souffrent, à juste titre). De fait, qu’il s’agisse des sites web, des fenêtres des logiciels ou des courriels, le problème s’est déplacé, et se trouve accru lorsque la source d’affichage est lumineuse (rétroéclairage). De plus, en pareil cas, le choix de la couleur a une incidence sur la consommation énergétique (laquelle diffère selon les technologies d’affichage et leur évolution). Entre le blanc éblouissant des écrans et le récent développement du « mode sombre » (applications, moteurs de recherche, interfaces de système d’exploitation, etc.), tout un travail, extrêmement subtil, serait à faire pour dépasser le simple passage du positif au négatif, afin de conjuguer au mieux les questions d’impact avec le confort de la lecture (auquel répondent partiellement les niveaux de gris des liseuses). Ici encore, les questions sanitaires et environnementales se relient.
Nous ne pouvons plus ignorer les effets dévastateurs de notre civilisation matérielle que tant de travaux de désopacification continuent de mettre au jour. Il y va de la viabilité du monde et de ses écosystèmes (ou plutôt de ce qu’ils sont devenus du fait de l’anthropisation). Si les conséquences de la matérialité, dans toutes ses dimensions, engagent à repenser et à resituer le graphisme, ce dernier se trouve en capacité de jouer un rôle en ce qui concerne les imaginaires et les représentations, si souvent invoqués dans les objectifs d’émancipation à visée écologique ou socio-écologique. Dans ce vaste contexte, bien des aspects peuvent être travaillés par le graphisme et sa culture, jusqu’à être vus comme de véritables tremplins pour la création et la réflexion : prendre en compte les impacts (donc les connaître), confronter la pollution visuelle et la surenchère, déjouer les tendances au lissage, activer ses potentiels d’expression (capacité, en tant que langage visuel, à mettre en forme contenus, signes, messages, etc. – donc à réinjecter du sens et du sensible) ; mieux comprendre son histoire pour mieux s’inscrire dans le présent et le futur, élaborer des fondamentaux appropriés, s’interroger sur les critères de pertinence des sujets, des supports et des contenus, instaurer un débat et une critique en adéquation avec ces enjeux contemporains, développer une pratique et un esprit inclusifs, créer des espaces d’expériences collectives à toutes ces fins, bref œuvrer à une culture partagée répondant à ces problématiques, etc.
Les défis actuels – comme pour tant d’autres secteurs – n’en appellent pas à de petits changements de réglage. Ils requièrent une transformation majeure, nécessitant une vision d’ensemble et une compréhension de fond. Pour prendre le recul nécessaire, laissons les derniers mots à Bernard Stiegler : «il n’y a pas d’autre issue que de « changer de cap »», « il faut être fou pour continuer à vivre comme si de rien n’était ». « Et nous savons que, face à ces défis, il n’y a pas d’autre issue possible que la formation et la culture d’une nouvelle conscience humaine[30] ». « Nous ne pourrons sauver le monde de l’effondrement disruptif et entropique que par […] une économie de la reconstruction au service d’une nouvelle ère noétique – cultivant de nouveaux savoirs à la fois comme savoir-vivre, savoir-faire et savoir concevoir et spiritualiser[31] ».
[1] Les citations de Victor Papanek, Pauline Madge, Brian Dougherty et du manifeste First Things First sont traduites par nous.
Cela permet l’avancement de travaux dont témoigne bien, à titre d’exemple, le récent Livre vert pour le secteur de l’architecture (Philippe VILLIEN, Dimitri TOUBANOS (dir.), Éditions EnsaÉco/ministère de la Culture, 2019).
[2] Philippe Madec est co-auteur du Manifeste pour une frugalité heureuse & créative (2018), consacré à l’« Architecture et aménagement des territoires urbains et ruraux ».
[3] Collectif, « En grève pour le climat avec les jeunes », Mediapart, 24 mai 2019, [en ligne], https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/240519/en-greve-pour-le-climat-avec-les-jeunes
[4] Collectif, « « Non à un retour à la normale » […] appel de 200 artistes et scientifiques », Le Monde, 6 mai 2020, [en ligne], https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/06/non-a-un-retour-a-la-normale-de-robert-de-niro-a-juliette-binoche-de-joaquin-phoenix-a-angele-l-appel-de-200-artistes-et-scientifiques_6038775_3232.html.
[5] Clémence VORREUX, Marion BERTHAULT, Audrey RENAUDIN et alii., Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat. Former les étudiants pour décarboner la société, rapport pour le think tank The Shift Project, mars 2019, [en ligne], p. 30-32 et 59.
[6] Victor PAPANEK, Design for the Real World. Human Ecology and Social Change, Toronto/New York/Londres, Éditions Bantam Books, 1973 (1970). Traduction française : Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social, Paris, Éditions Mercure de France, 1974 (1973), p. 335, 336 et 262.
[7] Ibid., p. 264.
[8] Ibid., p. 337.
[9] Pauline MADGE, « Ecological Design. A New Critique », Design Issues, MIT Press, vol. 13, n° 2, « A Critical Condition: Design and Its Criticism » [Une situation critique : le design et sa critique], 1997, p. 44.
[10] Françoise BERTHOUD (dir.), Impacts écologiques des technologies de l’information et de la communication. Les Faces cachées de l’immatérialité, ouvrage collectif, groupe ÉcoInfo / CNRS, Paris, Éditions Diffusion Presse Sciences, 2012 ; Fabrice FLIPO, Michelle DOBRÉ, Marion MICHOT, La Face cachée du numérique. L’Impact environnemental des nouvelles technologies, Montreuil, Éditions L’Échappée, 2013 ; Guillaume PITRON, La Guerre des métaux rares. La Face cachée de la transition énergétique et numérique, Paris, Éditions Les Liens qui Libèrent, 2018.
[11] BASIC (Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne), Un Livre français. Évolutions et impacts de l’édition en France, étude, avec le soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer, 2017, [en ligne], p. 37.
[12] Brian DOUGHERTY, Green Graphic Design, New York, Éditions Allworth Press, 2008, p. 183.
[13] Pour un cas extrême directement en lien avec nos équipements technologiques, non-spécifique au graphisme, mais concernant néanmoins ceux qui ont l’usage des matériels en question, voir (entre autres études focalisées) le rapport d’Amnesty International de 2015 « Voilà pourquoi on meurt » […] [en ligne].
[14] Philippe BIHOUIX, « Le Mythe de la technologie salvatrice », Esprit, mars-avril 2017, p. 105.
[15] BASIC, Un Livre français. Évolutions et impacts de l’édition en France, op. cit., p. 50.
[16] Ibid.
[17] Notons que l’enseignement du graphisme demande souvent aux étudiants de « faire des choix » ou de « prendre parti », tout en ne s’étant que rarement penché sur les problématiques écologiques et environnementales.
[18] BASIC, Un Livre français. Évolutions et impacts de l’édition en France, op. cit., p. 15, 24, 25, 30, 31 et 43.
[19] Françoise BERTHOUD (dir.), Impacts écologiques des technologies de l’information et de la communication. Les Faces cachées de l’immatérialité, op. cit., un livre collectif qui remonte déjà à 2012. De nombreux documents issus des travaux du groupe ÉcoInfo sont disponibles en ligne. Par ailleurs, voir aussi les travaux de l’ADEME (renommée Agence de la transition écologique).
[20] supra, BASIC, 2017.
[21] Sachant que les surfaces les plus grandes se trouvent consacrées à la publicité des marques et à la sphère marchande.
[22] Pilonnage : « Au fig. Répétition incessante d’un son, d’un slogan, etc., en vue d’un conditionnement psychologique. Synon. matraquage ».
[23] Informations en ligne, sur les sites de différents magasins Biocoop.
[24] Le site en question n’est plus accessible.
[25] Frédéric BORDAGE et alii., Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques. Doper son site et réduire son empreinte écologique, Paris, Éditions Eyrolles, 2015, p. 16.
[26] Philippe BIHOUIX, L’ âge des low tech. Vers une civilisation techniquement soutenable, Éditions du Seuil, Paris, 2014.
[27] Hugues FERRBOEUF (dir.), Pour une sobriété numérique, rapport du groupe de travail « Lean ICT » pour le think tank The Shift Project, 2018, [en ligne], https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf
[28] Frédéric BORDAGE et alii., Empreinte environnementale du numérique mondial, rapport, GreenIT.fr, septembre 2019, [en ligne], p. 35 et 34.
[29] Hors des processus industriels nécessaires à sa fabrication, à son retraitement, etc.
[30] Bernard STIEGLER, Qu’appelle-t-on panser ? 1. L’Immense régression, Paris, Éditions Les Liens qui Libèrent, 2018, p. 175 ; Bernard STIEGLER, Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ?, Paris, Éditions Les Liens qui Libèrent, 2016, p. 109 ; Bernard STIEGLER, Ars Industrialis, Réenchanter le monde. La Valeur esprit contre le populisme industriel, Paris, Éditioins Flammarion, 2006, p. 14.
[31] Bernard STIEGLER, Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ?, op. cit., p. 429. La noèse étant « l’acte de penser ».