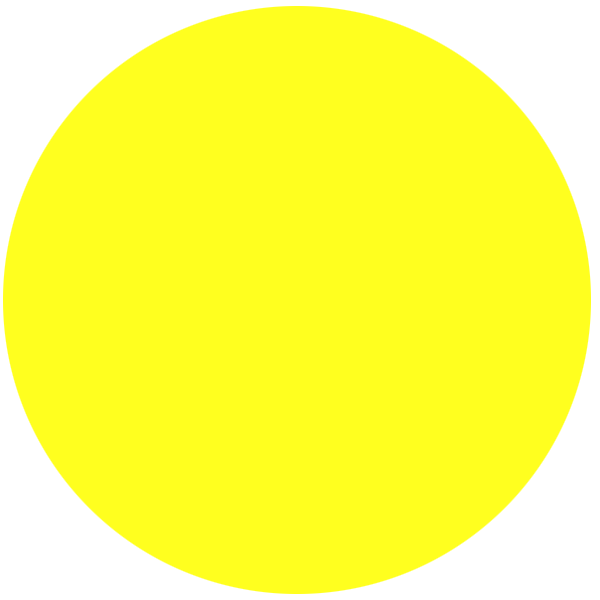

—
Résumé
Comment faire des livres dans l’ère post-numérique? Pour répondre à cette question décisive aujourd’hui, cet article propose de revenir sur différentes modalités d’édition en interrogeant supports et conditions, moyens et échelles. Mais c’est la question du droit d’auteur, restée jusque-là dans l’obscurité, dont l’impact est examiné comme atteinte à la liberté de création dans un contexte où les pratiques éditoriales sont de plus en plus menacées par le contrôle algorithmique. Des outils sont proposés ici pour tenter de lutter contre une situation délétère pour la création au profit d’une pratique « libre » qui réclame le droit de copier et cherche à faire évoluer la législation.
Texte écrit en 2020 pour les actes du colloque « Les écologies du numérique » organisé par l’Ésad Orléans (ÉCOLAB) en 2017 et 2018.
—
Mots clé
Post-Numérique, droit d’auteur, copier, publier, législation, libre
—
Biographie
Eric SCHRIJVER
Auteur et designer d’interaction, Eric Schrjiver est né à Amsterdam et vit et travaille à Bruxelles. En tant que designer, il travaille notamment sur des interfaces d’édition et des publications numériques et hybrides. De 2011 à 2017, il a fait partie du noyau du collectif graphique Open Source Publishing. À travers son blog I like tight ponts and mathematics, il sensibilise les designers et artistes à des questions culturelles liées à la programmation informatique. En 2018, il a publié son premier livre Copy This Book. An Artist’s Guide to Copyright (Onomatopée, Pays-Bas). Ce guide à la fois critique et pragmatique aide des créatif·ve·s à naviguer dans les paradoxes du droit d’auteur.
Dans les années 1990, en suivant un tutoriel édité par le mythique fournisseur d’Internet amstellodamois XS4ALL, j’ai réussi a faire apparaître sur le web les mots « HELLO WORLD ». Peu de choses de ma pratique numérique d’adolescent font encore partie aujourd’hui de ma vie, mais l’édition numérique, surtout en ligne, ne m’a pas quitté depuis. En 2008, quand j’ai commencé à enseigner le design d’interaction aux étudiant·e·s de l’École des Beaux-Arts de La Haye (la KABK), j’étais plongé dans différentes sous-cultures du numérique : le design web d’un côté, mais aussi la communauté du logiciel libre qui cherchait de nouvelles méthodes de collaboration en ligne. Toutes ces personnes avaient l’habitude de publier leurs projets sur des sites et des blogs, et de cette manière j’ai pu être au courant de leur travail et parfois collaborer avec des gens de l’autre côté du monde[1]. Le design et l’édition numérique se montraient très accessibles, et il me semblait facile d’y intervenir et d’avoir un impact sur ce qui était et qui reste encore un champ en pleine mutation et expansion. Bien plus facilement en tout cas que dans des pratiques plus établies, saturées et intimidantes comme le design de livres papier et d’affiches.
Lorsque j’ai commencé à enseigner, j’ai donc été un peu surpris de découvrir que mes étudiant·e·s (et certain·e·s de mes collègues) se montraient souvent beaucoup plus enthousiastes pour des supports graphiques comme les posters et les livres papier, et qu’iels ne ressentaient pas la même excitation à investir des formats édités et partagés sur écrans. Même dans des écoles très pluridisciplinaires, peu importe le sujet, mes étudiant·e·s revenaient presque systématiquement vers moi avec des éditions papier.
Cet intérêt pour des formes analogues et au long pedigree ne se limite pas aux écoles, comme en témoigne une tendance mondiale à organiser des « book fairs », dont le nombre a explosé dans les dix dernières années[2], et cette tendance ne se limite pas non plus au livre, mais inclut plusieurs médiums « zombies », dont l’obsolescence semblait programmée, mais qui reviennent en force, comme les magazines xérographiés, l’impression riso et les cassettes audio.
La volonté d’éditer sur des supports physiques ne me semble pourtant pas liée à un refus des technologies numériques : le plupart des designers et artistes qui font des éditions aujourd’hui s’emparent d’ordinateurs et de logiciels. Ce n’est donc pas au sein du processus créatif que l’attraction se trouve, mais dans les modalités de distribution. Dans ce qui suit, je passerai en revue différentes modalités d’édition à l’heure post-numérique, en interrogeant supports et conditions, moyens et échelles. Je pourchasserai quelques zombies, en déterrant leurs racines profondes. Une d’entre elles, jusque-là restée dans l’obscurité : le droit d’auteur, dont j’examinerai l’impact, cette fois pas comme un vecteur d’émancipation des artistes mais plutôt comme une atteinte à la liberté de création, ayant une influence sur nos processus créatifs, incluant nos choix de médiums. Je mettrai en lumière la façon dont les changements législatifs amenés par la récente directive européenne impacteront les pratiques éditoriales avec l’évolution probable vers un contrôle algorithmique. Je tenterai enfin de fournir des outils pour se défendre contre ce qui s’avère pire que les zombies de l’analogique…
L’arrivée du numérique n’a pas rendu obsolète les médiums physiques, mais leur rôle et leur statut s’est transformé et continue à muter en relation avec de nouveaux objets dans le paysage de la publication désormais hybride. Dans Post-Digital Print, La mutation de l’édition depuis 1894[3], Alessandro Ludovico décrit les changements dans l’édition qui ont mené à un écosystème dans lequel les chaînes de production des supports physiques et analogiques sont entrelacés. Dans cet écosystème, le médium du livre imprimé a pu maintenir une position importante pour plusieurs raisons. D’abord, c’est une interface de lecture ergonomique, entre autre parce qu’il permet le feuilletage. Ensuite, là où beaucoup de systèmes d’édition numérique manquent en flexibilité pour varier leurs feuilles de style en fonction du contenu, le livre permet de faire un design cohérent entre forme et contenu, couverture et intérieur. Il contient sa propre représentation, par sa couverture, ce qui aide à se faire représenter et à s’imprimer dans la conscience collective. Et même si la majorité des expériences de lecture se fait aujourd’hui sur des écrans, ces éditions sont souvent fragiles. Elles dépendent d’un hébergement à maintenir, parfois d’abonnements qui peuvent être résiliés, et sont inscrites dans un réseau de liens qui peuvent à tout temps arrêter de fonctionner. Parce que le livre physique est contenu en lui-même[4] et que les infrastructures autour du livre existent depuis longtemps, il existe non seulement des magasins pour les vendre mais aussi des bibliothèques pour les prêter et les archiver. Finalement, le livre papier est aussi un moyen indispensable pour légitimer son contenu. Parce qu’il reste encore aujourd’hui peu accessible de publier un livre – il demande un certain nombre de moyens, notamment économiques, mais aussi de trouver sa place dans une chaîne relativement restrictive – on a tendance à légitimer les contenus et la parole d’auteur·e·s qui ont eu l’opportunité d’en publier[5]. Moi-même, ayant récemment publié mon premier livre en papier, j’ai pu faire l’expérience de la transformation, en tout cas symbolique, d’avoir publié un « vrai » livre. Et pourtant je publiais depuis longtemps en ligne.
Si l’attrait pour le livre reste donc compréhensible, cela ne veut pas forcément dire qu’un format imprimé est le meilleur format pour tout projet d’édition. Dans le monde post-numérique, certaines formes imprimées prospèrent et certaines sont marginalisées – comme en témoignent les annuaires téléphoniques et les encyclopédies, aujourd’hui principalement consultés en ligne. Dans le contexte de l’édition culturelle et artistique également, certaines formes imprimées bénéficient plus que les autres du remaniement effectué par l’arrivée du numérique. En tant qu’artiste, avoir un site internet et apparaître sur des blogs est une chose, mais un catalogue monographique reste inégalable pour se démarquer dans le marché de l’art. Même les graphistes les plus référencé·e·s de l’époque du premier « boom » du web, et qui traitaient de l’influence du numérique dans leur travail, se sont légitimé·e·s par des magazines imprimés (par exemple Emigre). C’est certainement à cette ironie que David Carson faisait référence en nommant sa monographie en papier The End of Print en 1995[6].
Au-dessous d’une certaine quantité de pages, par contre, beaucoup d’avantages du livre peuvent disparaître. Une raison toute bête, c’est qu’il devient alors impossible pour l’édition d’avoir un dos, et une grand partie de l’écosystème du livre dépend de son dos. Le dispositif principal pour présenter et ranger des livres, de la librairie à la bibliothèque de prêt et aux espaces privés, est la bibliothèque, dans laquelle les livres sont en majorité rangés « en montrant leur dos », qui contient des informations qui les rendent identifiables. C’est un des grands défis qu’amènent les zines, par exemple. Il est compliqué de les vendre dans un réseau de distribution en librairie[7], non seulement pour leur fréquente absence d’ISBN mais aussi pour leur format « sans dos ». Et une fois vendus, d’expérience, ils sont plus vite oubliés (car moins visibles), et ils survivent moins bien au tri, car on se débarrasse plus facilement des livres qui sont compliqués à ranger dans sa bibliothèque. Dans les bibliothèques publiques et les archives, ces publications sont classées comme « ephemera », et toutes les institutions n’ont pas forcément l’infrastructure pour les gérer.
De plus, pour qu’un contenu fonctionne en tant que livre, il faut aussi qu’il soit diffusé en un certain nombre d’exemplaires. L’objet pourra alors être diffusé dans un cercle moins restreint que le cercle social de son édit·eur·rice, en passant par exemple par une structure de diffusion. En plus, à partir d’environ 500 exemplaires, il devient possible de travailler en impression offset, ce qui donne une grande flexibilité au niveau des choix d’encres et de papier, mais aussi de travailler avec des imprimeu·r·se·s qui amènent leur expertise au projet, et avec des processus industriels amenant précision et rapidité. Je comprends qu’il ne soit pas nécessaire pour chaque projet de trouver les moyens d’investir dans une édition en offset. Il y aussi beaucoup de projets qui veulent travailler avec des contenus plus succincts. Mais c’est exactement là où, avant de se tourner vers une édition limitée en papier, je me demande toujours : – pourquoi pas une édition numérique ? L’édition sur écran offre des possibilités importantes : elle est moins chère, plus rapide, et capable de toute une série de solutions graphiques inaccessibles aux formats physiques : l’inclusion d’animation, de son, de vidéo ; la contextualisation par hyperlien, et l’ajout des interactions programmées. Avec en plus la possibilité pour les contenus de circuler à une échelle mondiale sans dépendre de services postaux.
Aujourd’hui, beaucoup de graphistes, édit·eur·rice·s et artistes créent des éditions numériques[8]. Et en même temps, il y a également une tendance à créer des petites éditions d’objets physiques. Je reviendrai sur cette question des éditions limitées. La dimension « micro » est tout à fait assumée par les créat·eur·rices qui la pratiquent, comme en témoigne l’utilisation du le terme « micro-édition » pour désigner des objets, des événements et des structures éditoriales. La notion de petite échelle dans l’édition est une catégorie à part entière. Cette tendance me semble intéressante à rapprocher du mouvement des « micro-brasseries », qui nomme la tendance à créer des bières à petite échelle avec des méthodes artisanales. Mais il y a une différence fondamentale entre faire de la bière et faire des œuvres d’esprit. Dans le cas des bières, produire à une échelle industrielle demande des fonds importants, alors que la particularité de l’édition numérique, c’est qu’elle permet une grande flexibilité d’échelle, avec des moyens réduits au minimum. Pourquoi donc cette insistance sur les productions à petite échelle?
Une autre tendance que j’ai pu remarquer, au-delà du choix de faire de la « petite édition », autre terme utilisé dans le champ, c’est le recours à des techniques de reproduction oubliées par le mainstream. On pourrait par exemple se pencher sur la forme du fanzine, qu’on trouve de plus en plus sur les tables des foires de livres d’artistes. Les fanzines, c’est d’abord un phénomène historique. Les fans de science fiction ont trouvé ce moyen pour échanger à propos de leur passion (à noter qu’il n’existait alors pas de revues qui représentaient ce qui était classé comme sous-littérature à l’époque), puis ce fut le tour des punks et des Riot Grrrls, entre autres mouvements contestataires. Aujourd’hui, ce n’est pas comme si les fans de science-fiction ne discutaient plus, n’écrivaient plus et n’exprimaient plus leur créativité. Sauf qu’iels n’ont plus vraiment besoin d’une photocopieuse pour cela. Iels se sont appropriés les forums, les blogs, les réseaux sociaux… Les artistes, commissaires d’exposition et graphistes qui choisissent aujourd’hui de s’approprier les formes du fanzine peuvent profiter d’un héritage culturel important (et espèrent peut-être profiter un peu de son aura!) mais en choisissant ces formes, iels se retrouvent un peu le « cul entre deux chaises », ne pouvant ou ne voulant pas forcément profiter des réseaux informels de distribution qui se sont historiquement construits autour des zines, ni des possibilités des formats numériques.
Comment expliquer le fait qu’une photocopieuse à encre liquide – largement oubliée depuis que la combinaison imprimante laser, scanner et photocopieuse numérique a conquis les bureaux – gagne une grande renommée chez les graphistes? Je parle du risographe bien sûr, qui dans cette dernière décennie a vécu une renaissance spectaculaire. En fait, avec la risographie, je peux encore comprendre en partie son intérêt. Tout comme les photocopieuses et les imprimantes laser, qui forment la base de la technologie « print on demand », la riso permet de faire des reproductions papier en petite édition et demande donc moins de moyens économiques à investir. L’avantage c’est que la riso permet l’utilisation de couleurs éclatantes qui sont normalement réservées à l’impression offset, économiquement viable qu’à partir d’un nombre d’exemplaires élevé, ou encore la sérigraphie, qui demande un processus de préparation long et un matériel plus complexe.
De tous les médiums que j’ai vu renaître dans ce monde post-numérique, celui qui m’as le plus surpris n’est pas en papier : il s’agit du regain d’intérêt actuel pour l’édition en cassette audio. Le journal néerlandais NRC a publié un entretien avec deux habitants de la région d’Eindhoven. D’un côté un ancien ingénieur nonagénaire de chez Philips, de l’autre un jeune entrepreneur ayant racheté une fabrique d’audio-cassettes[9]. L’ingénieur, qui était à la base du développement de l’audio-cassette quand il avait l’âge de l’autre, a ensuite rejoint l’équipe qui a développé le compact disc. Il ne comprend rien à cette nouvelle génération qui veut utiliser un médium de mauvaise qualité sonore. Écrire un CD, ça coute moins qu’une audio-cassette, et surtout, aujourd’hui, la bande passante d’internet est bien assez puissante pour qu’on puisse distribuer sans investissement préalable des morceaux de qualité CD ou même supérieure. D’où vient donc le choix de distribuer son travail sur cassette ?
Avant, j’avais des explications peu flatteuses pour justifier le désir des artistes et graphistes de disséminer sur des supports physiques (démodés en plus!), en édition limitée. Je pensais surtout qu’iels étaient soit nostalgiques et soit élitistes. Mais aujourd’hui je ne suis plus tout à fait d’accord avec cela. J’ai trouvé une réponse plus sympathique. Je pense qu’iels ont aussi compris que le support physique leur permet l’accès à quelque chose d’autre : la liberté de création.
Dans le contexte de l’Europe occidentale, un des vecteurs majeurs pour restreindre la liberté de création est le droit d’auteur. Ce n’est pas forcément évident, mais le droit d’auteur peut en réalité se montrer très contraignant pour la création, alors qu’il est souvent présenté comme étant censé la défendre. Malgré le fait que les techniques comme la citation, la parodie, le sampling, le remix et le détournement sont devenues très courantes comme stratégies artistiques (même si elles ont toujours fait partie de la création), les lois et la jurisprudence sont devenues plus strictes. Si à ses débuts au 18e siècle le droit d’auteur se concentrait sur la copie d’un contenu tel quel (notamment des livres), le droit d’auteur a évolué vers un modèle où n’importe quelle adaptation est une infraction. Oui, il y a la liberté de citation, mais cette liberté n’est clairement développée que pour le texte, pas pour l’image.
Le fait que le droit d’auteur ait un impact sur la création n’est pas du tout une évidence, ni pour les créati·f·ve·s, ni pour les politicien·ne·s, ni pour les juristes. Dans la rhétorique du droit d’auteur, ce dernier est censé protéger l’auteur·e. Et c’est vrai : le droit d’auteur donne aux créatifs la possibilité d’exploiter et de contrôler une partie de sa production. Il est par exemple indispensable dans les négociations avec des éditeurs et autre diffuseu·r·se·s. Mais il contraint aussi sa création.
L’histoire de la musique contemporaine nous en montre un exemple simple. Quand la technique du « sampling » est devenue populaire dans les années 1980, il n’y avait pas encore de pratique légale pour la contester. C’est pour cela que les artistes de l’époque ont pu incorporer des fragments de nombreux morceaux pour les détourner de façon créative. En écoutant aujourd’hui des morceaux de De La Soul ou des Beastie Boys, il est surprenant de remarquer à quel point ils ont été capables de réutiliser ou citer des morceaux très connus – souvent même en faisant du sampling de plusieurs morceaux sur une piste. C’était une période où les ayant droits n’avaient pas encore commencé à revendiquer leurs droits, et personne alors ne savait si le droit d’auteur allait incorporer une possibilité de sampling. Les choses ont bien changé ensuite. Au fur et à mesure des procès contre le sampling, la jurisprudence a basculé vers une situation où n’importe quel sample, même très court, doit faire l’objet d’une licence. Aujourd’hui, le sample a disparu du vocabulaire, sauf pour le sampling « bling bling ». Le sample est devenu comme la Bentley dans les clips: quand Kanye sample Daft Punk, on sait que cela lui a coûté cher.
Cette situation ne concerne pas uniquement la musique. Les artistes plasticien·ne·s et les graphistes se retrouvent aussi restreint·e·s par le droit d’auteur. Voici une liste non-exhaustive de choses qui sont empêchées par le droit d’auteur :
– utiliser n’importe quelle image sans demander la permission à son auteur·e – même si on ne sait pas qui est l’auteur·e (une « image orpheline »)
– faire un dessin ou une peinture basée sur une photographie
– faire un détournement critique et/ou artistique d’une image existante sans humour (la moquerie est importante pour que cela soit considéré comme une parodie – une des rares exceptions au droit d’auteur)
– faire une photographie en studio où sont utilisés du mobilier, des vêtements ou des bijoux, sans permission[10]
Certaines de ces pratiques qui constituent des infractions au droit d’auteur semblent pourtant très courantes dans le travail créatif. Et une partie du problème est là. Le droit d’auteur est à la fois très strict, très souvent enfreint et peu mis en pratique. Le droit d’auteur fait partie du droit civil, et lorsqu’une reproduction enfreint les droits d’auteurs d’une personne, légale ou physique, il faut qu’elle-même montre un intérêt actif à empêcher ou à négocier cette reproduction. Pour cela, il faut d’abord qu’elle repère l’infraction à ses droits d’auteurs. Ensuite, c’est à elle de décider si elle veut contacter la personne qui a copié son travail pour négocier les conditions de cette utilisation ou l’interdire. Si ces deux personnes ne trouvent pas d’accord, la personne copiée, si elle en a les moyens, peut faire un procès à la personne l’ayant copiée. Pour qu’une infraction devienne un problème, il faut donc que l’ayant droit soit au courant de cette infraction et veuille agir. Il n’y a pour l’instant pas de processus magique permettant aux ayants droit de constater des copies d’un travail. Tout cela dépend beaucoup des rencontres faites par hasard, et aussi du fait que plus une œuvre circule, plus elle risque de croiser le regard des ayant-droits.
Il me semble que les risques légaux de la création artistique contemporaine font partie des raisons pour lequelles les créati·f·ve·s choisissent de travailler dans des éditions physiques et limitées. Tout le monde n’est pas au courant des détails du droit d’auteur, mais les gens en savent assez pour que les personnes qui pratiquent des stratégies artistiques courantes, comme la citation visuelle, se disent que cela pourrait représenter un risque. Et il me semble que, consciemment ou inconsciemment, on cherche des stratégies pour réduire ce risque.
Je crois qu’aujourd’hui beaucoup de créati·f·ves suivent une stratégie qu’on peut appeler la « Sécurité par l’Obscurité ». C’est une terme utilisé par les ingénieur·e·s du domaine de la sécurité informatique pour désigner les stratégies qui dépendent que certaines informations restent en sous du radar. Il ne s’agit pas d’éviter l’infraction au droit d’auteur, mais de minimiser les chances que son infraction soit repérée. Avec des éditions graphiques sur papier, on a l’avantage d’utiliser un médium qui permet de faire circuler un contenu dans un cercle restreint. Dès que l’on publie en ligne, si un contenu devient « viral » il peut se retrouver tout d’un coup partagé à une échelle énorme. Si on publie sur papier, ou sur cassette, ce risque est moins probable. On maîtrise donc mieux la dissémination[11].
Un projet d’édition numérique demande une stratégie différente, où on essaie non pas de minimiser les chances de découverte des infractions, mais de minimiser les infractions elles-mêmes. Ce type de stratégie demande une certaine connaissance du droit, une compétence qui ne fait pas forcément partie des outils acquis lors des études artistiques, et qui n’est pas non plus activée ni valorisée par la suite… C’est peut-être pour cette raison que les premiers projets d’édition numérique dans lesquels je me suis retrouvé, étaient soit faits par des grandes maisons d’édition, soit par des gens intéressés par le monde du logiciel libre et des Creative Commons. Ces maisons d’édition de grandes tailles peuvent investir dans des conseils légaux et/ou payer pour des licences. Et pour les passionné·e·s du libre, il est plus habituel que pour les autres créateur·e·s d’avoir une connaissance du droit d’auteur et une volonté idéologique que des éléments adaptés ou réutilisés soient eux-mêmes sous licence libre ou dans le domaine public. C’est cet accès aux ressources légales qui fait que ces act·eu·rices se sentent plus sûr·e·s dans leur démarche d’édition numérique.
Une alternative à la sécurité par l’obscurité peut donc passer par l’acquisition des connaissances juridiques d’un côté, et de l’autre par la volonté de trouver d’autres stratégies créatives. La nécessité de ne pas uniquement compter sur l’obscurité va devenir de plus en plus importante, notamment à cause des nouvelles législations liées à la directive européenne récente sur le droit d’auteur dans le marché unique. La directive ayant été votée en mars 2019, les états membres ont jusqu’à mars 2021 pour la concrétiser dans des lois nationales. Si la majorité du droit d’auteur va rester telle qu’elle est déjà, il va quand même être appliqué de façon beaucoup plus massive. Avec l’application de ces nouvelles lois, le droit d’auteur va se transformer d’un droit activé par l’initiative des personnes impliquées vers une règle appliquée de façon algorithmique.
Malgré ses bonnes intentions de base, celles de vouloir mettre au même niveau les différents législations nationales et d’uniformiser la gestion du droit d’auteur entre différents supports, l’Union Européenne semble avoir raté plusieurs occasions importantes autour de la directive. Il me semble que les législateur·e·s auraient pu essayer de régler au moins une partie des problèmes que le droit d’auteur pose actuellement avant d’agrandir sa portée. Par exemple, il existe aujourd’hui des différences importantes entre les états membres de l’U.E. dans la façon dont ils implémentent les exceptions du droit d’auteur. La citation audiovisuelle est par exemple gérée différemment partout, ce qui fait qu’en France, la citation d’une image pose plus de problèmes qu’en Belgique[12]. Dans les lois Européennes, il manque un équivalent au statut de « fair use » comme ont pu l’établir les États-Unis. Ce statut permet une copie non-consentie par les ayants droit sous certaines conditions : en prenant en compte le nombre de copies, le contexte de la reproduction (par exemple dans un contexte pédagogique), si et comment l’original a été transformé et si la nouvelle œuvre est en compétition économique avec l’original. Ce statut donne une viabilité légale pour le détournement artistique et l’appropriation en art. En uniformisant les exceptions, et en créant des possibilités légales de reprises sous certaines conditions, l’U.E. aurait pu limiter les aspects du droit d’auteur qui ont l’impact le plus fort sur la création artistique tout en maintenant la partie permettant au créateurs et créatrices de négocier une rémunération pour la reproduction de l’intégralité de leur travail (puisque le fair use intervient notamment sur des copies partielles et transformées).
Le changement le plus important dans la directive consiste à rendre les plateformes numériques de partage légalement responsables des infractions de droit d’auteurs commises par leurs utilisat·eur·rice·s. Pour l’instant, ce sont les utilisat·eur·rice·s iels-mêmes qui sont responsables de leurs partages : les ayants droit peuvent demander aux plateformes de retirer des contenus, mais ce n’est pas vers elles qu’iels peuvent réclamer des dommages. C’est ce qui va changer avec l’application de la nouvelle directive : ce sont les plateformes qui vont devenir légalement responsables pour des infractions commises par leur utilisat·eur·rice·s. Pour éviter de courir des risques légaux, les plateformes vont devoir commencer à surveiller elles-mêmes les contenus sur leurs sites. Vu le volume des contenus publiés chaque jour, iels n’auront pas d’autre choix que de développer des filtres automatiques. Très controversée, l’obligation d’installer des « upload filters » destinés à filtrer au préalable chaque contenu mis en ligne par les utilisat·eur·rice·s a été enlevée de la directive en dernière minute. Mais il est très probable qu’un contrôle algorithmique des contenus sera le résultat de ces mesures. Cela existe déjà pour la musique : Youtube utilise le système ContentId, Facebook peut supprimer des posts live quand il y est détecté de la musique connue dans leur base de données. Maintenant qu’il existe un réel intérêt financier pour les plateformes, ce genre de système va sûrement voir le jour pour les images. Le déploiement de ces filtres va avoir un grand impact en ligne, et pas seulement parce que les filtres vont détecter des infractions qui n’en sont pas (les « false positives ») : aussi simplement parce qu’une majeure partie des contenus partagés en ligne à l’heure actuelle contient des infractions au droit d’auteur. Quel pourcentage des images partagées sur les réseaux sociaux est une création tout à fait nouvelle ? Reposter des images, des news, des livres, des archives est une pratique courante. Même avant de prendre en compte la création artistique qui dépend beaucoup de la citation et de l’adaptation, la citation visuelle est une partie intégrante du discours en ligne.
On pourrait alors se demander, quel en sera l’impact sur la stratégie de l’obscurité ? Tant que les images sont sur du papier ou dans une exposition, il n’y aura pas beaucoup de risques de filtrage. Mais le monde analogique et numérique sont de plus en plus entrelacés. Il suffira qu’une personne poste une image sur Instagram pour que les algorithmes installés sur les serveurs de ce géant du web puissent faire leur travail : comparer les photos avec une base de données massive fournie par des sociétés de gestion de droits et des autres representant·e·s des ayants droits. On risque alors que les infractions massives aux droit d’auteur commises par la plupart des graphistes-micro-éditeur·ice·s soient repérées. C’est à ce moment-là qu’on va vraiment se rendre compte de l’ampleur du droit d’auteur tel qu’il a été construit au fil des dernières décennies.
Aujourd’hui, la stratégie de la sécurité par l’obscurité commence à perdre son utilité, car on ne pourra bientôt plus ignorer le droit d’auteur. Quelle est alors la solution? D’un point de vue pratique, il me semble d’abord important de bien connaître le droit d’auteur. Cela fait immédiatement sens, parce que c’est un des droits que concerne le plus directement les créati·f·ve·s. De plus, ce n’est pas seulement utile pour comprendre comment copier, c’est aussi indispensable si vous êtes en train de négocier la diffusion de vos propres travaux. Ensuite, d’un point de vue pratique, respecter le droit d’auteur est vraiment la façon la plus simple de ne pas avoir d’ennuis. Même si on ne peut jamais se protéger à 100%, il est au moins possible de prendre des risques calculés.
Si vous tenez à la dimension de réutilisation et de partage, vous pouvez vous tourner vers l’écosystème du libre. Il est tout à fait possible de créer du contenu, de le mettre sous licence libre, et de réutiliser des contenus faits par d’autres publiés également sous licence libre, tout en respectant le droit d’auteur. J’ai passé des années au sein d’une équipe qui s’appelle Open Source Publishing[13], qui travaille de cette manière, et je crois dans la force de cet écosystème.
Mais pour toutes les œuvres que l’auteur.e n’a pas publié sous licence libre, cela reste quand même dommage qu’elles soient pour l’instant interdites de détournement, adaptation et citation sans autorisation préalable. Ainsi, on me demande souvent si je n’ai pas de « tricks ». Mais des tricks, je n’en ai pas. Tant qu’on ne réclame pas son droit de copier, on ne réclame pas pleinement le droit de créer et de publier. La seule option qui reste, c’est alors de militer pour que la législation change[14].
[1] À l’époque j’avais lancé le blog « I like tight pants and mathematics » et je travaillais entre autre avec le designer Australien Simon Pascal Klein et Tom Preston-Werner de la plateforme Github pour développer le dessin collaboratif des polices de caractère.
[2] L’emblématique Art Book Fair de New York n’existe que depuis 2004. En 2019, mon éditeur Onomatope a participé à 26 foires du livre, et seulement deux d’entre elles existaient avant 2010.
[3] Alessandro LUDOVICO, Post-Digital Print, La mutation de l’édition depuis 1894, Éditions B42, 2016.
[4] C’est une entité complète, dont les différentes parties sont littéralement reliées ensembles, et sa lecture ne nécessite habituellement pas d’autre appareil physique que des lunettes.
[5] Un projet de livre demande des investissements à chaque étape du processus ; et de gagner la confiance de mécènes, de pouvoirs subsidiants, d’éditeur.e.s, de diffuseu.rs.ses et de librair.e.s, qui sont tou.s.tes susceptibles d’avoir des préjugés qui restreignent la diversité de l’offre des livres sur le marché, tant au niveau des sujets que des profils des auteur.ice.s publié.e.s. La plateforme numérique « Futuress.org » aborde cette question avec une approche décidément post-numérique. En tant que « feminist library of design books that are yet to be written », le site montre des rendus 3D des livres desquels on peut découvrir le titre et le texte de présentation. Ainsi le projet travaille l’imagination collective.
[6] Matthew G. KIRSCHENBAUM, « The Other End of Print: David Carson, Graphic Design, and the Aesthetics of Media », Media in Transition Conference, MIT, Octobre 8, 1999, [en ligne], https://web.mit.edu/m-i-t/articles/index_kirschenbaum.html.
[7] Historiquement, les réseaux des zines ne dépendent pas de la vente en librairie: ils étaient (et sont encore) envoyés par la poste ou vendus de main à main, lors de concerts, …
[8] Il y a trop d’exemples à mentionner ici, mais déjà au sein du colloque, Bérénice Serra présentait ses éditions sur des expositions qu’elle organise dans des formats inattendus comme Google Street View (« Résidence », 2018), ou les téléphones de démonstration dans le magasin Fnac (« Galerie », 2016).
[9] Frank PROVOOST, « Het Cassettebandje Is Terug En de Uitvinder Snapt Niet Waarom. », NRC Handelsblad, 15 février 2018, [en ligne], https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/15/het-cassettebandje-is-helemaal-terug-a1592250.
[10] Pour plus de détails sur ces quatre points, voire chapitre 2.2, 5.1, 5.1 et 5.6 du livre Copy This Book, an artist’s guide to copyright (Eric SCHRIJVER, Éditions Onomatopee, 2018).
[11] Malheureusement, restreindre son public veut aussi dire que son contenu touche moins de personnes. Il s’agit donc d’une forme d’auto-censure.
[12] Concernant les limites de la citation visuelle et les différences entre jurisprudence belge et française, cet article montre en détail comment, dans le cadre européen, les exceptions au droit d’auteur offrent une marge de manœuvre très restreinte : Julien CABAY, Maxime LAMBRECHT, « Remix Prohibited: How Rigid EU Copyright Laws Inhibit Creativity », Journal of Intellectual Property Law & Practice 10, n° 5, 01 mai 2015, pp. 359–77, [en ligne],
https://doi.org/10.1093/jiplp/jpv015
[13] Open Source Publishing est un collectif bruxellois qui pratique depuis 2008 le design graphique, l’enseignement et la recherche avec un focus sur l’impact des outils numériques, en utilisant que des logiciels libres, [en ligne], https://osp.kitchen
[14] Remerciements : Merci à Loraine Furter pour la relecture et les conseils dans l’établissement de ce texte.