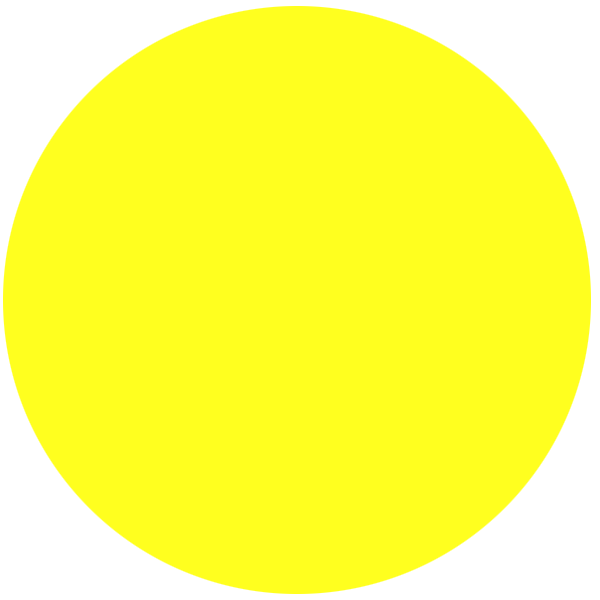

—
Résumé
Dans un monde où presque aucune activité humaine n’échappe aux programmes numériques, ces derniers prennent un caractère existentiel et engendrent un assujettissement du vivant à des logiques d’automation. Il en résulte un profond déséquilibre des milieux de vie (théories de l’effondrement, perte de la biodiversité, etc.) et une perte de sens de l’existence. Afin de cerner le concept de programme, nous associerons trois champs tendant à converger : le design, l’informatique et la biologie. Ce rapprochement permettra de formuler trois perspectives écologiques non binaires – autant de scénarios qui contestent le présupposé d’un design comme plan et qui le redéfinissent comme « art de l’équilibre », « zone de trouble », et « variation d’insignifiant ».
Texte écrit en 2020, actualisé en 2021 pour compléter les actes du colloque « Les écologies du numérique » organisé par l’Ésad Orléans (ÉCOLAB) en 2017 et 2018.
—
Mots clé
Biologie, Code, Design, Écologie, Génétique, Physique, Programmation, Programme
—
Biographies
Anthony Masure est responsable de la recherche à la Haute École d’Art et de Design de Genève (HEAD – Genève, HES-SO). Agrégé d’arts appliqués et ancien élève du département design de l’ENS Paris-Saclay, il est membre associé du laboratoire LLA-CRÉATIS de l’université Toulouse – Jean Jaurès. Ses recherches portent sur les implications sociales, politiques et esthétiques des technologies numériques. Il a cofondé les revues de recherche Back Office et Réel-Virtuel, et est l’auteur de l’essai Design et humanités numériques (éd. B42, 2017). Site Web : http://www.anthonymasure.com
Élise Rigot est agrégée d’arts appliqués, ancienne élève du département Design de l’ENS Paris-Saclay et diplômée de l’école Boulle. Elle est chargée de cours à l’université Toulouse − Jean Jaurès. Son sujet de thèse de doctorat en design (LLA-CRÉATIS et LAAS-CNRS) porte sur les f(r)ictions entre le design et les nano-bio-technologies. Elle est l’auteure d’un podcast, Bio Is The New Black, autour du design et des technologies de bio-fabrication. Elle publie dans la revue Sciences du design. Site Web : http://eliserigot.com
« En ce temps, en prévision des mutations à venir, d’obscurs constructeurs modelaient les images prématurées d’un futur éventuel très lointain.[1] »
Dans son recueil de nouvelles Cosmicomics (1965), l’écrivain Italo Calvino élabore une cosmologie hantée par des êtres polyformes, dont les soubresauts peuvent faire écho à l’ambition démiurgique du design. En effet, la faculté du design de pouvoir créer tous les objets possibles (« de la cathédrale à la petite cuillère[2] »), renvoie en creux à la volonté de façonner une réalité complexe et incertaine en adéquation avec un plan : les choses engendrent des comportements[3] (behavioral design) et dessinent des cadres permettant plus ou moins de liberté[4]. Cette définition commune du design comme « plan » (comme dessein) recoupe la définition d’un « programme », à savoir une suite d’actions visant un objectif déterminé.
La logique opératoire du programme est aujourd’hui omniprésente : depuis le développement à grande échelle des programmes informatiques, des laboratoires technoscientifiques (bio-impression, biologie synthétique, CRISPR CAS9, etc.), jusqu’au dessin des modes de vie. Cerner la notion de programme implique donc de rapprocher les trois champs que sont le design, l’informatique et la biologie. Mais si le monde entier devient un programme (un projet), qui décide, ou non, des conditions de l’équilibre entre les milieux humains et non humains, et selon quelles valeurs ? La notion de programme supposant une écriture « à l’avance » (pro-gramme), comment conjuguer l’élaboration de règles et de procédures propres aux pratiques de programmation avec le caractère incontrôlable du vivant ? La notion de programmation, « appliquée » au vivant, pourrait-elle redéfinir ce que l’on attend habituellement du design ?
Pour y voir plus clair dans ces enjeux et tracer quelques lignes de fuite, nous établirons tout d’abord une rapide généalogie de la notion de programme en croisant l’histoire de l’informatique et de la biologie pour montrer comment elle prend un sens politique voire existentiel. Nous verrons ensuite comment le design peut œuvrer à échapper à la logique fonctionnaliste et aux conséquences écologiques liées au déséquilibre des milieux (« 6e extinction », théorie de l’effondrement, perte de la biodiversité, etc.) qu’elle entraîne. Autrement dit : comment penser la notion de programme depuis des perspectives écologiques ?
« Programme » apparaît dans le dictionnaire autour de 1680. Dérivé du grec programma, de pro, « avant » et gramma, « ce qui est écrit », il peut se comprendre littéralement comme « ce qui est écrit à l’avance ». Avec l’émergence des médias de masse au début du XXe siècle, ce mot en vient à qualifier ce qui est annoncé en amont d’un objet temporel destiné à une large audience (radio, TV, etc.). Mais un autre sens, issu de la Révolution française (1789), mérite d’être examiné : c’est à cette époque que le terme de programme prend le sens d’« exposé général des intentions et projets politiques (d’une personne, d’un groupe) ». Il en vient alors, par extension, à désigner une suite d’actions que l’on prévoit d’accomplir en vue d’un résultat : « Le mot a développé des emplois didactiques en art, économie, architecture et musique avec le sens de base, « ensemble de conditions à remplir, de contraintes à respecter ». Il est en concurrence partielle avec plan. »
Avec l’invention d’un des premiers calculateurs, l’ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer, 1945), la notion de programme se lie à l’informatique. Le « master programmer » (programme principal) désigne alors le composant électronique en charge de contrôler le bon fonctionnement de chaque unité de la machine[5]. Par analogie aux personnes réalisant la « mise en place » de l’ENIAC (via des actions de câblage et décâblage de la machine pour résoudre des problèmes particuliers[6]), le mot « programmeur » apparaît pour caractériser non pas des éléments machiniques, mais des êtres humains. Toujours avec le développement des ordinateurs, le terme de programme change de sens, passant de « ce qui est transmis » (sens dérivé du « signal de programme » de l’ingénierie électronique) à « ce qui est responsable de l’exécution ». En France (1954), Raymond Ruyer définit le programme comme un « ensemble de dispositions déterminant l’ordre de fonctionnement d’une machine électronique[7] ». Dans l’entrée « Programmability » (programmabilité) de l’ouvrage Software Studies: A lexicon (2008), la chercheuse Wendy Hui Kyong Chun souligne ce qui sépare le programme (de l’ENIAC) de la programmation (des ordinateurs) : « La programmation d’un ordinateur analogique est descriptive ; la programmation d’un ordinateur numérique est prescriptive[8] ». En effet, dans la lignée des travaux de l’informaticien John Von Neumann, il est possible de définir un programme numérique comme un ensemble de règles stockées dans la machine (mis en mémoire), et donc d’appréhender le programme comme une suite d’écritures précédant (prescrivant) une action ou un comportement. Avec la prescription, le programme devient un donneur d’ordres et d’ordonnances de contrôle. Le programme impose un plan où la liberté n’a guère de place.
Avec le développement de l’informatique, la notion de programme ne s’applique plus seulement aux machines. Organismes, algorithmes génétiques, biodiversité technologique, etc., ces nouvelles matérialités du vivant exigent d’être attentif au milieu à la fois artificiel et naturel créé par les humains : celui-ci doit-il être programmé au sens d’un plan prescriptif ? Comment envisager, pour reprendre les mots de l’artiste Louis Bec, « le devenir d’un vivant indissociable de la liberté[9] » ? Existe-t-il un programme régissant le fonctionnement voire l’évolution du vivant ?
La question de l’évolution et de l’hérédité, qui renvoie directement à la possibilité d’un programme non pas électronique mais génétique, trouve son origine dans l’ouvrage What is Life ?[10] (1944), dans lequel le physicien Erwin Schrödinger postule l’existence d’un « code génétique » pour expliquer la présence d’un ordre à l’échelle microscopique, là où les lois de la physique traditionnelle ne s’appliquent pas : « Ce sont ces chromosomes […] qui contiennent sous la forme d’une espèce de code [code-script][11], le modèle intégral [pattern] du développement futur de l’individu et de son fonctionnement à l’état adulte[12]. » Il ajoute plus loin que « le terme code est […] trop étroit. Les structures chromosomiques servent en même temps à réaliser le développement qu’ils symbolisent. Ils sont le code loi [law code] et le pouvoir exécutif […], ils sont à la fois le plan de l’architecte et l’œuvre d’art de l’entrepreneur [builder’s craft][13] ».
À la suite de ce modèle du mécanisme héréditaire énoncé depuis la physique vers la biologie, l’école de la biologie moléculaire française (dont François Jacob, André Lwoff et Jacques Monod[14]) va opposer aux principes déterministes d’une conception mécanique du vivant le concept d’un « programme de l’hérédité », dans une formulation faisant écho au code informatique. La logique du vivant[15] (1970), un ouvrage d’histoire de la biologie rédigé par François Jacob, décrit ainsi l’hérédité en termes d’informations, de messages et de codes : « L’organisme devient ainsi la réalisation d’un programme prescrit par l’hérédité[16] ». Ici, l’exécution d’un dessein, d’un plan, n’a pas été réalisée par un programmateur humain mais répond à l’exigence de la reproduction de l’espèce. Ce programme est le fruit du hasard et des rencontres de l’organisme avec son milieu : « Le programme représente un modèle emprunté aux calculatrices électroniques. Il assimile le matériel génétique d’un œuf à la bande magnétique d’un ordinateur[17] » On pourrait y voir un rapprochement évident entre la cybernétique et la biologie moléculaire, proches historiquement, Jacob citant Norbert Wiener[18], père de la cybernétique[19]. Pourtant, selon l’école de la biologie moléculaire, on ne saurait expliquer la logique du vivant depuis un cadre déterministe voire mécanique : « La notion cybernétique de programme maintient de facto le vivant dans un cadre mécaniste où l’on procède nécessairement des parties vers le tout comme le ferait un horloger, en droite ligne avec le postulat de l’animal-machine de Descartes[20] ». Au pilotage cybernétique s’oppose le concept de « milieu ». François Jacob note ainsi que : « dans le programme sont contenues les opérations qui […] conduisent chaque individu de la jeunesse à la mort. […] Tout n’est pas fixé avec rigidité par le programme génétique. Bien souvent, celui-ci ne fait qu’établir des limites à l’action du milieu[21] ». Plus précisément, la notion de notion de « programme » de l’hérédité est établie par l’école de la biologie moléculaire pour rendre compte d’une histoire de l’évolution, inscrite au cœur de chaque cellule, et permettant à chaque entité vivante de transmettre des informations à la génération suivante. À mesure que le temps géologique passe, ce programme s’affine afin de permettre aux êtres vivants de se reproduire. François Jacob souligne la différence entre le programme génétique biologique et le programme informatique dès le début de son ouvrage[22] : le matériel génétique de la cellule n’est pas modifiable et s’appuie sur une organisation structurelle améliorante, tandis que la bande magnétique est réinscriptible, non structurelle, et ne peut pas s’améliorer toute seule. Établie en 1970 – soit donc à l’aube de l’informatique personnelle –, cette distinction est-elle toujours valable ?
Depuis les recherches de l’école de la biologie moléculaire, la situation technique a changé, rendant sans doute cette partition inopérante. Contrairement au caractère ancestral du « programme de l’hérédité », les modifications du génome (biologie synthétique) montrent que le code génétique peut être « édité » par l’action humaine. On pourrait en premier lieu penser aux OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) apparus depuis les années 1990, qui consistent à introduire dans un organisme un fragment du génome d’une autre espèce. Plus proche de nous, « l’édition génétique » de CRISPR se « contente » de modifier un gène, parfois très légèrement, pour « accélérer » son évolution dans un sens planifié. Les applications de CRISPR sur l’être humain pourraient ainsi permettre l’augmentation de la capacité musculaire ou l’éradication de maladies génétiques[23]. Ces exemples sont largement controversés, que ce soit dans les pratiques d’édition ou de modification génétiques, et tendent à montrer l’absence de prise en compte de la notion de « milieu » dans ces savoir-faire technoscientifiques.
Un travail entre art et design permet d’éclairer ces enjeux. Dans le projet Human × Shark[24] (2017), la designeuse Ai Hasegawa détourne l’imaginaire du « post-humain » – souvent caucasien et masculin –, et cherche à produire une relation inter-espèce avec un requin. Elle crée en laboratoire un fluide pouvant attirer des requins mâles et se filme dans l’eau avec eux lors d’une plongée sous-marine. La vidéo est accompagnée d’une installation de deux fragrances favorisant l’accouplement. Cette œuvre fait écho au récent développement d’« organes-sur-puce[25] » ou de flacons micro-fluidiques, faisant de la biotechnologie une possibilité d’hybridation et de collage du vivant.
Un autre exemple de rapprochement (voire de confusion) entre programme informatique et biologique réside dans les typologies contemporaines des « intelligences artificielles », à savoir celles du deep learning[26] (« apprentissage profond »). Ces dernières incarnent un changement de paradigme, où les règles ne sont plus écrites à l’avance, mais résultent de la comparaison de jeux de données « étiquetées » et « brutes » par des suites d’essais/erreurs. Dans cette logique, l’intervention humaine consiste à mettre en place les conditions de génération du programme. Il en résulte une impossibilité d’expliquer son fonctionnement – la seule chose qui compte (et qui est mesurable) étant son efficacité dans une situation donnée. Ces programmes informatiques d’un nouveau type peuvent, en un sens, être compris comme des entités vivantes dont on ne pourrait étudier que les corrélations entre les entrées (inputs) et les sorties (outputs). Les technologies du deep learning sont d’ailleurs désormais utilisées pour classer le génome ou les maladies[27]. On pourrait aussi mentionner le développement des biopuces, dans les années 1990, capables de transformer une réaction biologique en signal électronique[28].
Ces quelques éléments montrent qu’il faut envisager la notion de programme dans un sens élargi et comme condition existentielle. Si la distinction entre informatique et biologie n’opère plus, c’est que la mise en programme du monde révèle des convergences entre disciplines scientifiques : le bit informatique rencontre le gène biologique. Cette réalité est tout autant présente dans les pratiques que dans le langage. François Jacob se demandait en 1970, quels modèles langagiers régiraient la science de demain. Le programme donne vie à des grandes métaphores, telles que le gène dans l’histoire de la biologie[29], ou le code dans celui de l’informatique. Si les frontières qui séparaient les programmes biologiques et numériques tendent à disparaître, des études systémiques et écologiques se méfient de ces métaphores qu’elles jugent réductionnistes. Celles-ci construisent ouvrent autant de possibles qu’elles ne réduisent l’organisme à une suite alphanumérique. La « convergence » entre design, informatique et biologie n’est d’ailleurs pas un fait anodin ; l’idée d’une unification des sciences revient souvent dans le discours des technosciences comme un moyen d’augmenter les performances humaines[30].
Afin de comprendre en quoi le programme engage une dimension plus large que la résolution de problèmes via une suite d’actions ou que l’adaptation d’un être vivant à un milieu pour favoriser sa reproduction, il est utile d’examiner des textes rédigés en français par le théoricien des médias Vilém Flusser à partir du milieu des années 1970[31]. Son essai Post-histoire[32] (1982) s’ouvre sur l’évènement « incomparable » d’Auschwitz, que Flusser comprend, à la suite des philosophes Hannah Arendt et Günther Anders, comme l’aboutissement de la modernité : « Le camp d’extermination est occidental parce qu’il pousse directement des racines mêmes de l’Occident, de ses concepts et de ses valeurs. Auschwitz est implicitement contenu dans le projet initial de notre culture. Dans son < programme >[33] ». Pour Flusser, celui-ci fait de nous des « fonctionnaires » : il nous déresponsabilise de de nos actes et enlève le sens du travail pour faire de nous les rouages d’une machine plus vaste. L’entrée « Programme » de Post-histoire précise cette pensée. Selon Flusser, cette notion se substitue aux anciennes conceptions du monde, à savoir à la pensée finaliste (de la religion) et à la pensée causale (de la science). Plus précisément, Flusser redéfinit la notion de programme depuis la biologie moléculaire[34] : « Pour l’anthropologie programmatique l’homme est une permutation parmi d’autres permutations, de l’information génétique, commune à tout être vivant, et qui s’est réalisée par le jeu accidentel des gènes[35] » ; « Pour l’éthique programmatique le comportement humain est le déroulement de manifestations accidentelles des virtualités latentes dans l’homme et dans son milieu[36] » ; « [La pensée programmatique] applique à l’anthropologie le modèle de biologie moléculaire, selon lequel la structure de certain acides nucléaires contient toutes les formes possibles des organismes[37] ». Là où le programme de l’hérédité suppose l’existence d’un code favorisant la reproduction via l’adaptation à un milieu, Flusser l’examine du point de vue humain pour en faire non pas seulement une question de vie (de persistance dans le monde), mais d’existence (de sens et de non sens) : « Un programme c’est un système où toute virtualité inhérente se réalise par hasard, mais nécessairement. Il est un jeu[38] » – une telle formule peut se rapprocher des théories du biologiste Jacques Monod décrite dans l’ouvrage Le Hasard et la nécessité[39].
Flusser souligne la condition contemporaine régie par les programmes sous l’égide de l’’absurdité. C’est précisément cette tension entre hasard et nécessité qui intéresse Flusser, à savoir le caractère absurde d’une existence qui ne connaît pas les règles qui régissent son jeu. Il est vain de chercher à se libérer ou à s’émanciper des programmes car ces verbes perdent leur sens dans une pensée non finaliste : lire ou « démythifier », les programmes font de nous des fonctionnaires. Selon Flusser, ceux qui écrivent les instructions des programmes (les programmeurs) n’y échappent pas, d’une part car ils sont eux-mêmes programmés et, d’autre part car les appareils tendent à devenir « intelligents » et produisent des programmes sans intervention humaine (cette intuition se réalisera dans le développement des technologies de machine learning). Par conséquent, nous n’avons d’autre choix que de jouer avec les programmes. Il nous faut accepter cette absurdité pour éviter de devenir les pions d’un jeu gigantesque ; « programmer ou être programmé[40] ». Dans ce contexte, les artistes et designers peuvent détourner les programmes de leur fatalité. L’artiste Grégory Chatonsky, dans ses recherches sur « l’imagination artificielle », questionne par exemple la part créative des intelligences artificielles. Dans la vidéo I’m only memory and I love only you (2019), l’artiste détourne une base de données d’images prise sur les réseaux sociaux et donne à voir une métamorphose à la fois belle et monstrueuse de mémoires et d’histoires de vie numériques.
Alors que Flusser ouvrait Post-histoire par le cas d’Auschwitz, et que Günther Anders voyait dans la « condition atomique » la fin de l’histoire universelle[41], le programme occidental menace à présent non seulement les êtres humains, mais l’ensemble du vivant – qu’on pense par exemple au rapport Meadows (1972), à la « 6e extinction » ou aux théories de l’effondrement[42], soit donc un déséquilibre complet des milieux de vie. S’il faut apprendre à « vivre dans les programmes[43] », ces derniers doivent donc s’ancrer dans des conditions laissant les être vivants (et pas seulement humains), « vivre ». D’autre part, la « condition programmatique » invite à dépasser la situation de subsistance (la vie limitée à la reproduction de l’espèce) pour accéder à l’existence[44], c’est-à-dire la capacité à dépasser une situation initiale : de transformer le programme.
Dans cette visée, l’assimilation du design à un plan, selon sa définition habituelle évoquée en introduction, est inopérante pour opérer de tels renversements. Aussi, nous proposons à l’inverse de comprendre le design comme ce qui permet d’affronter l’absurdité des programmes. Autrement dit, le design est moins ce qui façonne le monde depuis une suite d’instructions que ce qui permet de jouer, et donc d’exister, c’est-à-dire d’affronter l’entropie et la réalisation de chaque futur possible (il n’est pas souhaitable que chaque virtualité advienne au monde). Nous proposons, en guise d’ouverture, trois pistes pour des scénarios « non binaires », soit trois façons de jouer avec les programmes.
Les conséquences néfastes d’un déploiement toujours plus important du « programme occidental » ne pourront être évitées qu’à condition de sortir du dualisme humain/nature et de déployer de nouveaux critères de lecture du monde, ce à quoi nous invite la chercheuse Donna Haraway (à la même époque que Flusser) avec ses recherches associant biologie et féminisme. En 1985, dans son Manifeste Cyborg, Haraway note qu’« avec les machines de la fin du XXe siècle, les distinctions entre naturel et artificiel, corps et esprit, autodéveloppement et création externe, et tant d’autres qui permettaient d’opposer les organismes aux machines, sont devenues très vagues. Nos machines sont étrangement vivantes, et nous, nous sommes épouvantablement inertes[45] ».
Dans un texte intitulé « La nature de l’artificiel » (1990), le designer Ezio Manzini fait également remarquer que la distinction entre le naturel (non créé par l’humain) et l’artificiel n’a jamais été aussi floue : « Très longtemps, l’opération technique s’est limitée à transformer (au sens propre de « changer la forme ») quelque chose qui existait déjà ; aujourd’hui, nous ne sommes pas loin de la « création » ex nihilo : on « crée » de la matière inanimée (par la conception de nouveaux matériaux), de la matière vivante (grâce au génie génétique), et même des formes d’intelligence (avec la réalisation de « systèmes experts »)[46] ». Ce texte montre que le design, dans ses ramifications avec la biologie, engage une mutation de la notion de création faisant du designer un potentiel « démiurge ». Mais, souligne Manzini, cette nouvelle condition entraîne une situation d’instabilité potentielle à plus grande échelle, et pose donc un problème écologique. Si l’on entend sous le nom d’écologie une science des milieux humains et non humains, l’idée même d’une « création » ex nihilo interroge ce que l’on pourrait attendre du design : moins une science du projet qu’un art de l’équilibre.
Si l’écologie s’offre à nous tout autant comme une science et un art du soin[47], le design s’exerce aussi dans les imaginaires et l’art du récit. Dans l’édition en ligne The New Weatherman’s Cookbook[48] (2014), le chercheur en design David Benqué propose une série d’objets fictionnels de bio-hacking. Un « pirate pollen club » se propose ainsi de jouer de l’ambivalence entre le naturel et l’artificiel. Au sein de terrains de golfs utilisant des herbes modifiées génétiquement pour paraître plus verdoyantes, fortes et « naturelles », un tunnel de dispersion de graines est utilisé pour disséminer des espèces de graminées plus résistantes et résilientes que l’herbe (OGM) du golf, permettant à terme la suppression des gènes protégés par un brevet propriétaire. Cette fiction visuelle met en lumière l’industrie de gazon OGM à résistance sélective, où le design peut venir troubler le programme d’une résistance prédéfinie aux herbicides pour devenir un terrain accidenté et troublé.
Dans la préface de l’ouvrage Génétiquement indéterminé. Le vivant auto-organisé[49], la philosophe des sciences Isabelle Stengers montre que « la distinction entre génotype et phénotype ne permet pas de poser la question de ce que nous appelons hérédité, mais prolonge […] en biologie des oppositions qui fascinent et bloquent la pensée, telles que l’inné et l’acquis, la liberté et le déterminisme[50] ». Le problème que pose le programme est bien celui de la liberté. Quelle liberté existe-t-il dans une vie dictée par un programme héréditaire, dans un programme culturel, dans un programme de mort ? Cette idée ressurgit aujourd’hui sous la forme d’un trouble : « Rester dans le trouble est le prix à payer si l’on essaie de ne plus penser les problèmes en termes de solutions indicatrices[51] », nous dit Stengers à la suite de Haraway. Jouer avec ce trouble, mettre du trouble dans les programmes, c’est ce que propose Haraway avec la figure du cyborg[52], à savoir un dépassement des notions de race, de genre ou de sexualité[53]. Haraway extirpe le cyborg des imaginaires militaires, pour lui donner une force hybride, contre-nature, et féministe : l’établissement d’une zone de trouble entre différents champs délimite un faisceau de sens inattendu, non prévu (une nouvelle information) qui s’oppose à la contingence de l’absurde. Ici, pas de méchants contre les gentils, pas de solutions face à des problèmes, pas de science et de vérités mais uniquement des savoirs et des histoires « situées ». Le cyborg recode la relation organisme/machine, genre/sexualité dans un nouvel ordre émancipateur et féministe. Il y aurait dès lors un paradoxe intéressant à penser un « design du trouble », c’est-à-dire non pas la volonté d’ordonner du désordre (selon un plan), mais proposer un nouvel agencement du réel où du jeu peut avoir lieu.
La chercheuse en design Marie Louise Juul Søndergaard explore cette position avec les technologies traitant des menstruations féminines. Dans sa thèse de doctorat intitulée Staying with the Trouble through Design: Critical-feminist Design of Intimate Technology[54] (2018), elle transpose la pensée de Donna Haraway pour voir le design comme une façon de provoquer le trouble. Sa vidéo Your smart toilet assistant[55] met en scène une jeune femme ayant l’âge et la situation de devenir mère. Elle demande à ses toilettes, dotées d’un assistant connecté et de capteurs biologiques, si elle devrait utiliser une protection pour ses prochains rapports sexuels en fonction de sa période d’ovulation. L’assistant, n’explicite pas la réponse, mais lui dit qu’il n’y a pas de risque qu’elle tombe enceinte. Quand il lui révèle, quelques semaines plus tard, qu’elle est enceinte, le scénario d’une erreur par l’assistant n’était pas prévu. Juul Søndergaard se demande comment concevoir des relations bilatérales avec les programmes numériques pour partager des situations de troubles, plutôt que de prétendre de leur efficacité à chaque instant. Un manifeste féministe accompagne cette thèse, et stipule que le design doit susciter et répondre au trouble, sans prétendre trouver des solutions à des problématiques tout autant sociales, culturelles, qu’éthiques. Dans cette vision féministe et critique du design c’est le fonctionnalisme du design qui est remis en question. Les situations ne fonctionnent pas, elles arrivent et s’entremêlent les unes aux autres, créant rencontres, contingences et hybridations de sens.
Le chercheur Thierry Bardini a étudié le malentendu consistant à penser que la cybernétique aurait directement influencé la biologie moléculaire. Dans son article « Variation sur l’insignifiant génétique » (2004), il commence par souligner les oppositions que revêt la notion d’information pour les deux disciplines mais en vient ensuite à réévaluer le rôle de la métaphore dans les contextes scientifiques. L’opposition entre cybernétique et biologie moléculaire, et par extension la compréhension du code génétique qu’elle entraîne, « a [selon lui] le désavantage de fermer le mode de référence de la métaphore du code génétique sur sa référence première : en assimilant métaphoriquement l’ADN au médium de l’hérédité, elle en arrive à considérer que l’ADN ne peut être que cela[56] ». En mettant en évidence l’existence de parties non codantes (non fonctionnelles) du code génétique[57], le « junk DNA », Bardini montre qu’il n’existe pas de pure adéquation de l’ADN au principe de l’hérédité[58] et que l’ADN supposément non codant, l’ADN « déchet », a certainement un grand rôle à jouer dans notre compréhension de ce code génétique. La conclusion de l’article de Bardini plaide pour une « hybridation […] entre des savoirs hyper spécialisés (biologie moléculaire, informatique, linguistique, physique quantique, etc.) qui sont autant de quêtes à jamais inachevées[59] ». La notion de « junk DNA » met en évidence les limites d’une compréhension du vivant comme pure entité fonctionnelle et déterminée, et montre que de l’imprévu peut surgir des programmes : les prescriptions ne peuvent jamais être pures, le code ne peut jamais être que du code. Dans cette optique, il serait fallacieux d’envisager une « fabrique du vivant » (et de design du vivant) de manière fonctionnelle et déterminée, puisque le vivant, au sens fort, est précisément ce qui résiste aux idées de déterminisme et de contrôle : tout projet comporterait un point aveugle, une dimension inconsciente, inutile, pouvant s’apparenter à du déchet[60]. Ces pratiques relèveraient plutôt d’une négociation avec les vivants avec qui il faudrait apprendre à communiquer pour trouver un terrain d’entente et de co-création. Bardini a lui-même mis à l’épreuve de telles idées à l’occasion d’une installation interactive (2015) intitulée Your Synthetic Future (at the speed of light)[61] : « Un dispositif ironique en forme de machine oraculaire [qui] permet de comprendre que la véritable originalité de la biologie synthétique réside dans sa capacité à produire de nouvelles formes de présence à travers la frontière, jadis infranchissable, qui sépare les modalités analogiques et numériques de l’existence[62] ». Plus précisément, cette machine bio-informatique « répond » à des questions via des bactéries procaryotes connectées à un écran, éliminant ainsi la source humaine des erreurs, les idéologies, le conservatisme et la résistance au changement.
Ces trois pistes pour des scénarios non binaires (dépasser la distinction naturel/artificiel ; troubler les programmes ; coder sans fonctionner), issues du croisement entre programmes informatiques et programmes génétiques, nous ont amenés à remettre en question le présupposé d’un design comme comme plan et à le redéfinir comme art de l’équilibre et du réagencement, zone de trouble, et variation d’insignifiant. Pour reprendre le titre d’un ouvrage de Flusser, le design consisterait moins à créer des objets qu’à articuler des « choses et non choses[63] », c’est-à-dire des entités matérielles (hardware) et des informations (software) : « En examinant le nouvel environnement, on peut mettre entre parenthèses les derniers restes de choséité qui adhèrent encore aux non-choses. L’environnement devient de plus en plus mou, nébuleux, sinistre ; et celui qui veut s’y orienter doit prendre pour point de départ ce caractère spectral[64] ». Flusser se demande ainsi « de quelle sorte sera donc cet homme qui, au lieu de se consacrer aux choses, se consacrera à des informations, à des symboles, à des codes, à des systèmes, à des modèles[65] ». Pourrait-on y voir une possible redéfinition du rôle du designer ? Selon nous cette habileté à combiner des symboles doit moins être comprise comme une augmentation du programme occidental que comme une façon de le « troubler », de contrer l’entropie qui fait qu’une chose équivaut à toute autre, de montrer que du possible peut échapper au non sens de ses variations infinies. Mais ces configurations, et c’est ce que montre la biologie, ne peuvent pas et ne doivent pas être stabilisées, elles doivent toujours permettre du jeu, des métamorphoses, des reconfigurations. Dans ce brouillard informationnel, « spectral », des voix peuvent émerger pour donner sens à des variations plutôt qu’à d’autres. Le monde n’est pas un projet, une entité hors sol que le design peut se donner comme but de programmer : le détour par la biologie, objet de cet article, montre que la délimitation de faisceaux de variations et l’adaptation au milieu s’opposent à la dimension existentielle, démiurgique, cosmologique du programme. Réciter le programme, mettre en paroles ses instructions, est déjà une façon de le jouer et le déjouer, c’est prouver qu’il est possible de contrecarrer sa dimension absurde.
[1] Italo CALVINO, « Sans les couleurs », Cosmicomics, trad. de l’italien par Jean Thibaudeau, Paris, Éditions du Seuil, 1968 (1965).
[2] L’artiste William Morris, fréquemment cité comme un précurseur du design, déclarait que « la véritable unité de l’art est un bâtiment avec tout son mobilier et toutes ses ornementations ». L’historien d’art André Chastel, énonce en 1964, lors de la mise en place de l’Inventaire général des richesses patrimoniales de la France, que celles-ci s’étendent de « la cathédrale à la petite cuillère ».
[3] Emanuele QUINZ (dir.), Le comportement des choses, Dijon, Éditions Presses du Réel, 2021.
[4] Jehanne DAUTREY, Emanuele QUINZ (dir.), Strange Design. Du design des objets au design des comportements, Grenoble, Éditions It, 2014.
[5] David GRIER, « The ENIAC, the Verb « to program » and the Emergence of Digital Computers », IEEE Annals of the History of Computing, vol. 18, n° 1, été 1996, [en ligne], https://doi.org/10.1109/85.476561
[6] Sens attesté dans le TLFi comme « action de préparer un ordinateur en vue de l’exécution d’un programme ».
[7] Raymond RUYER, La cybernétique et l’origine de l’information, Paris, Éditions Flammarion, 1967 (1954).
[8] Wendy Hui Kyong CHUN, « Programmability », in Matthew FULLER (dir.), Software Studies: A lexicon, Cambridge (MA), MIT Press, 2008, p. 224.
[9] Louis BEC, « Les gestes prolongés : postface », in Vilém FLUSSER, Les Gestes, Cergy, Éditions D’arts, 1999, [en ligne], http://www.flusserstudies.net/node/115
[10] Erwin SCHRÖDINGER, Qu’est-ce que la vie ?, trad. de l’anglais par Léon Keffler , Paris, Éditions Christian Bourgois, 2014 (1944).
[11] Edward EIGEN, « The Housing of Entropy: On Schrödinger’s Code-Script », Perspecta, vol. 35, 2004, p. 62–73, [en ligne], http://www.jstor.org/stable/1567344
[12] Erwin SCHRÖDINGER, Qu’est-ce que la vie ?, op. cit., p. 57.
[13] Ibid., p. 58.
[14] Voir notamment : François JACOB, La Logique du vivant. Une histoire de l’hérédité, Paris, Éditions Gallimard, 1970 ; André LWOFF, Agnès ULLMANN (dir.), Origins of molecular biology: a tribute to Jacques Monod, New York, San Francisco, Londres, Academic Press, 1979 ; Jacques MONOD, Le Hasard et la Nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris, Éditions du Seuil, 1970.
[15] François JACOB, La Logique du vivant. Une histoire de l’hérédité, op. cit.
[16] Ibid., p. 10.
[17] Ibid., p. 17.
[18] Ibid., p. 272.
[19] Ibid., p. 208.
[20] Sylvie POUTEAU (dir.), Génétiquement indéterminé. Le vivant auto-organisé, Versailles, Éditions Quæ, 2007, p. 163.
[21] François JACOB, La Logique du vivant. Une histoire de l’hérédité, op. cit., p. 18.
[22] Ibid., introduction.
[23] Rémi SUSSAN, « Aux origines de CRISPR », InternetActu, février 2018, [en ligne], http://www.internetactu.net/2018/02/08/aux-origines-de-crispr.
On retrouve ici les limites d’une opposition entre réparation et augmentation : la réduction des facteurs conduisant à ces maladies avantagerait mécaniquement les personnes pouvant accéder à ces mutations génétiques.
[24] Ai HASEGAWA, Human × Shark, 2017, https://aihasegawa.info/human-x-shark
[25] Un organe-sur-puce est un modèle physio-biologique d’un organe mimant à la fois l’environnement cellulaire et les fluides présents pour faire fonctionner l’organe et permettre ainsi son étude sur des puces fabricables à grande échelle.
[26] Anthony MASURE, « Résister aux boîtes noires. Design et intelligence artificielle », Cités, n° 80, décembre 2019, p. 31–46, [en ligne], http://www.anthonymasure.com/articles/2019-12-resister-boites-noires-design-intelligences-artificielles
[27] Sarah WEBB, « Deep learning for biology », Nature.com, février 2018, [en ligne], https://www.nature.com/articles/d41586-018-02174-z
[28] Véronique ANTON LEBERRE, « Biopuces : applications et devenir », Techniques de l’ingénieur, mai 2013, [en ligne], https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/biomedical-pharma-th15/nanotechnologies-et-biotechnologies-pour-la-sante-42608210/biopuces-applications-et-devenir-bio7150/
[29] Evelyn FOX KELLER, Le siècle du gène, trad. de l’anglais par Stéphane Schmitt, Paris, Éditions Gallimard, 2003 (2000).
[30] Voir : Bernadette BENSAUDE-VINCENT, Les Vertiges de la technoscience, Paris, Éditions La Découverte, 2009. L’auteure souligne (p. 69) que la convergence NBIC est souvent vue comme allant de soi pour la plupart des acteurs des technosciences, qui voient dans l’échelle nanoscopique une manière d’unifier les sciences et de servir leurs projets.
[31] L’étude de ces textes inédits a été entreprise par Anthony Masure grâce au projet de recherche « Formes de l’invisible. Archéologies graphiques du design avec le numérique », financé par le Centre national des arts plastiques, dispositif « Soutien à la recherche en théorie et critique d’art » (session 2017).
[32] Vilém FLUSSER, Post-histoire, Introduction d’Anthony MASURE, propos liminaire de Catherine GEEL, postface de Yves CITTON, Paris, Éditions T&P Work UNiT, 2019 (1982).
[33] Vilém FLUSSER, « Notre sol », in Post-histoire, Paris, Éditions T&P Work UNiT, 2019, p. 36.
[34] Ainsi que depuis la thermodynamique et la psychanalyse.
[35] Vilém FLUSSER, « Notre programme », in Post-histoire, op. cit., p. 50.
[36] Ibid., p. 51.
[37] Ibid.
[38] Ibid.
[39] Jacques MONOD, Le Hasard et la Nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris, Éditions du Point, 2014 (1970).
[40] Xavier DE LA PORTE, « Programmer ou être programmé ? », InternetActu, novembre 2010, [en ligne], http://www.internetactu.net/2010/11/02/programmer-ou-etre-programme/
[41] Günther ANDERS, Hiroshima est partout, (traduction collective, préface de Jean-Pierre Dupuy, Paris, Éditions du Seuil, 2008, p. 146.) : « Le 6 août 1945 fut le jour zéro. Le jour où il a été démontré que l’histoire universelle ne continuera peut-être pas, que nous sommes en tout cas capables de couper son fil, ce jour a inauguré un nouvel âge de l’histoire du monde ».
[42] Élise RIGOT, Jonathan JUSTIN STRAYER, « Retour vers 1972 : rouvrir les possibles pour le design et l’économie face aux effondrements », Sciences du Design, n° 11, 2020, p. 26–35.
[43] Yves CITTON, Anthony MASURE (dir.), « Vilém Flusser : vivre dans les programmes », Multitudes, n° 74, avril 2019, dossier des textes inédits rédigés en français.
[44] Sur la distinction entre vie et existence du point de vue du design, voir : Pierre-Damien HUYGUE, « Design et existence », in Brigitte FLAMAND (dir.), Le design. Essais sur des théories et des pratiques, Paris, Éditions IFM/Regard, 2006, p. 205–214.
[45] Donna HARAWAY, « Manifeste Cyborg », Manifeste cyborg et autres essais. Sciences-Fictions-Féminismes, anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Paris, Éditions Exils, 2007, p. 35.
[46] Ezio MANZINI, « La nature de l’artificiel », in Artefacts. Vers une nouvelle écologie de l’environnement artificiel, trad. de l’italien par Adriana Pilia, Paris, Éditions Centre Pompidou/CCI, 1991 (1990), p. 52–53.
[47] Isabelle STENGERS, Résister au désastre, dialogue avec Marin Schaffner, Marseille, Éditions Wildproject, 2019. Isabelle Stengers précise (p. 57) que l’art du soin nécessite de l’imagination et une culture du récit dont les scientifiques sont habituellement privés.
[48] David BENQUÉ, The New Weatherman’s cookbook [« Publication about fictional activist group The New Weathermen, including their manifesto, propaganda posters, device blueprints, research, and images »], visuels imprimés, 2014, [en ligne], https://davidbenque.com/projects/the-new-weathermans-cookbook
[49] Sylvie POUTEAU (dir.), Génétiquement indéterminé, op. cit.
[50] Ibid., p.10
[51] Isabelle STENGERS, Résister au désastre, dialogue avec Marin Schaffner, op. cit., p. 33
[52] Donna HARAWAY, Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press, 2016 (traduction à paraître aux éditions Des mondes à faire). Donna Haraway convoque, dans la suite de ses travaux, d’autres compagnons de pensée, tels que les pigeons, les coraux, une araignée et le compost pour poursuivre ses histoires situées troublantes.
[53] Donna HARAWAY, « Manifeste Cyborg », op. cit.
[54] Marie Louise JUUL SØNDERGAARD, Staying with the Trouble through Design: Critical-feminist Design of Intimate Technology, thèse de doctorat codirigée par Lone Koefoed Hansen et Geoff Cox, School of Communication and Culture Aarhus University, Institut for Kommunikation og Kultur, 2018, [en ligne], https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/289
[55] Marie Louise JUUL SØNDERGAARD, Lone KOEFOED HANSEN, « Intimate Futures: Staying with the Trouble of Digital Personal Assistants through Design Fiction », actes de colloque (DIS 2018), Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp. 869–880, [en ligne], https://dl.acm.org/doi/10.1145/3196709.3196766. L’article est accompagné d’une vidéo placée en annexe.
[56] Thierry BARDINI, « Variations sur l’insignifiant génétique : les métaphores du (non-)code », Érudit, n° 3, « Devenir-Bergson », printemps 2004, p. 162–186, [en ligne], https://doi.org/10.7202/1005473ar
[57] Ibid., p. 184–185 : « Et si l’ADN était un médium multiplexe, capable de conduire (de transmettre) à la fois les messages de la synthèse protéique et d’autres messages ? »
[58] Ibid., p. 182.
[59] Ibid., p. 186.
[60] Sur la fausse opposition entre objet et déchet comprise depuis une lecture critique de Vilém Flusser, voir : Anthony MASURE, Victor PETIT, « Pour un design radicalement circulaire. À propos des « Considérations écologiques » de Vilém Flusser », Flusser Studies, n° 31, juillet 2021, [en ligne], http://flusserstudies.net/archive
[61] Thierry BARDINI, Laura BELOFF, Erich BERGER, Cecilia JONSSON, Antti TENETZ, Your Synthetic Future (at the speed of light), installation interactive, Helsinki, galerie Lasipalatsi, 22–31 mai 2015.
[62] Thierry BARDINI, « Future life will be synthetic: About the emergence of engineered life, its promises, prophecies and the formal causalities needed to make sense of them », Social Science Information, vol. 55, n° 3, 2016, p. 369–384, [en ligne], https://doi.org/10.1177/0539018416638950
[63] Vilém FLUSSER, Choses et non choses. Essais phénoménologiques [Dinge und Undige, recueil posthume], trad. de l’allemand par Jean Mouchard, Paris, Éditions Jacqueline Chambon, 1996 (1993).
[64] Ibid., p. 99.
[65] Ibid., p. 101.