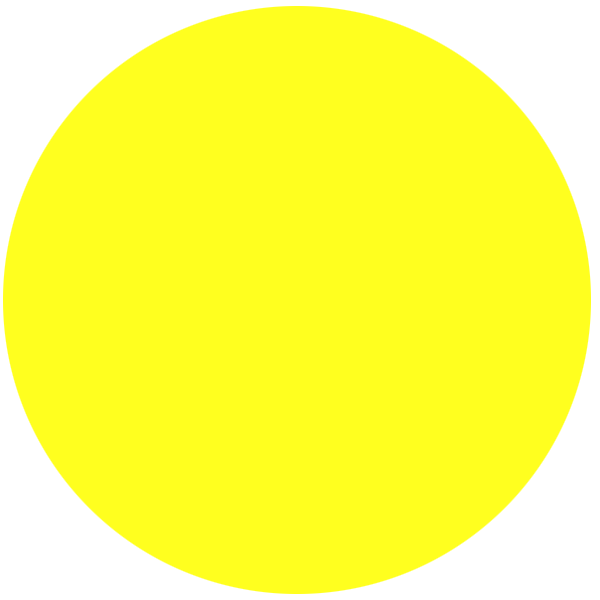

—
Résumé
La question posée ici est simple tout en étant redoutable : comment définir un design graphique proprement écologique? La question est simple car elle concerne toutes les disciplines du design depuis longtemps déjà. Elle est redoutable car elle n’est pas universellement partagée dans le monde du graphisme et elle nécessite de s’interroger sur la nature et l’histoire du graphisme indépendamment du design. Le rôle de la « graphie » dans l’entreprise d’arraisonnement et de contrôle du monde par la société occidentale est considérable et particulièrement depuis l’avènement du numérique. Pour en comprendre les enjeux spécifiques, l’analyse présentée s’attache à un exemple historique, celui de la typographie du Romain du Roi conçue pour Louis XIV. Cette analyse est proposée à travers le spectre l’écosophie de Guattari pour considérer l’ensemble des dimensions du problème et déterminer ce qui caractérise une compétence de graphisme en écologie à la fois territorialisée et mineure.
—
Mots clé
Écologie, design, graphisme, écosophie, signe, pouvoir
—
Biographie
Yann AUCOMPTE
Designer graphique et chercheur, il est Professeur Agrégé en section supérieure de design graphique. Il enseigne en DNMADe “graphisme”, sur les parcours « Supports didactique et de médiation” et “Design de livre et d’édition” au Lycée Jean-Pierre-Vernant de Sèvres, France. Il est par ailleurs doctorant à l’EDESTA, sous la direction de Roberto Barbanti, Université Paris-8, TEAMeD-AIAC (EA 4010), Saint-Denis, France. Il est membre du collectif de recherche transdisciplinaire « Arts, Écologies, Transitions ».
http://www.graphismeartimplique.design
Dans un contexte de vif réveil de la conscience écologique, le design graphique accueille pourtant assez diversement ces préoccupations. Pour ceux qui se sentent impliqués en tant que citoyen, il reste que les formes de design graphique susceptibles d’intégrer les questions écologiques sont encore très peu partagées, pour ne pas dire absentes. Si le design dans son ensemble a pris conscience de ces questions et a offert des solutions de longue date (Papanek (1923-1998), Paepcke (1896-1960), Buckminster Fuller (1895-1983)) le graphisme a quant à lui adopté cette problématique de façon encore trop timide.
Alors comment définir une activité de graphisme qui serait proprement écologique ? La question porte en fait sur la nature même de l’activité de graphisme. Il faut sortir d’une tendance à catégoriser cette activité sous le haut patronage du design et réfléchir à ce qui la caractérise en propre, une tentation pourrait nous inciter à partir du processus de design : elle consisterait à définir le design graphique comme quelque chose qui serait du graphisme en design, ou du graphisme porté par les enjeux de design. Or, le graphisme précède l’invention du design et son ère, l’essor de l’industrie. Un autre biais, courant, pourrait nous pousser à imaginer un graphisme qui ne soit pas anthropocentré, un graphisme qui serait écologique ou écosophique, en nous référant à sa nature fondamentale – en l’essentialisant. Ce que nous appelons graphisme a une histoire longue. Lorsque nous parlons de graphisme il faut envisager d’emblée les questions de signes et d’écritures. Le problème qui se pose à nous est que, une fois défini en ces termes, le graphisme est le moteur d’une organisation sociétale dont l’objet même est la domestication de la Nature. Il modèle nos représentations et influence nos perceptions de l’environnement. En tant que gestes, il reflète une certaine tentation humaine de mettre à distance le monde en l’enregistrant, puis en le contrôlant — ce qui engage la nécessité politique de maîtriser ces traces et ces formes. Elles sont des moyens d’exercer un pouvoir, et portent en elles les problèmes que nous souhaitons résoudre. L’indifférence du milieu du graphisme à l’endroit de ces problématiques n’est en rien un hasard au regard de son histoire.
Des travaux de théoriciens (sociologue, philosophe, historien, etc.) décrivent déjà le rôle que joue le graphisme, ou ce que nous appellerons la graphie (écritures et signes), dans l’entreprise d’arraisonnement et de contrôle du monde par la société occidentale. Il s’agit de partir du postulat que le numérique procède de cette logique d’organisation et de prévision scripturale, et qu’il en réalise le projet. L’analyse propose donc ici une mise entre parenthèses des questions spécifiquement médiologiques du numérique qui intéressent ce recueil. Paradoxalement, il s’agit cependant d’étendre la question à certaines qualités pleinement réalisées par le numérique, mais qui sont en fait héritées de tendances de fond apportées par l’écriture. Pour comprendre comment la rationalité et l’arraisonnement sont à l’œuvre dans les projets de graphie, nous partons d’un exemple historique : Le Romain du Roi, un caractère typographique conçu pour Louis XIV. L’objet graphique est ici emblématique d’un projet de design graphique par sa quotidienneté : c’est un objet de détail qui pourrait paraître superflu. Son mode de conception est pourtant sans précédent, il introduit une rupture décisive dans les formes et le rapport de production. Une analyse réalisée au spectre des théories écologiques de Félix Guattari démontre comment s’y applique un certain esprit, et comment son esthétique relève de formes de relations sociales, de considérations sur la Nature et l’environnement, sur le pouvoir et le symbolique. Nous sommes aidés pour cela par une histoire de la pensée qui s’est construite autour de philosophes comme Descartes et Bacon[1] et des pratiques politiques, techniques, artistiques et discursives qui ont fondé la matrice esthétique et pratique des moyens de destruction réels de la Nature – à tout le moins les ont rendus désirables[2]. L’enjeu est de comprendre ce qui participe du graphisme dans la crise environnementale.
Il y a avec notre entreprise comme un impossible dépassement des défauts de notre propre discipline, un dialogisme (au sens de Morin[3]). Pour reconfigurer notre approche d’un graphisme qui serait écologique, la philosophie de Félix Guattari sur ces enjeux apporte un éclairage intéressant. Aussi en traitant la question sous l’angle de l’écosophie guattarienne[4], nous ne pouvons plus isoler la Nature de l’environnement, de l’économie, du symbolique, de la psychologie et du social. Si nous prenons ce chemin, la pratique du graphisme doit traduire quelque chose comme la pluralité des voies et des voix de tous les êtres du monde, prendre en compte leurs diverses manières d’être et d’apparaître, mais surtout adopter une forme de prudence dans la pratique du design graphique. Qu’est-ce qu’un graphisme écosophique aujourd’hui pourrait vouloir poursuivre ? Comment pourrait-il s’insérer dans un projet de pluralisation et de traduction des différents modes d’existence qui constituent la réalité ?
Il est vrai que depuis le design la question écologique pourrait paraître circonscrite aux processus de fabrication et d’impression : un papier recyclé, une encre végétale, une économie des matériaux et le refus des encres en ton direct. La discipline a intégré de fait les transformations du système productif de l’imprimerie, qui obéit maintenant à des normes écologiques sur les papiers (certification FSC), les encres (hydrocarbures remplacés par des additifs végétaux) et les rejets toxiques (ISO 14001, label Imprim’vert). Mais que faire d’un produit d’un système consumériste imprimé avec ces normes — la plaquette Total sur papier recyclé, le sachet de frites McDonald’s imprimé avec des encres végétales ou une réduction notable de l’encre sur les bouteilles de Coca-Cola ? Ce serait encore renvoyer l’impact du signe à ses simples constituants matériels. En effet, si nous persistons à définir le design de façon moderniste, la question reste avant tout matérielle lorsque l’on parle de production. Très vite la rationalité productive prend le dessus et domine la recherche en « toute chose du moyen le plus efficace[5] ». Les designs d’objet, de mode ou d’espace entretiennent avec les propriétés matérielles de leurs productions un lien prioritaire auquel échappe en grande partie le design graphique.
L’angle que nous adoptons ici est sensiblement différent : il s’agit de traiter ce qui caractérise une compétence de graphisme en écologie : comment le graphisme, par ses caractéristiques propres et son histoire disciplinaire, peut offrir une éthique environnementale satisfaisante. Non pas « comment peut-il adapter à ses modalités propres les avancées écologiques qu’ont accomplies le design objet ou le design textile ? », mais « qu’est-ce qui, de ses propriétés mêmes, pourrait infléchir le cours dévastateur de notre influence sur la Nature » ? Comment pourrait-il nous aider à passer le cap de ce que nous nommons dorénavant l’ère de l’Anthropocène ?
Comme son appellation et son histoire le laissent présager, le graphisme est affaire de signes plus que d’images, de marquages plus que de manipulations, et de sens plus que de fonctions. Ses objets sont l’écriture, les symboles, les signes, les signaux, les schémas, les photographies et toutes formes d’images qui se révèlent comme des agencements de signes[6]. Les plus élégantes solutions de graphisme en écologie sont souvent des approches de design d’objet qui intègrent du graphisme, mais ne sont pas « du graphisme ».
C’est un fait notable de l’histoire du design, les signes y sont soumis à un traitement qui ne semble pas intégrer les problématiques propres à leurs usages. Prenons ce qui est souvent considéré comme le point départ du design : le Bauhaus. Un de ses enseignants, Herbert Bayer — il dirige un temps l’atelier d’imprimerie et de publicité de l’école —, a développé des travaux sur le caractère typographique universel. Conformément à ses principes, perdurant dans l’esprit du design aujourd’hui, il a traité de typographie dans une rupture avec les savoir-faire des métiers traditionnels (ici de l’imprimerie[7]). Il a appliqué une vision (ontologie) mystique matérialiste moderne aux formes des lettres, en fonctionnant comme avec les objets[8] et les espaces[9]. En effet, pour l’esprit moderniste du Bauhaus, la production obéit à l’éthique vitaliste de la simplification des formes et à l’exaltation des forces intrinsèques des matériaux[10]. Dans une croyance philosophique dérivée de Kant, les formes abstraites y sont les conteneurs les plus proches de la perception humaine[11], par cette proximité le designer rend plus lisible les propriétés des matériaux dans des « matières formelles[12] ». Or, pour le métier, la typographie ne peut se penser dans ce vitalisme synthétique[13] : la lettre, comme n’importe quel signe, ne se résume pas à l’encre qui l’imprime[14]. La purification des formes afin de libérer les forces de l’encre, comme celles des formes d’une chaise avec la force de ses matériaux, ne rendra pas la lettre plus efficiente. En effet, Bayer, comme coincé par cette double injonction, ne peut manier une matérialité potentielle de la typographie, mais au contraire déréalise dans des formes idéelles les signes graphiques, hérités de la Renaissance (notamment les formes du romain de Jenson). Il les réduit à des formes a priori de la sensibilité (espace et temps[15]). Pour les typographes de métier la simplification radicale des formes n’appelle en rien « aux facultés de perception “immédiate” et naturelle[16] » de l’être humain. La tradition de la typographie, qui est celle de l’écriture occidentale, est fondamentalement liée aux effets d’apparence et aux corrections optiques : elle joue formellement des défauts de perception et ne cherche pas son essence dans un matérialisme. Elle est liée à la perception humaine et ses limites, historiquement construites.
Comment amener une discipline si fondamentalement anthropocentrée (aux sens de Descola[17]), même logocentrée[18] voire sémiocentrée[19], à s’intéresser à la Nature ? Anthropocentrée, car elle voit tout depuis l’esprit humain ; logocentrée, car elle perçoit tout sous le modèle du sens véhiculé ; sémiocentrée, car elle fait de tout objet une composition de signes. Dans cette perspective, l’environnement naturel est presque impossible à penser, et donc à prendre en compte. L’affaire de la graphie est celle du sens construit, de l’imagination, de la conscience, des formes de transmission — la Nature et son existence ne sont pour elle que des sujets. Dans une certaine vision historique, il pourrait même être possible de dire qu’elle invente la Nature comme un sujet extérieur aux activités humaines[20]. C’est que le graphisme pré-existe aux moments fondateurs du design, avant son « invention » avec le Bauhaus, loin même au-delà du métier de graphiste, dont le terme est adopté[21] au XXe siècle. En premier lieu, du fait que graphisme et écriture se confondent historiquement, les scribes, les graveurs-sculpteurs de lettres, les maîtres-écrivains, les calligraphes, les moines-copistes, les écrivains publics, les notaires, les imprimeurs, les secrétaires (garants du secret) dans les mystères des ministères, sont tous les graphistes de leur époque. Là où l’on reproduit textes, signes et images, un « équivalent graphiste en compétence » pense et prépare les éléments pour leur production et donne une autorité aux formes, participant ainsi à légitimer le message. Depuis les esclaves recopiant les journaux romains à la main jusqu’à la presse quotidienne, en passant par la méthode de la pecia des copistes médiévaux, les techniques graphiques visent à reproduire rapidement un vecteur de sens faisant autorité. Avec la minuscule caroline, Charlemagne œuvre graphiquement et politiquement en commandant un travail de conception graphique sur les qualités communicationnelles de l’écriture[22]. Sous son ordre, les « scribes » ont adopté cette écriture conçue dans l’abbaye de Corbie. Dans et par ce rôle, les graphistes ont participé à la diffusion de l’information et du sens, en ont modelé les cadres de réception et structuré l’esthétique. Les formes graphiques s’inscrivent dans leur époque et participent à en construire l’esprit, la politique et l’imaginaire. Mais pourquoi cette incroyable omniprésence nous empêche en vérité de subvertir le graphisme pour qu’il obéisse à une éthique écosophique ? Peut-on, de façon efficiente, parler d’une discipline écosophique qui se construirait à partir de la nature du graphisme, de l’écriture et du signe ?
À cette dernière question, il faut d’emblée répondre « non », sans autre démonstration préalable. La graphie (signes et écritures) est ce qui, chez l’humain, caractérise le mieux sa tendance au contrôle, à l’organisation du chaos et à la volonté d’ordonner le monde dans un sens maîtrisable[23]. Le graphisme est une discipline très ancienne, dont la trajectoire anthropologique est même très claire : il apparaît avec l’humain[24], et ils se développent ensemble. Très tôt, la graphie manifeste un désir d’organiser le monde, d’arrêter son agitation et les changements incessants qu’il semble affecter : à titre d’exemple, le calendrier luni-solaire paléolithique de Sergeac[25] est une production graphique préhistorique dont l’objectif est certainement assez proche de cela : elle note (arrête) les phases de la Lune et du soleil. Par extension, cet incroyable pouvoir de notation visuel permet de prévoir et de mettre à distance les événements de la Nature (saison, récolte, semis, etc.). L’aspect visuel des signes est déterminant, car, en tant que sens de la distance, la vue permet de se préserver des événements dangereux bien plus que le son, le goût ou le toucher, qui sont quant à eux dans un rapport de contact ou de proximité[26]. C’est la résultante d’un fait physique notable : l’humain est un prédateur, son système de vision est situé sur la face de son crâne, contrairement aux proies qui possèdent majoritairement un système de vision latéral. De ce simple fait évolutif, la vision acquiert un rôle central dans la prise de pouvoir des humains sur leur environnement[27], car elle permet de voir arriver au loin et d’anticiper. Le graphisme vient ainsi comme un supplément à la vision frontale, son rapport au réel est un rapport de réduction : il transpose des référents des objets du réel sur une surface à partir de laquelle ceux-ci sont équivalents, comparables, séparés et manipulables entre eux[28].
La forme la plus emblématique de cette tendance « commerçante[29] » est certainement l’écriture mésopotamienne, mère des écritures. À l’origine, elle sert à dresser des comptes et des inventaires : on y liste des têtes de bétail, des contenus d’amphore, etc. L’écrit graphique rabat le multiple et le différent sous une même esthétique d’incision dans de l’argile[30]. Le système occidental d’écriture phonétique et les signes de calcul en constituent l’aboutissement contemporain. La particularité du système scripturaire occidental est qu’il est phonétique : il est donc plus à même de traduire tous les sons, et par conséquent de s’appliquer à d’autres langues que le Latin qui l’a vu naître[31].
De ce fait, le graphisme va devenir central dans l’organisation politique de l’Occident. Le XVIe siècle développe cette écriture sous la forme des caractères mobiles métalliques introduits par Gutenberg. Cette invention graphique et scripturaire accentue encore les propriétés rétiniennes de la graphie : répétabilité, équivalence, séparation, et codification du monde. L’écriture typographique réduit le monde des phonèmes en signes systématiques qui, pour la première fois, permettent de quantifier les opérations artisanales nécessaires[32] à la production. Par des représentations, le graphisme réduit les choses à des signes et des symboles. La typographie pousse encore plus loin cette organisation, elle constitue par son principe technique une grille d’éléments mesurés et mesurables[33]. L’humanisme va se constituer autour de cette technique. Dans son prolongement, la culture protestante, en même temps qu’elle libère l’interprétation des discours religieux, favorise une forme de mode de vie en commun axée sur le commerce et l’accumulation d’argent, interdits par le christianisme médiéval. Dans cette nouvelle approche du monde et de la Nature, l’humain est amené sur Terre pour réaliser la besogne que le Dieu protestant lui a assignée[34]. Obéir à ses Commandements, c’est transformer la Nature pour en tirer des richesses. Les formes graphiques y jouent un rôle déterminant, en particulier la comptabilité à double entrée et l’écriture (les lettres de change) par laquelle les marchands protestants font circuler de l’argent partout en Europe. Simple hasard de l’histoire : le moine italien Luca Pacioli, qui a mis au point cette technique de comptabilité, propose également la première tentative de géométrisation de la forme des lettres de l’alphabet latin. Le commerce a trait à des questions graphiques, depuis longtemps, sur les pièces de monnaie, le graphisme est frappé par les institutions qui en garantissent la valeur faciale. Il assure le prix, marque et atteste de la qualité fiduciaire.
Pour ces raisons, il est possible de dire que l’Occident constitue alors une graphosphère[35]. L’écriture et le signe sont les deux paradigmes visuels (rétiniens) qui influencent les activités d’un grand nombre de champs, dans un sens de plus en plus strictement organisateur et comptable à mesure que l’histoire occidentale avance. Les Lumières se développent également sur cette graphosphère et, avec elles, une certaine manière de concevoir la Nature. Les scientifiques éditent des livres dans lesquels ils décrivent des expériences et en dessinent les dispositifs afin qu’ils soient reproduits par d’autres, qui pourraient infirmer ou confirmer les observations[36]. Il n’y a pas de science moderne sans la publication et la diffusion des résultats d’expérience[37] à une communauté de scientifiques, sans la synthèse des données de l’expérience dans une série d’éléments réducteurs du réel[38] : chiffres, cadres d’expérience, descriptions propres à la discipline, etc. Par ces opérations, l’humanisme, en même temps qu’il construit la figure humaine rationnelle invente la Nature[39], extérieure et docile à l’humanité, qui en est « comme maître et possesseur[e][40] ». La graphie est donc un outil politique d’organisation du monde, qu’elle ne sert pas seulement à décrire. Cependant, cette trajectoire d’arraisonnement n’est jamais totalement réalisée et va trouver à s’organiser dans un nouveau rapport d’interaction entre science, droit, commerce, art et pouvoir. Sa forme graphique la plus exemplaire va nous servir d’entrée : le Romain du Roi. Pour révéler les différents enjeux écosophiques qu’il sous-tend, adoptons l’analyse en trois écologies[41] pour introduire toutes les parties prenantes à la formation des signes et quitter une définition formaliste et esthétique de l’activité de graphisme.
La conception du Romain du Roi est en rupture totale avec les modalités de la production typographique qui l’ont précédée. En effet, elle n’est pas encadrée par des gens du métier, et sa logique graphique est en rupture avec les méthodes artisanales. Ce mode d’organisation de la production émane directement d’une forme d’idéologie colbertiste, qui reflète une inclination intellectuelle rationnelle et comptable. Il est en fait l’organe d’une entreprise généralisée de prise de contrôle sur tout ce qui ne relève pas d’une production des abstractions de la pensée. Le graphisme y est perçu comme un art mécanique, manuel et donc servile. Il n’est pas question de partir du savoir de l’ouvrier, comme dans la peinture par exemple, avec Lebrun[42]. Et ce n’est là que le moindre des effets qui caractérisent sa production, en tant qu’il est le symptôme apparent d’un milieu et qu’il reflète l’esprit des puissants de cette époque. Le caractère fait partie d’un projet d’édition initié en 1694[43]. Colbert réunit des académiciens avec l’ambition d’éditer une encyclopédie. Le premier volume doit être consacré à l’imprimerie. C’est une commission, dirigée par l’abbé Bignon, qui aura en responsabilité le développement du caractère.
Adoptons une méthode écosophique et commençons par en analyser l’écologie symbolique. Le Romain du Roi est un caractère typographique qui rompt formellement avec ses prédécesseurs par sa méthode de dessin purement géométrique et rationnelle[44]. Les formes en sont extrapolées de mesures opérées sur des caractères de titrage existants ou des modèles calligraphiques signés d’un maître-écrivain, Nicolas Jarry. C’est donc une transformation dans l’imaginaire symbolique de ce qu’est l’écrit typographique, dont les formes sont normalement sculptées autour des vides de la lettre et non dessinée par le contour[45] : le signe d’écriture est gravé en relief sur un poinçon, puis frappé en creux dans une matrice qui accueille l’alliage en fusion. À l’époque, chaque taille de caractère faisait l’objet d’une gravure différente puisque les rapports de proportion des lettres sont adaptés lorsque l’on change d’échelle (un effet d’optique). Prendre des caractères de titrages pour du texte courant est déjà une forme de méconnaissance de ces phénomènes optiques.
À partir d’ici nous pouvons déplacer notre analyse vers l’écologie sociale de cet objet. À ce titre, la classe sociale dont sont issus les académiciens est déterminante. La commission Bignon est constituée de membres d’une catégorie sociale relativement nouvelle, la noblesse de robe, autrement qualifiée de « robins », de « milice non-armée[46] » ou de « lobby-Colbert[47] » retrospectivement. Il est donc ici question de lutte de classes. Cette démarche peut être considérée comme la tentative constante d’éloigner la noblesse des positions de pouvoir tout en affaiblissant le pouvoir corporatiste artisan de la petite bourgeoisie. Louis XIV organise autour de lui une cour de conseillers sélectionnés chez les robins. Cette classe profite d’une stratégie politique absolutiste qui tend à éloigner la noblesse des positions de pouvoir. Le monarque absolu craint de voir se reproduire les événements de la Fronde (1648-1653) qui visaient l’autorité de sa fonction et qui ont vu des nobles se soulever contre lui. Le roi ouvre sa porte à la noblesse de robe, qui tente de s’arracher à sa condition petite-bourgeoise ou de petite noblesse par des talents d’universitaires (juridiques et scientifiques) : les figures emblématiques sont Colbert ou encore Séguier. Tout en admirant les prouesses du travail artisanal[48], ils ont en horreur les habitus mutiques artisans. Habitus perçus comme du mimétisme[49] sans capacité rhétorique à décrire ce qu’il fait. Les savoir-faire sont pour eux des gestes répétés et non-motivés par la connaissance vraie[50]. En bref, la bourgeoisie amène ses équipements collectifs de la pensée au sommet du pouvoir[51]. La démarche sous-tendue par cette recherche de mécanisation met en œuvre des savoirs mathématiques. Dans cette forme très déterministe, l’ingénieur réduit le savoir-faire et l’amène à des points d’abstraction qui ne rendent pas grâce aux métiers. Les modalités d’action qui accompagnent cette attitude bourgeoise sont de trois ordres : imposer la culture rationnelle bourgeoise commerçante, déposséder les artisans de leurs rôles politiques, spolier les savoirs artisans[52]. Il se traduit exemplairement dans les rapports de production des manufactures (Aubusson, Gobelins, etc.), entreprises de « droit public[53] » qui concentrent et organisent les fonctionnements anciennement libres entre artisans. On y sépare ce qui est libéral de ce qui est «manufacturable[54] ». On enlève toute souveraineté aux artisans, on les prolétarise (au sens de Marx) enfin ou simultanément on instaure le rapport salarial. L’artisan perd tout pouvoir sur les rapports de production. L’art devient alors la « dimension perdue du travail[55] » , l’espace d’un travail libre est limité à un petit nombre, et devient la justification pratique qu’il existe quelque chose comme une liberté d’action[56], cependant réservée aux gens doués et bien nés.
Cette classe de savants est particulièrement intéressée par les automates. Elle tend à considérer la machine comme l’exemple opératoire spectaculaire d’une démonstration efficiente des théories scientifiques[57] — la science académique devient la clef qui force le secret du coffre dans lequel les artisans avaient placé leurs savoir-faire « ésotériques ». Dans ce cadre, la théorie est destinée « à ceux qui commandent[58] ». Le calcul et la géométrie commandent aux forces de la Nature et par là donnent un contrôle total sur les choses. Par exemple : la « machine à marcher sur l’eau » en 1675[59], dont la référence biblique ne laisse aucun doute sur la modestie de l’entreprise. Dans cet esprit, la machine n’est qu’un des moyens de spoliation scientifique qui verra la capture institutionnelle des savoirs artisans dans les domaines de l’architecture (Antoine Desgodets), de la conception de navires (Colbert), dans l’imprimerie, etc. Une fois extraits les savoirs de leur milieu par les scientifiques, ils les automatisent dans des procédures et des machines. Mais dans l’opération ce n’est pas tant l’activité physique du travail et du savoir-faire qui disparaît, qu’une certaine autorité légale (coutumière) à dire ce qu’est le bon et le mauvais résultat du travail. Dans l’architecture les maçons étaient les seuls à pouvoir établir un constat de malfaçon. Après cette académisation, ils perdent la compétence juridique d’en juger. En des termes marxistes, les artisans sont ramenés à une simple force de travail. Dans ce nouveau cadre politique les charpentiers des chantiers navals devront obéir aux plans des commanditaires, les maçons perdent toute autorité, les typographes se plient aux ordres des scientifiques perçus comme « absurdes ». Les gens de métier voient cette rationalisation comme une menace et une erreur méthodologique prétentieuse : « Pour la seule taille des calibres […] on divise la ligne en deux cents quatre parties. Ces règles renvoient à l’idée des infiniment petits, où l’imagination seule peut atteindre ; ce qui fait que pour les rendre sensibles par des exemples, on a été obligé de dessiner les lettres trois ou quatre cent fois plus grandes que le même objet ne doit être représenté sur le poinçon pour les caractères le plus en usage. […] Le génie ne connaît ni règle ni compas […]. Cela prouve que des personnes qui ne connaissent pas un art, quelque habiles qu’elles soient d’ailleurs, comme l’étaient Messieurs Jaugeon, des Billettes et le Père Sébastien, ne sont pas en état d’en donner des principes. Ces messieurs auraient pu s’en tenir à une règle qu’ils établissent, qui est de consulter principalement les yeux, juges souverains mais les ayant trouvés un peu incertains dans leurs décisions, ils ont proposé d’autres règles[60] ». L’artisan cultive avec sa pratique une prudence et une tendance à « tempérer l’obsession[61] ». Cette recherche géométrique de la perfection abstraite est perçue comme une « lubie de classe ». Dans tous les domaines, la vision scientiste réduit les savoir-faire à des points d’abstraction qui visent l’efficacité. Mais, à chaque fois, la théorie opératoire échoue en simplifiant les savoir-faire complexes de l’artisan. Les commissions procèdent toujours de la même manière, par mesures chiffrées de la production exemplaire. Dans la typographie, on mesure des caractères de titrage et on applique ces mesures au caractère de texte, en refusant notamment d’écouter les graveurs de poinçons sur les corrections optiques à apporter à la typographie[62]. Dans l’architecture navale, le roi organise des concours du meilleur navire en se basant sur des modèles réduits naviguant dans les bassins de Versailles, et on calcule les trajectoires en géométrisant les bateaux [63].
Le « goût » bourgeois est à l’ordre, à l’énonciation de lois, de formules et de mesures quantitatives : « Aussi bien les principes cartésiens auront-ils sur l’évolution de la pensée une influence parallèle à celle du droit romain sur les institutions ; on posera des principes, des théories et des définitions auxquels il s’agira par la suite de ramener le donné de l’expérience, les faits et les hommes[64] » — ce goût est moral, juridique, esthétique et de l’ordre du savoir. Dans cette philosophie, le droit est affaire de catalogage éthique des relations ; pour l’imposer, la noblesse de robe s’appuie sur le droit romain et la notion de propriété. À l’origine, le droit de propriété est une part mineure du droit romain qui servait à légiférer entre étrangers[65]. Posséder et compter, énumérer et trouver des équivalences quantifiables : « Le bourgeois par ses origines commerçantes, manifestait une confiance qui deviendra du reste exclusive avec le temps, pour des valeurs de quantité, pour tout ce qui se chiffre, se dresse en colonnes, s’énonce en formules. Assimiler la vérité à l’évidence, décomposer chaque problème d’ensemble en une multitude de problèmes de détail, imposer à la pensée un ordre rigoureusement logique afin d’éviter les erreurs – c’était là, par excellence, le langage qu’il pouvait entendre[66] ». Dans la volonté de tout rationaliser se cache la recherche d’un dévoilement des mécaniques de la Nature. La culture bourgeoise trouve ici un accord avec la logique aristocratique et religieuse, c’est bien d’un Dieu que l’on parle et du pouvoir qu’il confère au roi. Par conséquent, les découvertes théoriques sont autant de nouveaux leviers rationnels que le roi va pouvoir manœuvrer pour exercer son contrôle sur la Nature, sur le Monde et sur ses sujets.
Ainsi, par la typographie, la géométrisation agit comme une prise de contrôle sur la raison et le discours. Pour cette époque, l’écriture est le supplément de la parole [67], elle-même perçue comme le reflet de l’âme. Dans un mouvement similaire, la grammaire et l’orthographe s’imposent à la même époque « […] à l’âge classique, connaître et parler s’enchevêtrent dans la même trame [68] ». Organiser la forme des discours, c’est en un sens les contrôler et avec elles le discours des sujets parlants. Cette mécanisation cartésienne est une représentation du vivant comme machine qui s’applique également au plan de la Nature. Nous pouvons ici appliquer une analyse écologique environnementale. Les jardins de Le Nôtre traduisent cette volonté de pouvoir, en organisant la Nature dans une forme pure et géométrique. Pour accomplir ce prodige, il faut irriguer le jardin avec la machine de Marly, énorme pompe alimentant également les fontaines de Versailles. Un système de fermes d’élevage alimente le « gibier sauvage[69] » et des chemins forestiers percent la forêt de part en part en de longues lignes droites qui facilitent la pratique de la chasse à courre. Cette machinerie, articulée symboliquement et techniquement – perspective des jardins, nourrissage de la faune et pompes mécaniques –, pourrait apparaître comme une métaphore du Romain du Roi. C’est un autre discours sur la Nature qui se tient dans ce projet, celui des artisans qui sont comme primitifs, paresseux et sans initiative[70]. Replions nos observations symboliques, sociales et environnementales les unes sur les autres pour maintenant déduire comme une praxis (idées manifestées dans les pratiques). De fait, alors, les jardins ne sont pas une métaphore, mais un aspect du rapport de production nouveau qui considère la Nature comme un magasin manipulable par la rationalité, les ouvriers à « l’état sauvage » comme naturalisés et toutes les formes comme le produit d’une nature matérielle et machinique. D’un côté la Nature, le savoir-faire empirique du graveur de poinçon ou du maître d’écriture, de l’autre la machinerie d’asservissement, les calculs des académiciens.
Depuis Gutenberg la typographie copie les manuscrits[71], en ce sens la typographie est l’art du contrefacteur. Brutalement, dans les travaux de la commission Bignon, le geste artisanal est subordonné au chiffre de la rationalité[72]. Les gestes derrière la typographie, et les corps derrière l’écriture, ont leurs raisons naturelles : l’axialité des membres supérieurs humains rend le geste droit difficile, la plume provoque des pleins et déliés, l’encre s’épuise rapidement dans le réservoir de la plume et force à découper le ductus du dessin des lettres en étapes, elles-mêmes dépendantes des limites des positions du corps, etc. Pourquoi garder dans une optique de rationalisation autant de traits saillants de l’écriture ? Pourquoi ne pas aboutir aux formes géométriques les plus sèches et pures ? De manière explicite, maintenant, il s’agit d’entretenir un lien d’appartenance avec la « naturalité du geste artisanal », autrement dit d’asservir les corps artisans au pouvoir du Roi.
L’écriture est d’abord fétiche de réduction magique, puis séparation rationnelle des obstacles en d’« infinis problèmes de détails[73] » comptabilisables, hiérarchisables et classables. Les systèmes graphico-politiques sont solidaires d’une forme économique de gestion de l’environnement, du système agro-pastoral mésopotamien au colbertisme en passant par la libéralisation commerçante protestante. Il y a donc un lien écologique patent entre la graphie et la gestion de l’environnement. L’humaniste, en particulier, se pense en contrôle de la graphie, dans une « mentalité magico-religieuse[74] » où il commande aux choses par les signes et les mots. Pour nuancer, cependant, la graphie n’a pas dans son essence le contrôle et l’ordre, mais de par ses trajectoires[75], « il est arrivé[76] » qu’elle adopte cette fonction[77] dans l’organisation techno-scientifique du monde anthropocentré dominé par l’Occident. Elle s’est co-développée avec les activités humaines et s’est construite en ce sens. Il est donc totalement exclu de penser qu’elle est surdéterminante sur les conduites humaines. De fait, la graphie a une agentivité[78], elle exerce comme une influence sur nous, faisant de nos organisations mutuelles des actions humains-graphiques — nous formons des individus hybrides avec nos outils graphiques. C’est peut-être cela une définition de quelque chose comme la graphie[79] — le mélange d’une agentivité du signe, du support, des environnements, des réseaux de diffusion, des imaginaires et des lecteurs. Nous ne sommes pas en situation de contrôle mais de co-évolution. Pour le dire vite — à nouveau —, la graphie cause les problèmes que nous souhaiterions résoudre avec elle. C’est ici qu’il faut sortir du fatalisme humaniste et de son graphocentrisme qui semble dire : « Quand presque toute l’Europe [du Xe siècle] était illettrée, morcelée et sous-alimentée, il n’échappait à personne qu’écrire c’est prescrire ; instruire, conduire ; et transmettre, soumettre […]. Il faut à l’intelligence un mur […] la culture (ou l’histoire) est d’abord affaire de clôture […] Seul un enclos permet d’emmagasiner : bétail, outils, céréales, archives, femmes, braises. [Sans cela] Mouvement veut dire danger : attaque ou fuite. […] En d’autres termes, l’économie domaniale d’autosubsistance fait du lettré , du clerc ou du légiste [graphie] des luxes inutiles[80] ».
Avec ce constat historique en tête, comment le graphisme pourrait-il participer à résoudre les problèmes écologiques qui sont les nôtres ? Les supports numériques sont aujourd’hui les héritiers de cette tradition de recherche de contrôle et de maîtrise du différent et du divers[81]. À cet endroit, peu d’options se proposent à nous. Le signe en lui-même ne nous permet pas d’échapper aux aspirations profondes d’ordre et de docilité qui nous animent. Comme l’expliquait Derrida à propos de l’écriture, la graphie est pharmacologique, en même temps poison et remède[82]. Son design, au sens moderniste, ne révélera au mieux que sa nature structurante, ordonnatrice et thésaurisante. Pour subvertir ces dispositifs de graphie, notre champ d’intervention ne peut plus se borner uniquement à un travail auctorial de surface et de définition essentialisant de la discipline. C’est le rapport de production lui-même qui doit nous intéresser. L’ensemble du rapport d’engendrement[83] des signes doit nous préoccuper en priorité.
Nous l’avons vu le Romain du Roi ne commence à nous apparaître écologiquement que par un exercice de description de ses trois écologies[84]. Pour suivre Guattari et son écosophie, il nous faut trouver dans le graphisme contemporain des exemples de chacune de ces trois écologies : symbolique, sociale, environnementale. Bien que cette méthode récuse une définition du graphiste comme un spécialiste en forme, il n’en demeure pas moins le collaborateur d’êtres[85] sur le plan symbolique. Il est vrai que là où le graphisme perturbe le plus souvent les approches rétiniennes, c’est quand il est désorganisant, lorsqu’il change les cadres de décision et nuit à la lisibilité. C’est là son écologie symbolique[86]. Par ses approches auctoriales, le graphisme propose des compositions de signes qui mettent le « lecteur au travail » de façon hétérogénétique par des « processus continu[s] de re-singularisation [dans lesquels] […] les individus doivent devenir à la fois solidaires et de plus en plus différents[87] ». Cet héritage il le doit à son tournant (1980-1990) déconstructiviste[88]. Dans le graphisme contemporain, salué par l’institution (CNAP, Biennale de Chaumont, ENSAD), les affiches « disent mal » ce qu’elles prétendent nous communiquer. Les choix d’images, d’écritures, de caractères typographiques créent comme une tension. Le spectateur doit alors exercer son attention, suspendue par cette étrange traduction visuelle, autant que sa capacité d’interprétation pour refonder cette brève suspension symbolique. Les signes, en effet, ne font pas qu’émettre des idées, ils ont un rôle de lien. L’étymologie de « symbolique », sumbolon (objet divisé en deux), rappelle cette fonction. Dans l’Antiquité le sumbolon était une pièce d’argile divisée en deux qui scellait un contrat moral : une fois réunis, les morceaux attestaient d’une proximité entre les détenteurs. Par métaphore, ici c’est le lecteur qui doit reconstituer ces pièces éparses, et faire l’effort de produire un sens qu’on ne peut lui imposer. Cette situation de communication non-autoritaire renvoie le lecteur à cette construction active et commune du sens. Il ne peut y avoir de sens a priori : celui-ci se produit toujours dans la négociation collective et l’échange entre interprétations divergentes. Si bien qu’a contrario d’une définition commune de l’approche auctoriale, ce n’est pas tant l’auteur qui s’individue dans une approche graphique originale que le lecteur qui exerce par là un droit à l’interprétation[89] : il s’agit donc de cultiver ce que Bernard Stiegler appelle L’Attente de l’inattendu[90]. Mais donner ce privilège auctorial à quelques-uns ne fait pas de cette activité une pratique conforme à l’écosophie guattarienne. Ce serait encore être trop anthropocentré : « Je pars de l’idée que la subjectivité est toujours le résultat d’agencements collectifs, qui impliquent non seulement une multiplicité d’individus, mais aussi une multiplicité de facteurs technologiques, machiniques, économiques, une multiplicité de facteurs de sensations disons pré-personnels. […] Je récuse par avance l’espèce de réductionnisme qui consiste à penser la communication et la culture comme résultant d’une interaction entre les individus. […] Il y a constitution de la subjectivité à une échelle d’emblée transindividuelle[91] ». La question est de l’ordre des rapports d’engendrement, des interactions entre différents types d’êtres (techniques, conceptuels, animaux, minéraux, politiques, etc.). Là où le graphisme d’auteur échoue c’est en se focalisant uniquement sur l’expression personnelle d’un auteur humain.
En manifestant sa présence, le graphisme chamboule les évidences des organisations scripturaires occidentales[92], il défait les évidences du travail en commun et de la répartition habituelle des valeurs : c’est une forme d’écologie sociale et économique. Lorsqu’un client investit dans une commande de graphisme, il le fait sur le paradigme des théories de la communication. Il attend des signes qu’ils attirent le regard, disent avec efficacité le message et donnent une force de conviction à son image. De nombreuses « méthodes » mercatiques permettent aujourd’hui d’évaluer l’impact d’une communication — essentiellement, du reste, à partir de leur capacité à capter l’attention ou à engendrer des modifications de comportement d’achat —, et toujours selon des indicateurs chiffrés. Le designer graphique vient souvent interroger ce cadre présupposé des performances communicationnelles. Ces propositions ne sont pas toujours reçues avec bienveillance, et c’est la moins ambitieuse qui se trouve souvent choisie pour sa modération. Pour comprendre comment l’écologie sociale s’exerce ici, il faut absolument s’empêcher de naturaliser cette subordination à l’autorité du commanditaire. Cette relation évidente, renvoyée à un dispositif de promotion d’un contenu donné, dans le cadre d’un contrat moral de subordination, ne permet pas au design graphique d’exercer sa pleine responsabilité et sa prudence médiologique à l’endroit des techniques de graphie. C’est le cadre du travail lui-même qui doit se trouver ouvert et changé. Le graphisme social a tendance, par exemple, à intégrer le lecteur à la production des signes, comme ce peut être le cas dans les projets participatifs. Le praticien se fait alors le facilitateur de la construction du message et lui donne une autorité, et emprunte en un sens à son illustre ancêtre : l’écrivain public. Le graphiste Jean-Marc Bretegnier (Fabrication-Maison) parle alors « d’imagier public en résidence ».
C’est l’autre point essentiel de la pensée écosophique : le graphiste doit renouer avec une approche locale et située — territorialisée et mineure dans le vocabulaire deleuzo-guattarien. Le graphiste travaille alors à la saisie (« grasping ») existentielle[93] de petites choses — avec les habitants d’un territoire par exemple. Dans ces petites choses s’effondre une part de l’ambition universaliste du graphiste moderniste qui, en résolvant un problème à un endroit, ambitionnait d’être celui qui en résout d’autres avec la même méthode, partout, tout le temps, d’être celui qui crée des modèles pratiques, des praxis exemplaires saluées et reconnues. Mais plus que de bâtir des stratégies de reconnaissance, il faut s’immerger dans le faire avec les acteurs du terrain et, par là, affirmer le statut d’une discipline qui n’est pas a priori[94] de son objet, mais l’écoute et s’y adapte. En même temps que l’on fait, il faut chercher à tirer un savoir de cette rencontre par laquelle naîtra un sens partagé. Le graphiste n’est plus un auteur identifié dans le monde autonome du graphisme, il est plutôt un pharmacien du signe (ès grammatologie, médiologie et déconstruction) dont la petite échoppe donne sur la place du village ou du quartier, agora politique et nouveau parlement local. Étrange pharmacie à la vitrine de laquelle on peut voir des livres, des signes et des affiches qui nous racontent des histoires locales et exotiques, des géographies mythologiques attrayantes. La graphie crée du lien entre les choses et fait de nouvelles traductions en les soumettant à notre attention. Guattari dirait qu’elle produit des processus de singularisation ; or, le singulier est mineur, il n’est pas du côté de l’Universel. Par ce processus se crée du désir, c’est-à-dire « le fait que là où le monde était fermé, surgit un processus secrétant d’autres systèmes de référence, qui autorisent — mais rien n’est jamais garanti — l’ouverture de nouveaux degrés de liberté[95] ». La boutique est une métaphore, car ce principe pourrait tout aussi bien subvertir le monde en silo des entreprises et mettre le commanditaire sur la place publique avec les habitants, les élus et les associations pour tous les soumettre à la question : « pourquoi faudrait-il adopter vos produits ? » ou plutôt se dire ensemble « maintenant produisons nos objets » — un type d’activité que la résidence Les Chaudronneries, à Montreuil (93), conduit avec une étonnante fluidité. Si la graphie déménage de son « Mont Universalis » et atterrit (cf. Latour), elle ménage déjà ainsi deux écologies : social/économique et symbolique/psychologique.
Pour être écosophique, Guattari préconisait cependant de prendre également en compte l’écologie environnementale et naturelle. Nous l’avons vu, la graphie est anthropocentrée par structure. Pour nous sortir de cette lubie, ici, nos alliés et mentors sont les diplomates[96] de la Nature pour lesquels nous serons les traducteurs : les scientifiques, paysans, permaculteurs, naturalistes, qui donnent la parole aux êtres de nature selon leurs façons de voir le monde (régimes d’énonciation). Tout l’objet est alors de donner la parole aux nombreux êtres qui n’ont pas de voix dans la culture humaniste : minéraux, animaux, végétaux, mycètes, sols, etc. Exercice de traduction pour lequel le graphiste excelle, très habitué à côtoyer les non-humains que sont les techniques, les concepts, les idées et objets de fiction. Mais cette fois, comme il est trop pris dans son sémiocentrisme, c’est le parlement des choses[97] — dont les élus sont les diplomates — qui lui confie des dossiers, des commandes et des données. Pour cela, la graphie prend souvent la forme d’une enquête, collectionne les documents, les restitue de manière à donner à voir et à lire la complexité — c’est de cette façon qu’elle prend commande. Elle rend compte par là des devenirs minoritaires et locaux, fait des liens entre des êtres peu représentés. À ce titre, des travaux d’enquêtes comme ceux du duo Structure-Bâtons relèvent d’une telle compétence : plutôt que de venir imposer sa vision, et celle de son collectif, le graphiste se met à disposition des territoires. Son champ d’expertise n’est plus tant l’image que l’écoute d’un paysage. C’est par cette tâche politique complexe, d’une réorganisation des cadres de la profession et de ses liens locaux, que le graphiste peut espérer être en écologie au sens de l’écosophie guattarienne. En ce sens, peut-être, il s’agit de faire « un design écologique » et non moderniste (positiviste), du graphisme en remettant les organisations du travail (rapports d’engendrement) au cœur de ses préoccupations.
Remerciements
Lucile Bataille, Roberto Barbanti, Sébastien Biniek, Stéphane Darricau, Damien Laverdunt, Matthieu Marchal, Céline Vinel, pour toutes leurs relectures exigeantes.
[1] Michel FREITAG , L’abîme de la liberté, Montréal, Éditions Liber, 2011.
[2] Christophe BONNEUIL et Jean-Baptiste FRESSOZ, L’Evènement Anthropocène, la Terre, l’histoire et nous, Paris, Éditions Le Seuil, 2013.
[3] Edgar MORIN, Introduction à la pensée complexe, Paris, Éditions Points, 2007, p. 99.
[4] Félix GUATTARI , Qu’est-ce que l’écosophie ?, Paris, Éditions Lignes poche, 2013, p. 71-80.
[5] Jacques ELLUL, La technique ou l’Enjeu du siècle, Paris, Éditions Economica, 2008.
[6] Adrian FRUTIGER, L’Homme et ses signes, Reillane, Éditions Peyrousseaux, 2000 ; Roland BARTHES, « Rhétorique de l’image », Communications, n°4, 1964, p. 40.
[7] Kinross, 2012, p. 110.
[8] Vivien PHILIZOT, « Le signe typographique et le mythe de la neutralité », Textimage, revue d’étude du dialogue texte-image, « À la lettre », mars 2009 ; Ellen LUPTON, J. Abott MILLER, «The abc’s of the Bauhaus and design theory», New-York, NY, Princeton Architectural Press, 1993, p. 38.
[9] Giulio Carlo ARGAN, Walter Gropius et le Bauhaus, Marseille, Éditions Parenthèses, 2016, p. 71.
[10] Ibid., p. 36-37.
[11] Ibid., p. 37.
[12] Ibid., p. 75.
[13] Hans Rudolf BOSSHARD, Max Bill / Jan Tschichold, la querelle typographique des modernes, Paris, Éditions B42, 2014, p. 87.
[14] Fred SMEIJERS, Les Contrepoinçons, Paris, Éditions B42, 2014.
[15] Lia FORMIGARI , Mathilde ANQUETIT , « Opérations mentales et théories sémantiques : le rôle du kantisme », dans Histoire Épistémologie Langage, tome 14, fascicule 2, 1992. Théories linguistiques et opérations mentales, sous la direction de Sylvain Auroux, pp. 153-173, p. 159.
[16] LUPTON, E, MILLER, J.A, « The abc’s of the Bauhaus and design theory », op.cit., p. 23.
[17] Philippe DESCOLA , Par-delà nature et culture, Paris, Éditions Gallimard, 2005, pp. 148-160.
[18] Jacques DERRIDA, De la Grammatologie, Paris, Éditions de Minuit, 1967, pp. 42-47 ; Bruno LATOUR , « Petite philosophie de l’énonciation », Texto!, juin 2006, vol. XI, n°2. [en ligne]. http :/ /www.revue-texto.net/Inedits/Latour_Enonciation.html. (Consultée le 28 juillet 2018).
[19] Umberto ÉCO, Le Signe, Bruxelles, Éditions Labor, 1988, p. 18 ; Dominique BOURG, Une nouvelle Terre, Paris, Éditions Desclée De Brouwer, 2018. p. 25-30.
[20] Bruno LATOUR, Nous n’avons jamais été modernes, Paris, Éditions La découverte, 1991, pp. 36-39 ; DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, op.cit., p. 440.
[21] Date de naissance officielle la plus citée : Mac ORLAN, Graphismes, Arts et métiers graphiques, n°11, mai 1929, p. 325.
[22] Régis DEBRAY, Le Scribe, Paris, Éditions Livre de poche, 1980, p. 21.
[23] Jack GOODY, La Raison graphique, La domestication de la pensée sauvage, Paris, Éditions de minuit, 1979.
[24] Robert LAFONT, Henri BOYER, Anthropologie de l’écriture, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1992 ; Philip B. MEGGS , Alston W. PURVIS, Meggs’ History of Graphic Design, Éditions John Wiley and Sons, 2012.
[25] Chantal JÈGUES-WOLKIEWIEZ, Les calendriers paléolithiques de Sergeac et de Lartet décryptés, Autoédité, 2014.
[26] Roberto BARBANTI, De l’ultramédialité, Nîmes, Éditions Théétète, 2004, p. 17.
[27] Ibid., pour être précis Roberto Barbanti ajouterait ici : « […] et la main humaine avec son pouce préhenseur.»
[28] Marshall McLUHAN, La galaxie Gutenberg, Paris, Éditions Gallimard, 1977, pp. 232-237
[29] DERRIDA Jacques, De la Grammatologie, op. cit., p. 424
[30] Ellen LUPTON, J. Abott MILLER, Counting Sheep, Design Writing Research, New York, NY, Kiosk Book, 1996, pp. 24-32 ; Dominique CHARPIN, Lire et écrire à Babylone, Paris, Éditions PUF, 2008.
[31] Louis-Jean CALVET, Histoire de l’écriture, Paris, Éditions Pluriel, 1996, p. 121 ; McLUHAN Marshall, La galaxie Gutenberg, op.cit., p. 415.
[32] Ibid., p. 278.
[33] Anthony FROSHAUG, « Type as grid », The Designer, n° 167, Janvier 1967 ; McLUHAN Marshall, La galaxie Gutenberg, op.cit., pp. 324-332.
[34] ; (Weber, 1964, p. 81-104)
[35] Régis DEBRAY, Cours de médiologie générale, Paris, Éditions NRF, 1991, p. 229.
[36] LATOUR Bruno, Nous n’avons jamais été modernes, op.cit., p. 35.
[37] Ibid., p. 39.
[38] Lorraine DASTON, Peter GALISON, Objectivité, Paris, Éditions Les presses du réel, 2012 ; Bruno LATOUR, « Irréductions », Pasteur : guerre et paix des microbes suivi de Irréductions, Paris, Éditions La Découverte, 2011.
[39] DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, op.cit.
[40] René DESCARTES, Discours de la méthode, 6e partie, Bibliothèque de la Pléiade, Éditions Gallimard, 1966, p. 168.
[41] Félix GUATTARI, Les Trois écologies, Paris, Éditions Galilée, 1989. p. 12.
[42] C’est Lebrun, peintre de son état, qui dirige les décors de Versailles selon la logique Colbertiste de l’expert qui commande aux techniciens.
[43] James MOSLEY, « les caractères de l’imprimerie royale », Le Romain du Roi, la typographie au service de l’État, 1702-2002, Lyon, Musée de l’imprimerie de Lyon, 2002, p. 40.
[44] Ellen LUPTON, J. Abott MILLER, « A natural history of typography », Looking Closer I, 1994, p. 19 ; PHILIZOT Vivien, « Le signe typographique et le mythe de la neutralité », Textimage, revue d’étude du dialogue texte-image, op.cit., p. 2.
[45] SMEIJERS Fred, Les Contrepoinçons, op.cit.
[46] Albert CREMER, « La genèse de la notion de noblesse de robe », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 46 n°1, Janvier-mars 1999. Les noblesses à l’époque moderne, pp. 22-38.
[47] Félix Guattari citant Daniel Dessert et Jean-Louis Journet, Lignes de fuite, Paris, Éditions L’aube, 2011, p. 45.
[48] Jean-Pierre SÉRIS , Machine et communication, Paris, Éditions Vrin, 1987, pp. 12-13.
[49] Jean-Pierre SÉRIS, Qu’est-ce que la division du travail ? Ferguson, Paris, Éditions Vrin, 2002, p. 109.
[50] SÉRIS Jean-Pierre, Machine et communication, op.cit., p. 12, p. 75.
[51] GUATTARI Félix, Lignes de fuite, op.cit., p. 48.
[52] SÉRIS Jean-Pierre, Qu’est-ce que la division du travail ? Ferguson, op.cit., p. 42.
[53] Avec toutes les précautions nécessaires que le déplacement de ce terme entraîne comme anachronismes.
[54] Nathalie HEINICH, Du peintre à l’artiste. Artisans et académiciens à l’âge classique, Paris, Éditions de Minuit, 1993, p. 64.
[55] Michel FREITAG, L’oubli de la société. Pour une critique de la postmodernité, Rennes, Presses Université de Rennes, 2002, p. 109.
[56] Ibid., p. 127.
[57] SÉRIS Jean-Pierre, Machine et communication, op.cit., pp. 11-33.
[58] SÉRIS Jean-Pierre, Machine et communication, op.cit., p. 100.
[59] Gottfried Wilhelm Leibniz, Drôle de Pensée, touchant une nouvelle sorte de représentation, 1675. Il rapporte un essai de cette machine en 1675, sur la Seine, qui « m’émerveillent de cette “nouvelle fome de représentation” ».
[60] (Fournier, p. XVII)
[61] (Sennett, 2008, p. 387)
[62] Un académicien rapporte qu’il a du briser de nombreux essais lors de la conception, les graveurs inclinent les caractères pour corriger optiquement les lettres alors que les académiciens veulent que le dessin géomérique soit strictement respecté. Voir James MOSLEY, op. cit., 2002.
[63] SÉRIS Jean-Pierre, Qu’est-ce que la division du travail ? Ferguson, op.cit., pp. 75-76.
[64] (Pernoud, 1967, p. 37)
[65] FREITAG Michel, L’abîme de la liberté, op.cit., p. 167.
[66] Régine PERNOUD, L’histoire de la bourgeoisie en France II, les temps modernes, Paris, Éditions du Seuil, 1962, p. 37.
[67] DERRIDA Jacques, De la Grammatologie, op.cit., p. 17.
[68] Michel FOUCAULT, L’Archéologie du savoir, Paris, Éditions Gallimard, 1969, p. 103.
[69] Tellement abondant qu’il en devient nuisible, Grégory QUÉNET, Versailles, une histoire naturelle, Paris, Éditions La découverte, 2016, p. 162.
[70] SÉRIS Jean-Pierre, Machine et communication, op.cit., p. 75.
[71] La production du livre, manuscrite et incunable, est dans une logique générale de “copie” selon Elisabeth EISENSTEIN, La révolution de l’imprimé, Paris, Éditions Hachette, 2009, p. 32-33.
[72] SÉRIS Jean-Pierre, Machine et communication, op.cit.
[73] PERNOUD Régine, L’histoire de la bourgeoisie en France II, les temps modernes, op.cit.
[74] DEBRAY Régis, Cours de médiologie générale, op.cit., p. 77.
[75] Notion essentiellement fondée sur la mise en critque de “tendance” chez Leroi-Gourhan, qui prétend prolonger la notion de “lignée technique” chez Bertrand Gille. Il propose une approche discontinue de l’histoire des techniques. Il n’y a pas de contniuité entre la hache en pierre taillée et la tronçonneuse, chaque technique est un phénomène culturel compris dans son moment social et historique : “J’insiste sur la notion de trajectoire que j’oppose à celle de tendance : une tendance technique est une histoire sans fin ni commencement, alors une trajectoire s’ouvre à l’occasion d’une bifurcation et se ferme lorsque le sens de l’objet s’est épuisé” ; Alain GRAS, Gérard DUBEY, Le Choix du feu, Paris, Publications de la Sorbonne, 2009, p. 298 ; Alain GRAS, La fragilité de la puissance : Se libérer de l’emprise technologique, Paris, Éditions Fayard, 2003.
[76] Personne n’en n’a formé le projet intellectuellement pour qu’il se réalise dans des organisations, le hasard des rencontres à fait que c’est arrivé ainsi.
[77] (Morin, 1991, p.228)
[78] (Latour, 2001, p.203)
[79] Notez au passage que comme dans Enquête sur les modes d’existence (Latour, 2012), “le” graphiste écosophique devient “la” graphie — inspirée par l’éco-féminisme d’Isabelle Stengers, Latour écrit son récit d’enquête au féminin, pour le dissocier du sujet humaniste essentiellement masculin. Le “sujet” écosophique est en un sens aussi différent du sujet humaniste pour Guattari. Ici il est féminin, car il souligne des maternités, des collectifs d’engendrement, plus que des paternités auctoriales individuelles. Il est donc pluriel, il a en lui beaucoup d’autres êtres car il est milieux, éléments et agents d’individuation en même temps — au sens cette fois de Gilbert Simondon (Gilbert SIMONDON, L’individuation à la lumière des notions de formes et d’information, Paris, Éditions Millon, 2013, p. 213).
[80] DEBRAY Régis, Le Scribe, op. cit., p. 18-22.
[81] Jean-François LYOTARD, La condition postmoderne, Paris, Éditions de Minuit, 1979 ; McLuhan, 1964)
[82] Jacques DERRIDA, « La pharmacie de Platon », La dissémination, Paris, Éditions du Seuil, 1972, p. 121.
[83] (Latour, 2019)
[84] Félix GUATTARI, Les Trois écologies, Paris, Éditions Galilée, 1989, p. 12.
[85] Chez Bruno Latour une chose, une idée, un animal, un minéral, etc. est un être à partir du moment où il influence son environnement. Paradoxalement, tous les êtres influencent l’environnement de tous les êtres. Un être est un individu unique, qui n’existe que parce que d’autres individus dépendent de lui. (LATOUR Bruno, « Irréductions » , Pasteur : guerre et paix des microbes suivi de Irréductions, op. cit.)
[86] GUATTARI Félix, Les Trois écologies, op. cit., p. 50 ; Félix GUATTARI, Chaosmose, Paris, Éditions Galilée, 1992, p. 120 ; Yann AUCOMPTE, « Le graphisme d’auteur du duo de graphistes M/M (Paris): quand une pratique mineure occupe le territoire de l’Art majeur », Marge, 2019.
[87] GUATTARI Félix, Les Trois écologies, op. cit., p. 72.
[88] Qui a toujours un peu à voir avec la question du vernaculaire et de l’affirmation des esthétiques non expertes comme un droit à l’expression démocratique (Yann AUCOMPTE, Stéphane DARRICAU, « Quelques effets sur la pratique de la traduction d’un concept : le déconstructivisme graphique depuis les années 1980 », Appareil, 2020 ; AUCOMPTE Yann, « Le graphisme d’auteur du duo de graphistes M/M (Paris): quand une pratique mineure occupe le territoire de l’Art majeur », op. cit. ; Yann AUCOMPTE, « La notoriété du Déconstructionnisme graphique : valoriser le design graphique par la Theory », Figures de l’art, n°36, 2019.
[89] Thierry Chancogne parle “d’autorisation” dans “Recto Versus”, Recto Verso Huit pièces Graphiques, Paris, Arts décoratifs, 2014, p. 06.
[90] STIEGLER Bernard, L’attente de l’inattendu, Genève, Éditions HEAD, 2005.
[91] GUATTARI Félix, Qu’est-ce que l’écosophie ?, op. cit.
[92] (Debray, 1993)
[93] GUATTARI Félix, Qu’est-ce que l’écosophie ?, op. cit., p. 307.
[94] « […] graphic design only exists when other subjects exist first. It isn’t an a priori discipline, but a ghost; both a grey area and a meeting point… » Stuart BAILEY, « Dear X », Dot dot dot, n°8, 2004.
[95] GUATTARI Félix, Qu’est-ce que l’écosophie ?, op. cit., p. 216.
[96] Baptiste MORIZOT, Les diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant, Paris, Éditions Wildproject, 2016.
[97] Bruno LATOUR, « Esquisse du Parlement des choses », Écologie politique, n°10, 1994, p. 97-107.