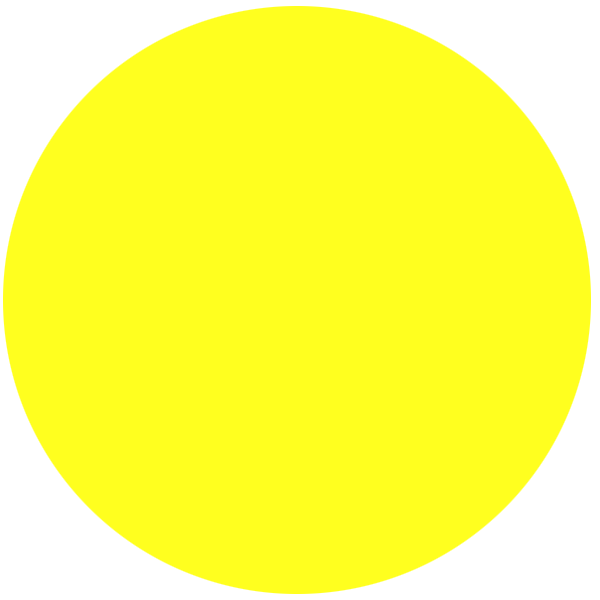

—
Résumé
Dans le contexte du « capitalisme de surveillance » (Zuboff) constitué par la récolte des données de navigation, par l’observation de toutes nos connexions et requêtes sur le web, par la prescription de nouveaux actes (« liker », cliquer, commenter, souscrire, etc.), les créations de Paolo Cirio, artiste italien vivant à New York, hackeret activiste, éclairent les paradoxes aussi bien que les risques et dérives du contrôle et de la manipulation sociale de l’information et de la communication à des fins économiques. Pour ce faire, elles s’attachent à parasiter les outils, les interfaces et applications de la surveillance numérique : notamment les opérations de captation, de collecte et de traitement de nos données personnelles sensibles. L’artiste explore une multiplicité de supports – photographies, installations, vidéos, interfaces et algorithmes numériques – dans une démarche technocritique des modèles sociaux, économiques, politiques et légaux de l’industrie du web. Se réappropriant les données en libre accès sur Internet, il questionne notamment l’exploitation des informations et des images collectées en regard du droit privé et du droit d’auteur. Alors même que la transparence est érigée en nouveau principe éthique par nos sociétés contemporaines, ses œuvres proposent des contre-dispositifs panoptiques et invitent à une réflexion sur les notions d’anonymat, de vie privée et de démocratie. À travers l’analyse des oeuvres de Paolo Cirio, cet article tente de montrer comment l’art peut créer une pratique d' »autodéfense numérique ».
Texte écrit en 2021 pour les actes du colloque « Les écologies du numérique » organisé par l’Ésad Orléans (ÉCOLAB) en 2017 et 2018.
—
Mots clé
Ecologie, capitalisme, surveillance, machine de vision, censure, autodéfense numérique, Cirio
—
Biographie
Jean-Paul FOURMENTRAUX
Socio-anthropologue (PhD), Jean-Paul Fourmentraux est Professeur d’Histoire et de Philosophie des arts et médias à l’Université Aix-Marseille. Il dirige des recherches (HDR Sorbonne) à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), membre du Centre Norbert Elias (UMR-CNRS 8562) et initiateur du programme Art-Science-Société de l’Institut Méditerranéen d’Etudes Avancées (IMéRA, RFIEA). Il est également membre de l’association Internationale des Critiques d’art (AICA). Ses travaux interdisciplinaires portent sur les enjeux politiques et anthropologiques des arts et des technologies contemporaines.
Il est l’auteur des ouvrages Art et internet (CNRS, 2005, rééd. 2010), Artistes de laboratoire (Hermann, 2011), L’œuvre commune (Presses du réel, 2012), L’Œuvre virale. Net art et culture Hacker (La Lettre Volée, 2013) et a dirigé les ouvrages L’Ere Post-media (Hermann, 2012), Art et Science (CNRS, 2012), Identités numériques (CNRS, 2015), Digital Stories (Hermann, 2016), Images Interactives (La Lettre Volée, 2017).
Academia / Research Gate / Cairn
L’ère numérique aurait fait basculer le capitalisme industriel dans un nouveau régime. C’est l’hypothèse du « capitalisme de plateforme » proposé par le philosophe Nick Srnicek[1] ou du « capitalisme de surveillance » que formulait il y a peu la sociologue et économiste Shoshana Zuboff[2] et qui rejoignait ainsi une longue tradition critique de la surveillance médiatique. Depuis l’apparition d’Internet, de nombreux auteurs et activistes en ont fait leur terrain d’investigation. Pensons notamment aux défenseurs des libertés numériques, tels qu’en France l’autorité administrative indépendante CNIL ou l’association La Quadrature du Net[3], par exemple, mais aussi aux chercheurs universitaires nouvellement engagés dans le domaine des « surveillance studies[4] ». La surveillance est en effet devenue un véritable marché pour les multinationales du web qui désirent capter et mieux orienter ou prescrire nos comportements et nos vies numériques. Par la récolte des données de navigation, par l’observation de toutes nos connexions et requêtes sur le web, par la prescription de « nouveaux » actes – « liker », commenter, cliquer, souscrire, préférer, etc. –, les entreprises de la Silicon Valley ont fait de nos données numériques des produits monnayables sur le marché des prévisions comportementales[5].
Peut-on se satisfaire de ce que disent de nous les réseaux neuronaux : ce que l’on aime, ce que l’on est, ce que l’on souhaite(rait) être, faire, avoir, goûter, etc ? Comment détourner ces « machines à (nous) gouverner » qui nous aliènent autant qu’elles nous sont devenues désirables, auxquelles nous adhérons le plus souvent avec une confiance aveugle ?
Le web social, l’intelligence artificielle, les réseaux neuronaux sont en effet devenus le creuset d’une traçabilité sans précédent des comportements, de l’expression des goûts ou des dégouts, et par extension, de l’ensemble des communications et relations inter-humaines médiées[6]. Cette exploitation subreptice mais continue de l’ensemble des « données personnelles » extraites de nos échanges publics aussi bien que privés affecte considérablement la vie démocratique et le libre arbitre des individus. Tous les domaines de notre vie numérique sont désormais concernés : loisir, travail, économie, politique, sociabilité, sexualité, etc. Sur l’ensemble de ces terrains, le contrôle et la prescription à distance des comportements est susceptible d’altérer l’autonomie des individus : jusqu’à influencer et modifier leurs pratiques à des fins simultanément économiques et politiques. Car la finalité de cette surveillance n’est pas uniquement financière : elle vise autant à contrôler qu’à « fabriquer » de nouveaux comportements[7]. De grands pans de l’expérience humaine se trouvent ainsi modélisés et instrumentalisés par toute une série d’applications ubiquitaires qui ordonnancent le quotidien des individus et des collectivités. C’est là le plus grand paradoxe de cette nouvelle ère numérique : susciter le désir pour des applications qui confisquent le libre arbitre et aliènent les individus en leur offrant simultanément de nouveaux outils d’expression et de sociabilité.
Dans ce contexte, les créations de Paolo Cirio, artiste italien vivant à New York, hacker[8] et activiste, éclairent les paradoxes aussi bien que les risques et dérives du contrôle et de la manipulation sociale de l’information et de la communication. Pour ce faire, elles s’attachent à parasiter les outils, les interfaces et applications de la surveillance numérique : notamment les opérations de captation, de collecte et de traitement de nos données personnelles sensibles. L’artiste explore une multiplicité de supports – photographies, installations, vidéos, interfaces et algorithmes numériques – dans une démarche technocritique[9] des modèles sociaux, économiques, politiques et légaux de l’industrie du web. Se réappropriant les données en libre accès sur Internet, il questionne notamment l’exploitation des informations et des images collectées en regard du droit privé et du droit d’auteur. Alors même que la transparence est érigée en nouveau principe éthique par nos sociétés contemporaines, ses œuvres proposent des contre-dispositifs panoptiques et invitent à une réflexion sur les notions d’anonymat, de vie privée et de démocratie.
L’œuvre Face to Facebook (2011), réalisée en collaboration avec l’artiste programmeur Alessandro Ludovico, procède du vol d’un million de profils d’utilisateurs Facebook et de leur traitement par des algorithmes de reconnaissance faciale (bots, agents logiciels automatiques ou semi-automatiques). A partir du piratage de la base de données, les deux artistes vont procéder à l’implémentation d’une sélection de 250 000 profils au cœur d’un site de rencontre en ligne fictif, inventé de toute pièce, nommé Lovely-face.com. Publiés à leur insu sur ce site de rencontre, les profils privés se voient ainsi exposés et mis en relation suivant certaines caractéristiques d’expression du visage définies de façon inhabituelle – sympathique, arriviste, sournois[10]. Une intelligence artificielle se charge en effet de l’analyse des expressions faciales afin d’estimer le « taux de compatibilité » des utilisateurs et ainsi mieux provoquer leur rencontre potentielle. L’œuvre singe et parodie le pouvoir de Facebook et les dangers d’une véritable mainmise sur nos données : révélant l’insécurité de celles-ci et exposant littéralement les coulisses de leur exploitation technique via des logiciels de reconnaissance vocale, faciale et typographique. Devant l’omniprésence des médias sociaux, en réinjectant des « data privées » dans une farce drôle et néanmoins inquiétante et visible de tous, ce détournement de données se veut une mise en garde à grande échelle face aux risques du partage d’informations personnelles sensibles. Face to Facebook prend en effet le contrepied des réseaux sociaux pour mieux révéler les effets collatéraux de la confiscation des données : fuites, vols d’identités, cyber-attaques. Il va sans dire que l’entreprise artistique n’est qu’un pâle et ironique reflet des risques réels encourus par les internautes soumis aux logiques propriétaires et capitalistes des GAFA. De nombreuses affaires en ont témoigné, relayées par les médias d’actualité qui ont pointé les cas malheureusement récurrents de fuites et d’exploitations abusives des données personnelles et sensibles au détriment de toute protection de la liberté et de l’intimité des internautes.
En 2012, par exemple, effet collatéral d’un changement des paramètres de confidentialité de l’application FaceBook, sans doute trop discret et à l’insu des usagers, des conversations classées jusque-là par leur caractère privé se sont vues affichées sur les murs des utilisateurs, à leur plus grande stupéfaction. Suite aux plaintes récurrentes de ces utilisateurs, si l’enquête de la Commission nationale de l’information et des libertés (CNIL) souligna l’absence de stratégie volontaire ou de Bug du système, elle pointa néanmoins un manque d’information claire, côté FaceBook, associé à un relatif manque de précaution, côté usagers. Il n’en demeure pas moins que la confiance des utilisateurs en a été quelque peu émoussée. Car ces fuites, qui se sont malheureusement démultipliées, sont parfois pleinement délibérées, comme suite aux trop nombreuses demandes émanant d’une autorité : la police dans le cadre d’une poursuite, les fournisseurs d’accès pouvant communiquer une année de vie numérique dans le détail, sans oublier l’installation de mouchards sur les machines des utilisateurs, à distance et sous le contrôle d’un juge.
Ces cas révèlent l’impact des technologies numériques et le rôle des GAFA sur le terrain de la culture et des médias, mais également leur pouvoir décisif sur le terrain de la politique et de la démocratie. L’affaire Cambridge Analytica, révélant la compromission de Facebook dans l’élection de Donald Trump, en atteste funestement. L’artiste lui-même indiquait en 2015 que l’œuvre Face to Facebook avait depuis son lancement comptabilisé plus de mille couvertures médiatiques dans le monde entier, onze menaces de procès, cinq menaces de mort et quelques lettres d’avocats du réseau social. Mais la crainte d’une trop grande résonance médiatique avait aussi limité pour partie les velléités de réels procès.
Depuis 2012, l’œuvre Street Ghosts prend pour cible l’application Google Street View et ses 9 caméras intrusives – Nine Eyes – qui scannent visuellement et cartographies numériquement toute l’étendue du globe[11]. Paolo Cirio propose de détourner ces « portraits panoptiques » eux-mêmes souvent illégaux : même lorsqu’ils sont floutés par l’application afin de palier aux nombreuses plaintes émises par des particuliers à l’encontre de l’entreprise[12]. En témoignent certains instantanés saisis fortuitement par la Google Car et qui se sont par la suite avérés indiscrets et potentiellement compromettants : ouvriers de chantiers en pose, mari se rendant chez sa maîtresse, ou entrant dans un sexshop, par exemple.
Ces compagnies sont les pouvoirs totalitaires d’aujourd’hui, et leur pouvoir est hors de contrôle. C’est pourquoi il faut toujours les garder sous la surveillance du public. (…) Google n’a pas demandé l’autorisation pour s’approprier les images des villes et villages du monde, il n’a rien payé pour le faire. Il vend des publicités à côté de ces contenus et revend l’information collectée aux mêmes annonceurs, récoltant des milliards qui ne sont même pas taxés. C’est une sorte d’exploitation par un parasite social géant qui nous revend ce qui a été collectivement créé par l’activité des gens.
L’artiste va alors choisir d’afficher dans l’espace public de nos centres urbains, sur le lieu précis où elles ont été photographiées à leur insu, les silhouettes des personnes capturées par les caméras de Google Street View. Ces « portraits » de personnes saisies au hasard dans la rue par la Google Car – sans leur autorisation – sont en effet imprimés et affichés grandeur nature à l’endroit même où les prises de vues ont été réalisées. Différentes techniques sont utilisées afin d’accentuer l’impact de l’œuvre et pour mieux révéler l’illusion d’anonymat et l’atteinte à la vie privée que sous-tendent les pratiques de Google : le détourage, l’agrandissement à l’échelle 1/1, le collage mural. L’agrandissement des images renforce les aspects floutés de ces silhouettes et accentuent leur qualité spectrale. Il en résulte des spectres numériques qui viennent littéralement hanter l’espace public, à l’interface du monde réel dont elles proviennent et du monde virtuel qui les exploite.
Les Street Ghosts incarnent donc les « victimes algorithmiques » de nos sociétés de l’information – un dommage collatéral de la guerre que se livrent les multinationales du numériques, les gouvernements et les algorithmes. Exfiltrées du réseau, placardées sur les murs de nos villes, leurs silhouettes de papier en basse définition agissent comme des signaux d’alarmes. Glissant d’une existence numérique à une présence réelle dans l’espace public, elles peuvent être reprises en main par les internautes eux-mêmes[13].
Entre Net et Street art, à la frontière de l’espace public et de la vie privée, le public citoyen urbain autant que les internautes s’engagent ainsi eux-mêmes activement contre la violation de la propriété intellectuelle engendrée par l’utilisation abusive des données privées par les GAFA.
Être sur Google Street View est bien pire que d’être sur un poster dans la rue, qui n’est pas permanent et peut toujours être retiré. Alors que nos fantômes vont hanter pour toujours les serveurs de Facebook, Google ou Twitter, toute l’information que nous laissons sur le Net est stockée et commercialisée dans l’ombre de l’enfer numérique. (…) Mon projet est devenu populaire et provocant, non parce que j’ai mis ces images dans les rues, où on les remarque à peine, mais parce que les images des interventions publiques ont été repostées online.
Depuis son lancement en 2007, l’application de Google est régulièrement dénoncée comme empiétant sur l’intimité. Aujourd’hui, en regard du Code pénal français, cette pratique pose désormais problème : toute intrusion dans la vie privée et le non respect de l’intimité violent le « secret des correspondances », incluant désormais les échanges électroniques, et portent atteinte à l’intimité de « paroles prononcées à titre privé ». Certains pays comme l’Allemagne où la Suisse ont retardé le lancement de l’application sur leur territoire. Suite à l’afflux de 240 000 demandes de suppression par des citoyens de toute image de leur domicile, les pouvoirs publics se sont en effet saisis de l’affaire, conduisant Google à suspendre l’installation de Google Street View. Sur le territoire français il est possible de contrer partiellement ces pratiques en réclamant qu’une photo de son visage, de sa maison ou de sa voiture soit floutée : pour cela, il suffit sous dix jours de cliquer sur le lien mentionnant au bas à droite des images « Signaler un problème » en motivant la demande par une justification. Mais encore faut-il avoir connaissance de l’existence de cette image. Par ailleurs, le floutage ne palie qu’imparfaitement l’identification des sujets et des contextes de prise de vues.
L’image joue ici un rôle prépondérant et témoigne de l’hégémonie du visible à l’intérieur d’un dispositif capitaliste occidental dominant. A ce titre, les travaux menés depuis de nombreuses années par la philosophe Marie-Josée Mondzain[14] nous éclairent et rappellent combien le pouvoir dominant peut être attribué non seulement à la finance et aux armes, mais aussi aux moyens de communication et de médiation par les visibilités. Cette funeste articulation semble se confirmer et être encore accentuée à l’ère d’Internet. En contrepoint des discours officiels qui vantent les vertus de la transparence et de la mise en réseau des internautes, les multinationales du divertissement et du renseignement cohabitent. La superposition entre réel et virtuel ne manque pas en effet de brouiller les pistes et fait émerger de nouveaux problèmes souvent non questionnés.
En ce sens, la mise à disposition des flux d’images et de données à caractère sensible, leur réorganisation et remise en forme matérielle et plastique, invitent à une nouvelle répartition des pouvoirs de l’information. Au-delà de la posture délibérément drôle et provocatrice de ces interventions, il s’agit d’adopter un mode opératoire qui ne se contente pas de dépeindre la réalité, mais qui vient directement transformer l’environnement social pour promouvoir la réflexion et les actions citoyennes. Le détournement de données numérisées concentrées par des institutions puissantes s’opère en effet sur un mode participatif. Les œuvres de Paolo Cirio agissent et font agir : à l’instar des ateliers organisés par l’artiste avec les habitants de différentes villes invités à naviguer dans l’espace virtuel des cartographies de Google avant d’intervenir à leur tour dans les rues de leurs villes ou villages.
Ce retournement de la tyrannie de la visibilité, s’est vue accentué à l’occasion d’un projet plus récent de l’artiste Paolo Cirio intitulé malicieusement Overexposed (2014-2015). Suite aux révélations d’Edward Snowden en 2013, neuf clichés photographiques s’étaient vus diffusés et partagés sur les réseaux sociaux. Des portraits de hauts représentants américains de la NSA, la CIA, la NI et le FBI, images prises à l’insu des protagonistes, dans des contextes variables, des scènes domestiques ou familiales privées, quand il ne s’agit pas d’images prises à la volée par des citoyen lors de rares apparitions des protagonistes et mises en ligne la plupart du temps de manière confidentielle. Paolo Cirio va choisir après s’être emparé de ces images dénichées sur Internet et Facebook, de détourer les portraits et de les agrandir pour en faire des affiches reproductibles en une multitude d’exemplaires à exposer dans l’espace public. Cette série de portraits pixélisés de responsables des services secrets américains, va ainsi se trouver placardées sur les murs. Adoptant ironiquement la tactique de l’arroseur arrosé, l’œuvre de Paolo Cirio expose au grand jour le visage de ces hommes de l’ombre qui collectent nos données dans le plus grand secret[15].
Ce fait est particulièrement prégnant dans un projet ultérieur de l’artiste nommé Loophole for all (que l’on peut traduire par « Niche fiscale pour tous » ou « Des paradis fiscaux pour tous ») dans lequel, suite au hack d’un site gouvernemental des îles Caïmans, l’artiste dévoile les ressorts de l’évasion fiscale pratiquée par de nombreuses grandes entreprises. Déjouant la croyance en l’anonymat ou en la protection des données, Loophole for all expose les certificats de constitution et d’incorporation de 200 000 entreprises basées sur les îles Caïmans – en prenant soin de révéler l’identité des sociétés anonymement domiciliées sur ces îles. Suite au hack de leurs numéros d’identification fiscale, l’artiste établit et propose de mettre en vente une série de contrefaçons des certificats de ces compagnies et encourage les citoyens lambdas à en faire l’acquisition. Au delà de l’effet de dénonciation, le projet aspire, au moins ironiquement, à « démocratiser l’évasion fiscale » afin de retourner ou contrecarrer ces privilèges abusifs. Pour la modique somme de 99 cents, les internautes étaient ainsi invités à usurper l’identité d’une de ces compagnies afin de pratiquer librement – et même légalement – l’évasion fiscale. Une fois le certificat acquis, la démarche s’avère selon Paolo Cirio d’une simplicité confondante :
« Vous le joignez à d’autres paperasses quand vous remplissez votre déclaration d’impôts ou lorsque vous facturez votre travail. Vous déclarez que votre business est enregistré aux Caïmans et que, par conséquent, vous n’avez pas d’impôts à payer à votre pays d’origine. C’est aussi simple que ça, grâce à nos lois. Etant donné que les propriétaires de compagnies aux Caïmans sont anonymes et secrets, tout un chacun peut prétendre en être le boss. Il est impossible pour les autorités financières de savoir si vous trichez ou non. Le projet transforme le principal avantage des centres offshore en vulnérabilité[16]. »
La garantie du secret et de l’anonymat rendant difficile sinon impossible toute détection, les usagers pouvaient eux aussi échapper à la vigilance des autorités financières. L’achat des vrais-faux certificats d’incorporation s’opère à partir d’un montant très peu élevé, qui permet de lutter symboliquement sur le même terrain que celui des îles offshores : les affaires. L’enjeu vise à partir d’une faille dans ce système à susciter en la décalant sensiblement la participation du public, dont l’action sur la base d’un concept artistique est susceptible de constituer une véritable menace. Cette action n’a pas été sans provoquer l’indignation des médias internationaux, des grands cabinets d’expertise comptable et autres organismes de la finance dématérialisée tels que PayPal[17] qui a suspendu le compte associé à l’œuvre trois semaines après son lancement.
« PayPal a supprimé le compte trois semaines après le lancement du projet, et j’ai perdu les 700 dollars [530 euros, ndlr] qu’ont rapporté les ventes sur une très courte période. Dans la lettre de PayPal, il était écrit : » PayPal ne peut être utilisé pour vendre ou recevoir des paiements d’items qui encouragent, font la promotion ou forment d’autres à s’engager dans une activité illégale » [18] ».
Mais simultanément, cela n’a pas empêché l’artiste d’obtenir la reconnaissance du milieu de l’art et de se voir décerner le désormais prestigieux Golden Nica, prix du jury du Festival Ars Electronica de Linz (Autriche). L’œuvre s’est vue ensuite de nombreuses fois exposée et ouverte à la participation du public, par exemple au ZKM à Karlsruhe et au CCC Strozzina à Florence (2013), dans le cadre de l’exposition CyberArts lors de l’Ars Electronica de Linz (2014).
On peut lire aujourd’hui, à travers la mise à disposition de ces contrefaçons, une manière rusée et détournée de démocratiser les privilèges abusifs de trop nombreuses multinationales qui délocalisent leur fortune pour échapper à l’impôt. Dans les coulisses de l’économie mondiale, la ruée vers l’or des données numériques (Big data) ne s’embarrasse pas des lois et des valeurs de la démocratie : les abus de pouvoir, la surveillance, le non respect des personnes, y sont monnaie courante. Ainsi qu’on pu le révéler les lanceurs d’alertes[19] ainsi que le mouvement Occupy, les flous juridiques et légaux en matière de gouvernance de l’internet et l’absence de réglementation des centres offshores profitent encore largement aux multinationales des réseaux que sont les GAFA. Cette action résonne avec un projet plus ancien de l’artiste Paolo Cirio (2006) qui avait piraté l’entreprise Amazon.com afin de (re)distribuer gratuitement sur un réseau peer-to-peer un nombre relativement important de livres numériques distribués par la multinationale. La défense du libre accès à la connaissance y était déjà une préoccupation majeure de l’artiste.
Les œuvres de Paolo Cirio participent ainsi d’une critique de l’utilisation des nouvelles technologies lorsque celles-ci constituent un pouvoir hors de tout contrôle. Au-delà de l’approche critique, elles procèdent du détournement volontiers ironique des applications et données du capitalisme de surveillance numérique pour les transposer simultanément dans le monde de l’art et dans l’espace public de la cité. A la croisée du Net et du street art, de l’installation et de la performance, l’artiste combine approche documentaire et recherche plastique (photographie, diagrammes, objets, vidéos, algorithmes, design numérique) pour inciter les citoyens à expérimenter eux-mêmes les coulisses des machines qu’ils utilisent sans toujours en percevoir les logiques et déterminismes. Une philosophie de la libre circulation et du partage des ressources numériques émaille l’ensemble des projets. La redistribution de l’information va de pair avec la réouverture des boîtes noires et de leur traitement algorithmique, afin que les savoir-faire du programmeur et du hacker soient ensuite mis à disposition des citoyens et deviennent des armes de résistance. Les œuvres de Paolo Cirio s’incarnent en effet dans des objets et représentations tangibles, mis en scène pour inviter à la participation active du public.
À ce titre, l’art de Paolo Cirio déploie une écologie de sous-veillance[20] visant à détourner les instruments de la surveillance panoptique exercée par les détenteurs du pouvoir – la police, le gouvernement, le renseignement, les GAFA, etc. Le paradoxe étant que ces institutions, tout en revendiquant des lois de gouvernance et d’information transparente, veillent à masquer ou dissimuler leurs propres instruments de surveillance ainsi que l’étendue et la nature du traitement des données qu’ils collectent. Plus prosaïquement, sous-veiller revient ici à mener une contre-observation : surveiller les surveillants, traquer les traqueurs, rendre public les systèmes de surveillance et l’identité des autorités qui les contrôlent pour se protéger de leurs excès coercitifs et liberticides[21]. Pour ce faire, Paolo Cirio emprunte et prolonge le mode opératoire des « médias tactiques » (tactical media[22]) : l’artiste agit en parasite, hackant, détournant, redistribuant les ressources invisibles de la culture numérique[23]. A l’image des watchdogs ou des lanceurs d’alertes, Paolo Cirio et ses complices investissent par conséquent le domaine public et tous ses canaux d’expression médiatiques (imprimés, installations, vidéos et performance médiatique et in situ). Leurs œuvres interrogent plus largement la reconfiguration du pouvoir de l’information à l’ère numérique et l’affrontement des intérêts publics et privés : propriété intellectuelle, protection de la vie privée, démocratie, finance. Elles débordent ainsi du seul cadre des interrogations esthétiques pour aborder les enjeux publics, juridiques, économiques et culturels de nos sociétés de l’information.
L’art peut constituer ici un contrepoint de l’innovation technique, non pas au sens d’une critique unilatérale du développement des machines, mais davantage de la mise en perspective réflexive et active de la portée de leurs usages, et au-delà, de leurs effets et impacts sociaux. Car ce sont ces derniers qui, la plupart du temps, restent non questionnés, de même que les rouages et fonctionnalités techniques des machines demeurent cryptés. L’enjeu est bien de reprendre le contrôle, pratique aussi bien que symbolique, sur les machines dont on fait l’usage afin de mieux en maîtriser les effets. Sans exagérer toutefois la puissance de ces machines, dont les systèmes et le fonctionnement plus ou moins déterministes ne présentent pas en tant que tel de mystères. L’enjeu étant au contraire de dépasser toutes les mythologies promues aujourd’hui par les G.A.F.A pour redonner une réalité pratique et tangible à des systèmes qui équipent désormais un très large pan de nos vies individuelles et collectives.
[1] Nick SRNICEK, Capitalisme de plateforme : L’hégémonie de l’économie numérique, Montréal, Éditions Lux, 2018.
[2] Shoshana ZUBOFF, The age of Surveillance capitalism : The Fight for a Human Future at the New frontier of Power, New York, Éditions Public Affairs, 2019.
[3] Voir La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), www.cnil.fr et La Quadrature du Net, https://www.laquadrature.net
[4] Plusieurs réseaux d’investigation et de recherche se sont constitués durant les années 2002, dont https://www.surveillance-studies.net ou https://www.sscqueens.org.
[5] Fabien BENOIT, The Valley. Une histoire politique de la Silicon Valley, Paris, Éditions Les Arènes, 2019 ; Fabien BENOIT, L’idéologie de la Silicon Valley, Paris, Éditions Revue Esprit, mai 2019.
[6] Le philosophe Ignacio Ramonet y voit l’émergence d’un nouvel « empire de la surveillance », le durcissement d’un complexe sécuritaro-numérique qui succède au complexe militaro-industriel. (Ignacio RAMONET, L’empire de la surveillance, Paris, Éditions Galilée, 2015). L’ouvrage questionne les effets et conséquences de cette alliance sans précédent entre Etat, appareil militaire, sécurité et industries du web, produisant ce qu’il nomme l’empire de la surveillance « dont l’objectif très concret et très clair est de mettre Internet, tout Internet, et tous les internautes, sous écoute » (p. 20). Voir aussi, plus récemment : Olivier TESQUET, À la trace. Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance, Paris, Éditions Premier Parallèle, 2019.
[7] L’affaire « Cambridge Analytica » offre un bon exemple des dangers potentiels de ces manipulations de l’opinion et des comportements des citoyens. Voir notamment le documentaire Comment Trump a manipulé l’Amérique, Thomas HUCHON, 2018. Et aussi, Britanny KAISER, L’affaire Cambridge Analytica, Paris, Éditions Harpers Collins, 2020 ; Christopher WYLIE, Mindfuck. Le complot Cambridge Analytica pour s’emparer de nos cerveaux, Paris, Éditions Grasset, 2020.
[8] Steven LEVY, L’éthique des Hackers, Paris, Éditions du Globe, 2013 (1984).
[9] François JARRIGE, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, Éditions La Découverte, 2014 ; Andrew FEENBERG, Pour une théorie critique de la technique, Montréal, Éditions Lux, 2014 (2010).
[10] Paolo CIRIO, Face to Facebook, 2011 – http://www.lovely-faces.com
[11] Paolo CIRIO, Street Ghost, 2012 – http://streetghosts.net
[12] Suite aux plaintes récurrentes de citoyens, Allemands et Suisses notamment, relatives à la protection de la vie privée, Google a pris désormais soin de flouter automatiquement les visages et les plaques d’immatriculation. Mais le système de reconnaissance faciale étant encore largement défaillant, il est très souvent possible de reconnaître quelqu’un (par l’identification de son visage, mais aussi de sa silhouette, de ses vêtements ou de sa coupe de cheveux).
[13] L’œuvre Street Ghost a investi plus d’une trentaine de villes internationales avec ce projet, qui sont répertoriées et documentées sur son site internet http://streetghosts.net.
[14] Marie-José MONDZAIN, Le commerce des regards, Paris, Éditions du Seuil, 2003 ; MONDZAIN M-J., Confiscation : des mots, des images et du temps, Paris, Éditions Les Liens qui libèrent, 2017.
[15] Parmi eux figurent par exemple Keith Alexander (NSA), John Brennan (CIA), Michael Hayden (NSA), Michael Rogers (NSA), James Comey (FBI), James Clapper (NSA), David Petraus (CIA), Caitlin Hayden (NSC) et Avril Haines (CIA).
[16] Marie LECHNER, « Entretien avec Paolo Cirio », Libération, mardi 2 septembre 2014.
[17] Propriété d’eBay Inc., Paypal est elle-même une compagnie basée dans un pays offshore, au Luxembourg, générant quelque 145 milliards de dollars non taxés [110 milliards d’euros] et dont la légalité peut par conséquent s’avérer contestable.
[18] Marie LECHNER, « Entretien avec Paolo Cirio », op. cit.
[19] Edward SNOWDEN, Mémoires vives, Éditions du Seuil, 2019.
[20] Le concept de surveillance, dans le sens premier que lui donne Steve Mann (1998), désigne une forme de résistance face à la prolifération des caméras de surveillance. Il s’agit alors de « retourner » les caméras vers le panopticon. (Steve MANN, « Reflectionism and diffusionism : new tactics for deconstructing the video surveillance superhighway », Leonardo, vol. 31, n°2, 1998, pp. 93-102.)
[21] Au fil de l’histoire, différents acteurs – militants, artistes, citoyens – se sont emparés des médias et technologies portables pour déjouer les dispositifs de contrôle et exercer ainsi leur droit de vigilance et de sous-veillance. Sans remonter trop loin et en focalisant l’attention sur le monde de la culture, pensons par exemple au cinéma avec les groupes Medvedkine, aux prémices de l’art vidéo militant et féministe, et plus récemment aux artistes du Net art, ou encore aux citoyens réalisateurs filmant des cop watchs dans le but de dénoncer les violences policières. Voir notamment le blog Copwatch France administré par un collectif de citoyens souhaitant lutter contre les violences policières par la transparence et l’information : http://copwatch.fr.over-blog.com.
[22] David GARCIA, Geert LOVINK, « ABC des médias tactiques », in Annick BUREAUD, Nathalie MAGNAN (dir.), Connexions. Art, réseaux, média, Paris, Éditions École nationale des Beaux-Arts, 2002, p. 72-77.
[23] Jean-Paul FOURMENTRAUX, L’œuvre virale. Net art et culture Hacker, Bruxelles, Éditions La lettre Volée, 2013 ; Jussi PARIKKA, Digital Contagions. À Media Archaeology of Computer Viruses, New York, Éditions Peter Lang, 2007.